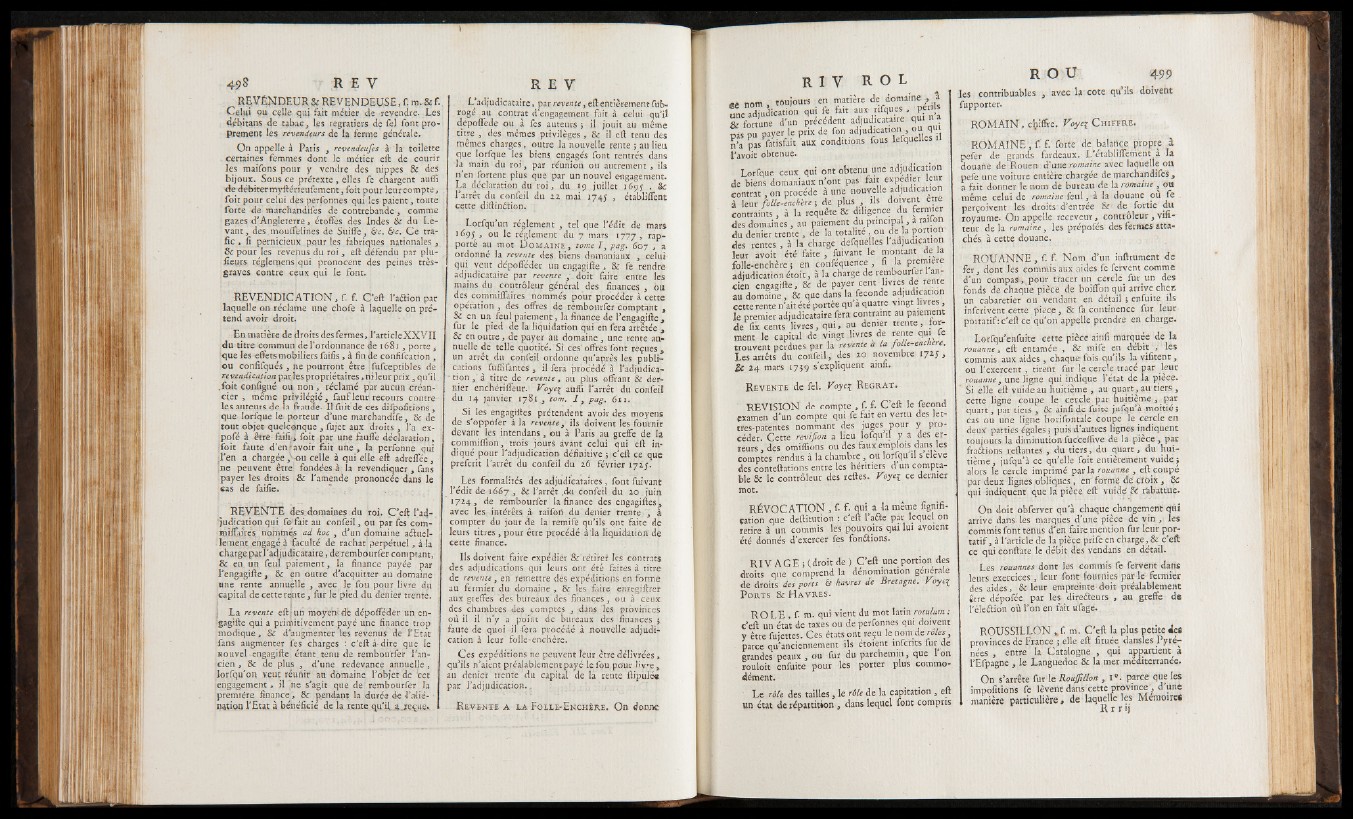
4 9 * H E V
REVENDEUR & REVENDEUSE, f; rçu-&f.
Celiii ou, celle quj fait métier de revendre. Les
débitans de tabac , les regratiers de fel font proprement
le$ revendeurs de la ferme générale.
On appelle à Paris , revendeuses à la toilette
certaines femmes dont le métier elt de courir
les maifons pour y vendre des nippes & des
bijoux. Sous ce prétexte, elles fe chargent auffi
de débiter myflérieufement, foit pour leurcompte,
foit pour celui des perfonnes qui les paient, toute
forte de marchandifes de contrebande, comme
gazes d'Angleterre, étoffes des Indes & du Levant
, des.moufféliries de Suifle, &c. &c. Ce trafic,
fi pernicieux pour les fabriques nationales ,
& pour les revenus du roi , eft défendu par plu-
fieurs réglemenSjqui pronocent des peines très-
graves contre ceux qui le font.
REVENDICATION, f. f. Ç'eft l'aCtion par
laquelle on réclame une chofe à laquelle on prétend
avoir droit.
En matière de droits des fermes, l'article X X V II
du titre commun de l'ordonnance de 1681, porte,
'que les effets mobiliers faifis , à fin.de confifcation ,
ou confifqués , ne pourront être ifufceptibles de ?
revendication par les propriétaires, riileur prix-, qu'il
.foit configné ou non, réclamé par aucun créancier
j même privilégié, fauf leur recours contre
les auteurs de la fraude. Il fuit de ces difpofitions ,
que lorfque le porteur d'une marçhandife, & de
tout objet quelconque , fujet aux droits , l'a ex- .
pofé à être faîfi/i foit par une fauffe déclaration, •
[foit faute d’en*avoir fait un e , lu perfonne qui i
•l'en a chargée ,m>u celle à qui elle eft adreflee, f
[ne peuvent être’ fondées à la revendiquer, fans
payer les droits & l'amende prononcée dans le
cas de faille.
REVENTE des domaines du roi. Ç'eft Lad- ;
judication qui f&Tait au confeil, ou par fes corn- ;
miifaires'.; nommés ad hoc , d'un domaine actuellement
engagé à "faculté de rachat perpétuel, à-la
charge par l’adjudicataire, derembourfer comptant,
& en un feul paiement, la finance payée par
l'engagifte , & en outre d'acquitter au domaine
une rente annuelle , avec le fou pour livre du
capital de cette rejnte, fur le'pied du denier trente.
j La revente eft i un moyeh< dé dépofteder un en- ;
;gagifte qui a primitivement .payé une finance trop ;
modique, & d augmenter l'es revenus de l'Etat 1
fans, augmenter fes charges : c ’eft à-dire que le
»ouvel engagifte étant, tenu de rembourfer Tan-
*cien , & de plus , d'une redevance annuelle, j
Jorfqu'on veut réunir au domaine l'objet de «cet :
■ engagement, ilÇne s'agit que de'rembourfer la
première finance, 8c pendant la durée de 4’ah'é- •
Dation l’Etat à bénéficié de la rente qu’i f .^ .reçus.»
R E V
L’adjudicataire, par revente 3 eft entièrement füb-
rogé au contrat d'engagement fait à celui qu'il
dépoffede ou à fes auteurs j il jouit au même
titre , des mêmes privilèges , & il eft tenu des
mêmes charges, outre la nouvelle rente ; au lieu
que Iprfque les biens engagés font rentrés dans
la main du ro i, par réunion ou autrement , ils
n'en fortent plus que par un nouvel engagement.
La déclaration du ro i, du 19 juillet 169y , &
l'arrêt du confeil du 22 mai 1745 , établirent
cette diftinCtion.
Lorfqu'urr réglement , tel que l’édit de mars
169^, ou le réglement du 7 mars 1 7 7 7 , rapporté
au mot Domaine, tome 1 3 pag. 607 , a
ordonné la revente des biens domaniaux , celui
qui veut dépofféder Un engagifte , & fe rendre
adjudicataire par revente doit faire entre les
mains du contrôleur général des finances , bu
des commiflaires nommés pour procéder à cette
opération , des offres de rembourfer comptant ,
& en un! feul paiement, la finance de l'engagifte,
fur le pied de la liquidation qui en fera arrêtée ,
& en outre, de payer au domaine, une rente annuelle
de telle quotité. Si ces’ offres font reçues,
un arrêt, du confeil ordonne qu'après les publications
fufKfantes , il fera procédé à l'adjudica-
" tion à titre de revente, au plus offrant & dernier
enchériffeur. Voyeç aùfli l'arrêt du çonfeiî
du 14 janvier 178,1., tom. 1 3 pag. 611.
Si^ les engagiftes prétendent avoir des moyens
de s'oppofer à la revente 3 ils doivent les fournir
devant les intendans, ou à Paris au greffe de la
cornmiffron, trois jours avant celui qui éft indiqué
pour l'adjudication définitive j; ç'eft ce que
preferit l ’arrêt du confeil du 26 février 1725.
Les formalités des adjudicataires , font fuivant
l'édit de 1667 , & l'arrêt .du confeil du 20 3 juin
17 2 4 , de rembourfer la finance des engagiftes^
avec les intérêts à raifori du denier trente/, à
compter du jour de la!remife qu'ils Qiit faite de
leurs titres, pour être procédé à la liquidation de
cette finance.
Ils doivent faire expédiér & ‘rétîref les contrats
des adjudications qui leurs ont été faites à titre
de revente, en remettre dés expéditions en forme
au fermier du domaine, & les faire enregiftrer
aux greffes des bureaux des finanças, ou à - ceux
des chambres des comptes 'dans les province^
où il il n'y a point de bureaux des finances
faute de quoi il -fera procédé .à nouvelle adjudication
à leur folle-enchère.
Ces expéditions ne peuvent leur être délivrées »
qu'ils n'aient préalablement payé le fou, pour liv’-e,
au deniet trente du capital de là rente ftipulée
par l'adjudication...
Revente a la Folle-Enchère. On donne
r 1 v R o l
nnm toujours en «ne matière de domaine -, 3 adTudication qui fe fait au* rifques. perds
& fortune d'un précédent adjudicataire qui n a
Dis pu payer le prix de fon adjudication ,
n’a pasPfatisfüt aux conditions fous lefquelles il ,
l'avoit obtenue.
Lorfque ceux qui ont obtenu une adjudication
de biens domaniaux n'ont pas fait exped.et leur :
contrat . on procède à une nouvelle adjudication
i leur folle-enchere ; de plus , ils doivent etre
contraints, à la requête & diligence du fermier
des domaines, au paiement du principal, a raiton
du denier trente , de la totalité, ou de la portion
des rentes, à la charge defquelles 1 adjudication
leur avoir été faite , fuivant le montant de la
folle-enchère i en conféquence, fi la première
adjudication étoit, à la charge de rembourfer 1 ancien
engagifte. & de payer cent-livrés de rente
au domaine, & que dans la fécondé adjudication
cette rente n'ait été portée qu a quatre vingt livres,
le premier adjudicataire fera contraint au paiement
de fix cents livres, qui. au denier trente, forment
le capital de vingt livres de rente qui fe
trouvent perdues par la revente a. U folle enchère.
Les arrêts du confeil, des zo novembre 17 2 5 ,
U 24 mars 1739 s'expliquent amfi.
Revente de fel. Voye{ Regrat.
REVISION de compte , f. f. C ’eft le fécond
examen d'un compte qui fe fait en vertu des let-
tres-patentes nommant des juges pour y pro-
céder. Cette revifion a lieu lofqu il y a des erreurs,
des omiffions où des faux emplois dans les
comptes rendus à la chambre, ou lorfqu il s eleve
des conteftations entre les héritiers d'un comptable
& le contrôleur des relies. ce dernier
mot.
R É V O C A T IO N , f- f- qui a la même lignification
que deftitution : ç'eft l’a&e par lequel on
retire à un commis lés pouvoirs qui lui avoient
été donnés d’exercer fes fonctions.
R I V A G E ; C droit de ) C ’eft une portion des
droits que comprend la dénomination generale
de droits des ports & havres de Bretagne. Vye^
P orts & Havres.
R O L E , f. m. qui vient du mot latin rotulum :
ç'eft un état de taxes ou de perfonnes qui doivent
y être fujettes. Ces états ont reçu le nomde^ rôles ,
parce qu'anciennement ils etoient infcrits fur de
grandes peaux, ou fur du parchemin, que 1 on
rouloit enfuite pour les porter plus commodément.
: Le rôle des tailles, le rôle de la capitation , eft
un état de répartition , dans lequel font compris
R O U 4 99
les contribuables , avec la cote qu’ ils doivent
fupporter.
R O M A IN , chiffre. V'oyei C hiffre.
R OM A IN E ', f f. foïte de balance propre à
pefer de grands fardeaux. L'établiffemerit a la
douane de Rouen d’une romaine avec laquelle on
pefe une voiture entière chargée de rparchandifes ,
a fait donner le nom de bureau de la rôfnaine 3 on
même celui de romaine feul, à la douane où fe
perçoivent les droits'd’entrée & de fortie du
royaume. On appelle receveur, contrôleur, vifi-
teur de la romaine, les prépofés des fermes attachés
à cette douane.
R O U A N N E , f. f. Nom d'un inftrument de
fe r , dont les commis aux aides fe fervent comme
d'un compaSt,spour tracer un cercle fur un des
fonds de chaque pièce de boiflon qui arrive chez
un cabaretier ou vendant en détail j enfuite ils
inferivent cette piec.e, & fa continence fur leur
poitatifrc'efi ce qu'on appelle prendre en charge.
Lorfqu'enfuite cette pièce ainfi marquée de la
- rouanne, eft entamée , & mife en débit nsj les
commis aux aides , chaque fois qu’ils la vifitent,
ou l'exercent, tirent fur le cercle trace par leur
rouanne , une ligne qui indique l'état de la pièce. '
i Si elle eft vuideau huitième , au quart, au tiers ,
cette ligne coupe le cercle par huitième, par
quart, par tiers , & ainfi de fuite jufqu a moitié ;
cas ou une ligné horifontale coupe le cercle en
deux parties égales; puisd'autres lignes indiquent
toujours la diminutionfuc’ceftive de la p ièce, par
fra&ions reliantes , du tiers,.du quart, du huitième,
jufqu'à ce qu'elle foit entièrement vuidé,;
alors le cercle imprimé par la rouanne , eft coupé
par deux lignes obliques , en' formé dé çfôix , &
qui indiquent que la pièce eft vùidé 8t râbattue.
On doit obferver qu’à chaque changement qüi
arrive dans les marques d’une pièce de vin , les
commis font tenus d'en faire mention fur leur portatif,
à l ’article de la pièce prife en charge ,Jk c’eft
ce qui conftàte le débit des vendans en détail.
Les rouannes donc les commis fe fervent dans
leurs exercices , leur font fournies pat le fermier
des aides, & leur empreinte’ doit préalablement
être dépofée par les directeurs , au greffe de
l’éleClion où l'on en fait ufagé.
RO US S IL LO N '* f. m. C 'e lt la plus petite 4es
provinces de France ; elle eft fituée dansles Pyrénées
, entre la Catalogne , qui appartient^ à
l’Efpagne , le Languedoc & la mer mëditerranée.
On s'arrête fa tle RoUJJMon , i®. parce queIe£
impofitions fe lèvent dans cette province/ d une
manière particulière » de laquelle les Mémoire*
R r r i j
llliiy »