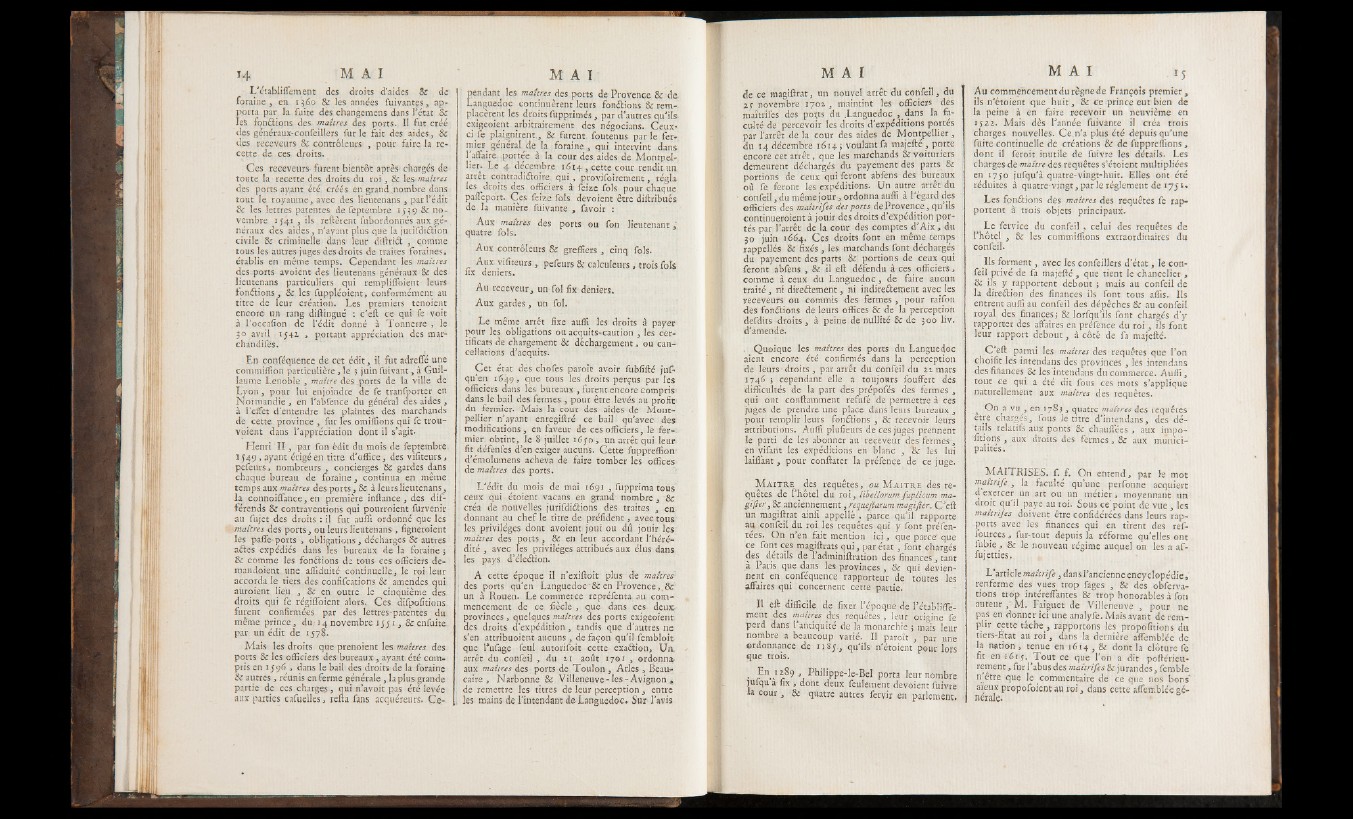
i 4 M A I
L’établiffemept des droits d’aides Bc de
foraine j en 1 3.60. & les années fuivantes , ap^-
porta par la fuite des changemens dans Tétât &
les fondions des maîtres des ports. Il fut créé
des généraux-confeillèrs fur le fait des aides, &
des receveurs & contrôleurs , pour faire la recette
de ces droits.
Ces receveurs- furent bientôt après- chargés de
toute, la recette, des. droits du r o i , & les maîtres
des ports ayant été créés en grand „nombre dans
tout le royaume, avec des lieutenans , par Tedit
& les lettres patentes de feptembre 153.9 & novembre.
1541 , ils relièrent fubordonnés aux généraux
des aides, n’ayant plus que la jurifdiétion
civile & criminelle dans- leur diftriét , comme
tous les autres juges des droits de traites foraines,
établis en même temps. Cependant les maîtres
des^ports avoient des lieutenans généraux & des
lieutenans particuliers qui remplifibient leurs
fonctions, & . les fuppléoient, conformément au
titre de leur création. Les premiers tenoient
encore un rang diftingué : c ’eft ce qui fe voit
à l ’occafîon de l’édit donné à Tonner-re , le
30 avril 1542 , portant appréciation des mar-
chandifés.
En conféquence de cet édit, il fut adrelfé une
commillion particulière, le 3 juin fuivant, à Guillaume
Lenoble , maître des .ports de la ville de
L y o n , pour lui enjoindre de fe tranfporter en
Normandie , en Tabferice du général des aides ,
à l’effet d’entendre les plaintes des marchands
de cette province , fur les omiffions qui fe trouvaient
dans l’appréciation dont il s’agit.
Henri IL , par fon édit du mois de feptembre.
3 549, ayant érigé en titre d’office, des vifîteurs,
pefeurs, nombreurs , concierges & gardes dans
chaque bureau de foraine, continua, en même
temps aux maîtres des ports, & à leurs lieutenans,
la connoiffance, en première inftance , des différends
& contraventions qui pourroient furvenir
au fujet des droits : il fut auffi ordonné que les
maîtres des ports, ou leurs lieutenans, figneroient
les paffe-ports , obligations , décharges & autres
a&es expédiés dans les bureaux de la foraine 3
& comme les fonctions de tous- ces officiers demandaient
une affiduité continuelle., le roi'leur
accorda le tiers des confifications & amendes qui
auroient lieu , & en outre le cinquième des
droits qui fe régiffoient alors. Cës difpofîtions
furent confirmées par des lettres-patentes du
même prince, du; 14 novembre 15 5 1 , &enfuite.
par un édit de 1578.
Mais1 les droits queprenoient les maîtres., des.
ports & les officiers des bureaux, ayant; été compris
en 159(1, dans le bail des droits de la foraine
& autres, réunis en ferme générale, la plus grande
partie de ces ,charges , qui n’avoit pas été levée
aux parties cafuelles, relia fans acquéreurs. Ce-
M A I
pendant les maîtres des ports de Provence &r de
Languedoc continuèrent leurs fonctions & remplacèrent
les droits fupprimés , par d’autres qu’ ils-
exigeoient arbitrairement des négocians. Ceux*
ci fe plaignirent,, & furent foutenus parle fermier
général de la foraine , qui intervint dans 1 affaire portée à: la cour des aides de Montpellier.
Le 4 décembre 1614 ^ cette cour rendit,un
arrêt contradiéloire q u i, provifoirement, régla
les droits des officiers à feîze fols pour chaque
palTeport. Ces feizé.fols dévoient être diftribués
de, la manière füivante , favoir :
Aux maîtres des ports ou fon lieutenant
quatre fols.
Aux contrôleurs & greffiers , cinq fols.
Aux vifîteurs, pefeurs & calculeurs , trois fols
fix deniers.
Au receveur, un fol fîx deniers.
Aux gardes, un fol.
Le même arrêt fixe auflî les droits à payer
pour les obligations ou acquits-caution , les certificats
de chargement & déchargement, ou can-
cellations d’acquits.
C et état dès chofes paroït avoir fubftfté juf-
qu’en 1649, que tous les droits perçus par les
officiers dans les bureaux , furent.encore compris;?
dans le bail des fermes , pour être levés au profit’
du fermier. Mais la cour des aides de Montpellier
n’ayant enregiftré ce bail qu’avec des
modifications , en faveur de ces officiers , le fer-:
mier. obtint, le 8 juillet 1650, un arrêt qui leur
fit défenfes d’en exiger aucuns. Cette fuppreffiorr
d’émolumens acheva de faire tomber les offices
de maîtres des ports.
L ’ édit du mois de mai 169J , fiipprima tous
ceux qui étoient vacans en grand nombre , &
créa de nouvelles jurifdiélions des traites , en
donnant au chef le titre de préfîdent, avec tous
les privilèges dont avoient joui ou dû jouir les
maîtres des ports, & en leur accordant l’hérédité
, avec les privilèges attribués aux élus dans
les pays d’éleétion.
A cette époque il n’exiftoit plus de maîtres-
des ports qu’ en Languedoc & en Provence,.8r
un à Rouen. Le commerce repréfenta au commencement
de ce fîècle, que dans ces deux-
provinces, quelques maîtres des ports exigeoient
des droits d’expédition, tandis que d’autres ne
s’en attribuoiênt aucuns , de façon qu’il fembloit
que Tufage feul autorifoit cette exa&ion, Un
arrêt du confeil , du 21 août 1701 , ©rdonna-
aux maîtres des ports de Toulon , Arles , Beau-
caire , Narbonne & Villeneuve - le s - Avignon ^
de remettre les titres de leur perception, entre
les mains de l’intendant de Languedoc. Sur l’a-vis
M A I M A I
de ce magiftrat, un nouvel arrêt du confeil, du
2 ç novembre 170 2 , maintint les officiers des
maîtrifes des poçts du .Languedoc , dans la faculté
de percevoir les droits d’expéditions portes
par l’arrêt de la cour des aides de Montpellier,
du 14 décembre 16143 voulant fa majefté, porte
encore cet arrêt, que les marchands & voituriers
demeurent déchargés du payement des parts &
portions de ceux qui feront abfens des bureaux
où fe feront les expéditions. Un autre arrêt du
confeil, du même jou r, ordonna auffi à l ’égard des
officiers des maîtrifes des ports de Provence, qu’ils
continueroient à jouir des droits d’expedition portés
par l’arrêt de la cour des comptes d’A ix , du
30 juin 1664. Ces droits font en même temps
rappellés & fixés , les marchands font déchargés
du payement des parts & portions de ceux qui
feront abfens , & il eft défendu à ces officiers,
comme à ceux du Languedoc, de faire aucun
traité, ni directement, ni indirectement avec les
receveurs ou commis des fermes, pour raifon
des fonctions de leurs offices & de la perception
defdits droits, à peine de nullité & de 300 liv.
d’amende.
, Quoique les maîtres des ports du Languedoc
aient encore été confirmés dans la perception
de leurs ■ droits, par arrêt du confeil du 22 mars
1746 j cependant elle a toujours fouffert dés
difficultés de la part des prépofés des fermes ,
qui ont conftamment refufé de permettre à ces
juges de prendre une place dans leurs bureaux ,
pour remplir leurs fonctions , & recevoir leurs
attributions. Auffi plufieurs de ces juges prennent
le parti de les abonner au receveur des fermes,
ën vifant les expéditions en blanc , '& les lui
■ laiflaat, pour conftater la préfenee de ce juge.
M aître des requêtes, ou Maître des requêtes
de 1 hôtel du roi, libellorum fuplicum ma-
gi(ler3 & anciennement , requejïarum magifîer. C ’eft
un magiftrat ainfi appelle , parce qu’il rapporte
au confeil du roi les requêtes qui y font préfen-
tées. On n’en fait mention i c i , que parce’ que
ce font ces magiftrats qui, par é ta t, font chargés
des details de l’adminiftration des finances , tant
.a Paris que dans les provinces, & qui deviennent
en conféquence rapporteur de toutes les
affaires qui concernent cette partie.'
Il eft difficile de fixer l’ époque de Tétabliffe-
ment des maîtres des requêtes , leur origine fe
perd dans Tantîquité de la monarchie 3 mais leur
nombre a beaucoup varié. Il paroït , par .une
ordonnance de 1185., qu’ils n’étoient pour lors
que trois.
* ^ilippe-le-Bel porta leur nombre
jufqu a fix , dont deux feulement dévoient fuivre
la cou r , & quatre autres fervir en parlement.
l 5
Au commencement du règne de François premier,
ils n’étoient que hu it, & ce prince eut bien de
la peine à en faire recevoir un neuvième en
1522. Mais dès Tannée füivante il créa trois
charges nouvelles. C e.n’a plus été depuis qu’une
fuite continuelle de créations & de fuppreffions,
dont il feroit inutile de fuivre les détails. Les
charges de maître des requêtes s’étoient multipliées
en 1750 jufqu’à quatre-vingt-huit. Elles ont été
réduites à quatre-vingt, par le réglement de 1751 *
Les fondions des maîtres des requêtes fe rapportent
à trois objets principaux.
Le fervice du confeil , celui des requêtes de
l’hôtel , & les commiffions extraordinaires du
confeil.
Ils forment, avec les confeillers d’éta t, le confeil
privé de fa majefté, que tient le chancelier ,
& ils y rapportent debout 3 mais au confeil de
la direction des finances ils font tous affis. Ils
entrent auffi au confeil des dépêches & au confeil
royal des finances} & lorfqu’ils font chargés d’y
rapporter des affaires en ptéfence du r o i, ils font
leur rapport debout, à côté de fa majefté.
C eft parmi 1 es maîtres des requêtes que Ton
choifit lés intendans des provinces , les intendans
des finances & les intendans du commerce. Auffi,
tout ce qui a été dit fous ces mots s’applique
naturellement aux maîtres des requêtes.
X, On a vu , en 1783, quatre maîtres des requêtes
etre chargés, fous le titre d’intendans, des détails
relatifs aux ponts & chauffées , aux importions
, aux droits des fermes, & aux municipalités,
MAITRISE S, f. f. On entend, par fe mot
maîtrife.y la faculté qu’une perfonne acquiert
d exercer un art ou un métier, moyennant un
droit qu’il paye au roi. Sous ce point de v u e , les
maîtrijes doivent être confidérées dans leurs rap-
. ports avec les finances qui en tirent des ref-
fources, fur-tout depuis la réforme qu’ elles ont
fubie, & le nouveau régime auquel on les a af-
fujetties..
L ’article mafm/e , dans l’ancienne encyclopédie,
renferme des vues trop fages , & des obferva-
tions trop intéréffanres & trop honorables à fon
auteur Faiguet de V illen eu v e , pour ne
pas en donner ici une analyfe. Mais avant de remplir
cette tâche , rapportons les proportions du
tiers-Etat au r o i , dans la dernière affemblée de
-la nation , tenue en 1614 , & dont la clôture fe
■ fit en 1615. Tout ce que l’on a dit poftérieu-
rement, fur 1 abus des maîtrifes & jurandes, femble
n’être que le commentaire de ce que nos bons'
aïeux propofoient au r e i, dans cette afiemblée générale.