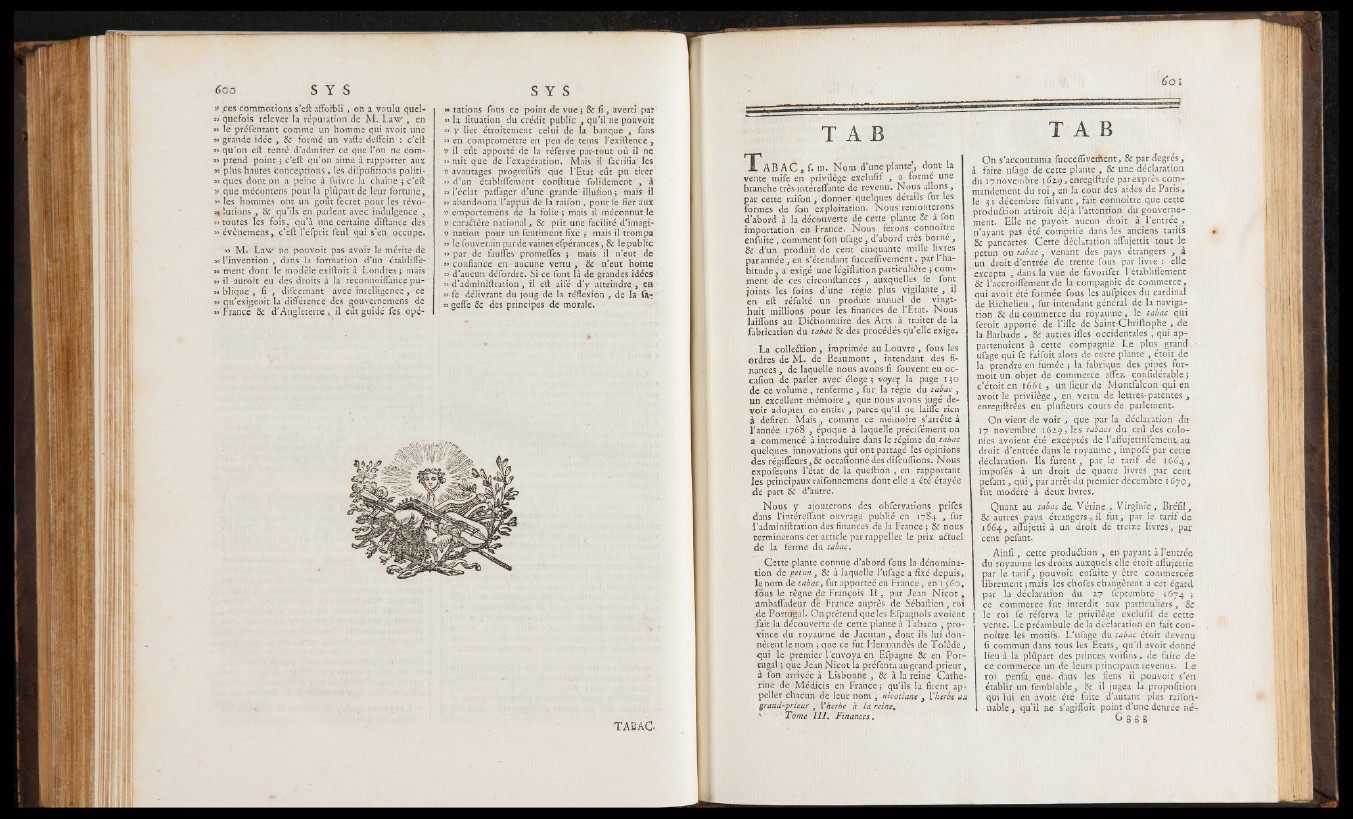
6oo S Y S
» jces commotions s’eft affoibli, on a voulu quel-
» quefois relever la réputation de M , L aw , en
” le préfentant comme un homme qui avoit une
» grande idée , & formé un vafte deflein : c’ eft
» qu'on eft tenté d’admirer ce que Ton ne corn*
» prend point 3 c’eft qu’on aime à rapporter aux
» plus hautes conceptions , les difpofitions politi-
» ques dont on a peine à fuivre la chaîne ; c ’eft
» que mécontens pour la plûpart de leur fortune,
95 les hommes ont un goût fecret pour les révo- 99 îutions , & qu’ ils en parlent avec indulgence ,
99 toutes les fois, qu’ à une certaine diftance des
»> évènemens, c’ eft l’efprit feul qui s’en occupe.
99 M . L aw ne pouvoir pas avoir le mérite de
99 l’invention , dans la formation d’ un établifle-
99 ment dont le modèle exiftoit à Londres j mais
99 il auroit eu des droits à la reconnoififance pu-
9i blique , lî , difcernant avec intelligence , ce
99 qu’exigeoit la différence des gouvernemens de
» France 8c d’Angleterre ,, il eût guidé fes opé-
S Y S
>• rations fous ce point de vue j & f i , averti paï
>9 la fituation du crédit public , qu’il ne pouvoit
>9 y lier étroitement celui de la banque , fans
99 en compromettre en peu de tems l’exiftence ,
» il eût apporté de la réferve par-tout où il ne
99 mit que de l’exagération. Mais il facrifia' les
» avantages progreflifs que l’Etat eût pu. tirer
93 d’ un établifiement conftitué folidement , à
99 l’éclat paflager d’uné grande illufîon; mais il
99 abandonna l’appui de la raifon , pour fe fier aux
» emportemens de la folie > mais il méconnut le
» caractère national, & prit une facilité d’imagi-
» nation pour un fentiment fixe i mais il trompa
99 le fouverain par de vaines efpérances, 8c le public
»9 par de faunes promefles j mais il n’eut de
99 confiance en aucune vertu , & n’eut honte
99 d’aucun défordre. Si ce font là de grandes idées
93 d’adminiftration, il eft aifé d’y; atteindre , en
93 fe délivrant du joug de la réflexion , de la fat
ü> geflfe 8c des principes de morale.
T A B A C
6o i
T A B
T a b a c | f. m. Nom d’une plante’, dont la
vente mife en privilège exclufif , a forme une
branche très-intereflante de revenu. Nous allons,
par cette raifon, donner quelques details fur les
formes de fon exploitation. Nous remonterons
d’abord à la découverte de cette plante & à fon
importation' en France. Nous ferons connoitre
enfuite , comment fon ufage, d’abord très borne ,
& d’un produit de cent cinquante mille livres
par année, en s’ étendant fucceflivement, par l’ habitude
, a exigé une légiflation particulière > comment
de ces circonftances , auxquelles fe font
joints les foins d’une régie plus, vigilante , il
en eft réfulté un produit annuel de vingt-
huit millions pour les finances de l’Etat. Nous
laiffons au Di&ionnaire des Arts à traiter de la
fabrication du tabac & des procédés qu’elle exige.
La colle&ion, imprimée au Louvre , fous les
ordres de M. de Beaumont, intendant des finances
, de laquelle nous avons fi fouvent eu oc-
cafion de parler avec éloge j voye% la page 130
de ce volume , renferme , fur la régie du tabac ,
un excellent mémoire , que-nous avons jugé devoir
adopter en entier , parce qu’ il ne laifle rien à defirer. Mais , comme ce mémoire s’ arrête à
l’année 1768 , époque à laquelle précifément on
a commencé à introduire dans le régime du tabac
quelques innovations qui ont partagé les opinions
des régiffeurs, & occafionnédes difcuflions. Nous
expoferons l’état de la queftion , en rapportant
les principaux raifonnemens dont elle a été étayée
de part & d*autre.
Nous y ajouterons des obfervations prifes
dans Tintéreflant ouvrage publié en 1784 , fur
l ’adminiftration des finances de la France ; & nous
terminerons cet article par rappeller le prix aéluel
de la ferme du tabac.
Cette plante connue d’ abord fous la dénomination
de petun, & à laquelle l’ufage a fixé depuis,
le nom de tabac, futapporteé en France, en i j6 o ,
fous le règne de François I I , par Jean N ic o t ,
ambaflTadeur de France auprès, de Sébaftien , roi
de Portugal. On prétend que les Efpagnols avoient
fait ja découverte de cette plante à Tabaco , province
du royaume de Jacutan, dont ils lui donnèrent
le nom 5 que ce fut Hermandès de Tolède,
qui le premier l ’envoya en Efpagne & en Portugal
j que Jean Nicot la préfenta au grand-prieur,
à fon arrivée à Lisbonne , 8c à la reine Catherine
de Médicis en Francej qu’ils la firent ap-
peller chacun de leur nom , nicotiane , Yherbe au
grand-prieur 3 Y herbe a la reine.
x Tome IIJ. Finances.
T A B
On s’accoutuma fuccefliverftent, &.par degrés,
à faire ufage de cette plante , & une déclaration
du 17 novembre 1629, enregiftrée par exprès corn-
mandement du ro i, en la cour des aides de Paris,
le 31 décembre fuivant, fait connoître que cette
produ&ion attiroit déjà l’attention du gouvernement.
Elle ne payoit aucun droit à l’entrée ,
n’ayant pas été comprife dans les anciens tarifs
& pancartes. Cette déclaration affujettit tout le
petun ou tabac, venant des pays étrangers , à
un droit d’entrée de trente fous par livre : elle
excepta , dans la vue de favorifer 1 etabliffement
& l’accroiflement de la compagnie de commerce,
qui avoit été formée fous les aufpices du cardinal
de Richelieu , fur-intendant général de la navigation
& du commerce du royaume, le tabac qui
feroit apporté de Tille de Saint-Chriftophe , de
la Barbade , & autres files occidentales , qui ap-
partenoient à cette compagnie. Le plus, grand
ufage qui fe faifoit alors de cette plante , étoit de
la prendre en fumée j la fabrique des pipes for-
moit un objet de commerce aflez confidérable ;
c’étoit en 1661 , un fieur de Montfalcon qui en
avoit le privilège, en. vertu de lettres-patentes ,
enregiftrees en plufieurs cours de parlement.
On vient de voir , que par la déclaration du 17 novembre 1629, les tabacs du crû des colonies
avoient été exceptés de Talfujettfifement, au
droit d’entrée dans le royaume, impofé par cette
déclaration. Us furent, par.le tarif de 1664,
impofés à un droit de quatre livres par cent
pelant, qui, par arrêt du premier décembre 1670,
fut modéré à deux livres.
Quant au tabac de. V é rine., Virginie, Bréfil,
& autres pays étrangers, il fu t, par le tarif de
*664, affujetti à un droit dé treize livres, par
cent pefant.
Ainfi , cette produ&ion du royaume les droits auxque, lse ne llpea éytaonitt àa llf’uenjettrtéiee
lpiabrr elme etnatr if, pouvoit enfuite y être commercée par la dé;c mlaariast iolens cdhouf es2 c7h anfegpètreemntb ràe c et1 6é7g4a rdj
clee rcooi mfme errécfee rvfuat lien tperridviitl ègaue x epxacrltuifciuf ldieer sc,e t&te
vneonîttree. Llees pmréoatmifbs.u lLe ’duefa lga ed édcul aration en fait contabac
étoit devenu
fi commun dans tous les Etats, qu’il avoit donné
lciee uc oàm lam eprlcûep aurnt ddee s lpeurirnsc persi nvcoipifaiunxs, redvee nfuaisr.e Ldee roi penfa, que* dans les fiens il pouvoit s’en
établir un femblable, 8c il jugea la propofition
qui lui en avoit été faite d’autant plus raifon-
nable, qu’il ne s’agiffoit point d’une denrée né