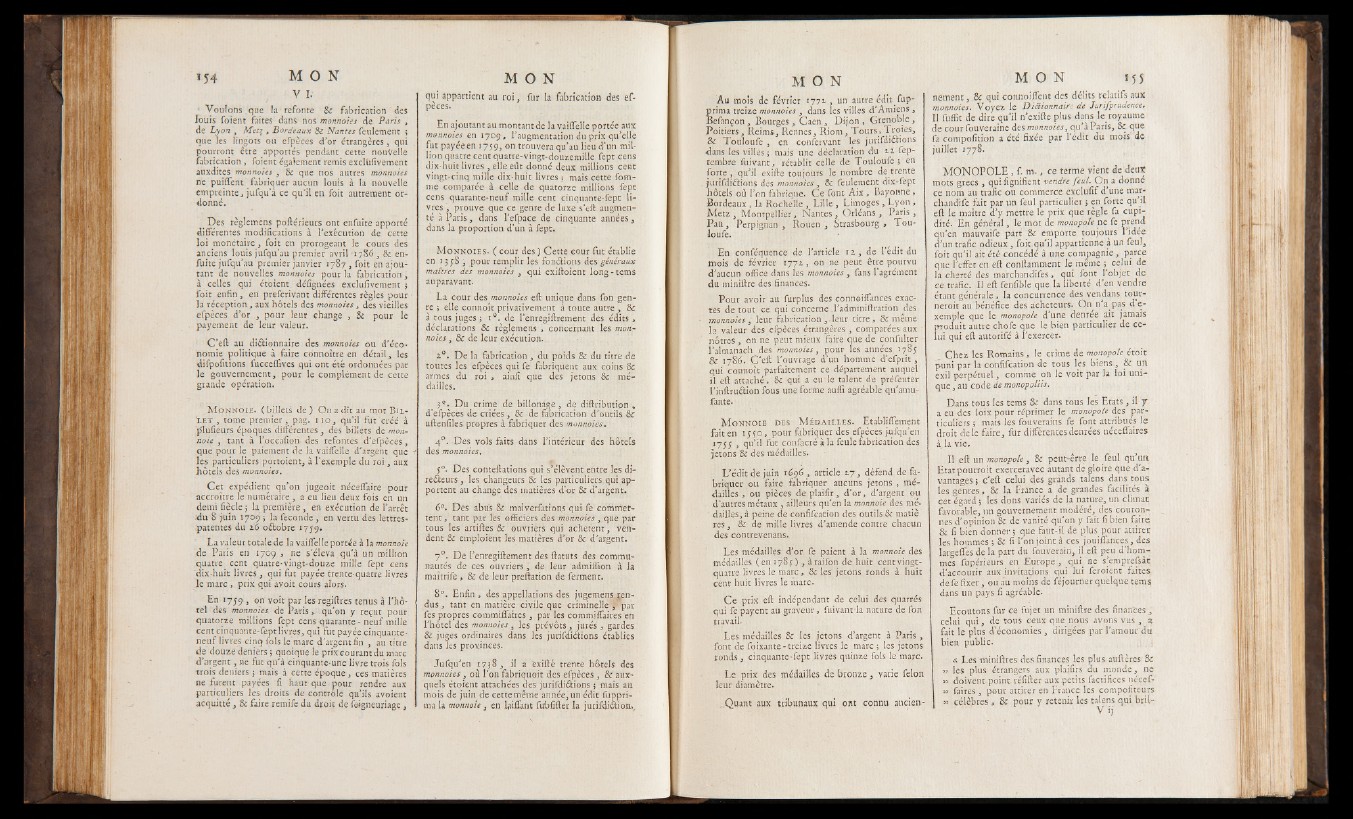
M O N
v I.
; Voulons.que la refonte 8c fabrication d e s
Jouis foient faites dans nos monnoies de Paris ,
de Lyon '3 Met% , Bordeaux 8c Nantes feulement ;
que les lingots ou efpèces d'or étrangères, qui
pourront être apportés pendant cette nouvelle
fabrication , foient également remis exclùfivement
auxdites monnoies , & que nos autres monnoies
ne puiflfent fabriquer aucun louis à la nouvelle
empreinte j jufqu’à ce qu’il en foit autrement ordonné.
Des règlemèns poftérieurs ont enfuite apporté
différentes modifications à l'exécution de cette
loi monétaire j foit en prorogeant le cours des
anciens louis jufqu’au premier avril 1786 3 8c en-
fuite jufqu’ au premier janvier 1787 , foit en ajoutant
de nouvelles monnoies pour la fabrication 3
à celles qui étoient. défignées exclùfivement j
foit -enfin, en prefcrivant différentes règles pour
la réception , aux hôtels des monnoies , des vieilles
efpèces d’or , ‘ pour leur change , 8c pour le
payement de leur valeur.
C ’eft au dictionnaire des monnoies ou d’économie
politique à faire connoître en détail , les
difpofitions fucceflives qui ont été ordonnées par
le gouvernement, pour le complément de cette
grande opération.
M on no ie. (billets d e ) On a dit au mot Bill
e t , tome premier, pag. n o , qu’il fut créé à
plufieurs époques différentes , des billets de monnoie
, tant à l’occafion- des refontes d’efpèces,
que pour le paiement de la vaiffelle d’argent que
les particuliers portoient, à l ’exemple du ro i, aux
hôtels des monnoies.
C e t expédient qu’on jugeoit néceflaire pour
accroître le numéraire , a eu lieu deux fois en un
demi fiècle 3 la première , en exécution de l’arrêt
-du 8 juin 1709 $ la fécondé, en vertu des lettres-
patentes du 26 oélobre 1759.
La valeur totale de la vaiffelle portée à la monnoie
de Paris en 1709 , ne s'éleva qu’à un million
quatre cent quatre-vingt-douze mille fept cens
'dix-huit livres , qui fut payée trente-quatre livres
le marc, prix qui avoit cours alors.
Eu l 759 3 on voit par les regifires tenus à l’hôtel
des monnoies de ParisiSX qu’on y reçut pour
quatorze millions fept cens quarante-neuf mille
cent cinquante-fept livres, qui fut payée cinquante-
neuf livres cinq fols le marc d’argent fin , au titre
de douze deniers j quoique le prix courant du marc
d’argent, ne fut qu’ à cinquante-une livre trois fols
trois deniers j mais à cette époque, ces matières
ne furent payées fi haut que pour rendre aux
particuliers les droits de contrôle qu’ils avoient
acquitté , & faire remife du droit de foigneuriage,
qui appartient au ro i, fur la fabrication des efpèces.
En ajoutant au montant de la vaiffelle portée aux
monnoies en 1709 , l’augmentation du prix qu’elle
fut payée en 1759, on trouvera qu’au lieu d’ un million
quatre cent quatre-vingt-douzemille fept cens
dix-huit livres, elle eût donné deux millions cent
vingt-cinq mille dix-huit livres 3 mais cette fom-
me comparée à celle de quatorze millions fept
cens quarante-neuf mille cent cinquante-fept livres
, prouve que ce genre de luxe s’eft augmenté
à Paris, dans l’efpace de cinquante années ,
dans la proportion d’un à fept.
M onnoies. ( cour des ) Cette cour fut établie
en 13 yS , pour remplir les fonctions des généraux
maîtres des monnoies , qui exiftoient long-tems
auparavant.
La Cour des monnoies eft unique dans fon genre
j elle connoît privativement à toute autre , 8c
à tous juges 5 i ° . de l’enregiftrement des édits ,
déclarations & règlemens , concernant les monnoies
, & de leur exécution.
20. De la fabrication , du poids & du titre de
toutes les efpèces qui fe fabriquent aux coins 8c
armes du roi , ainfi que des jetons & médailles.
3■ ?-*. Du crime de billonâge , de diftribution ,
d’efpècês de criées , & de fabrication d’outils 8c
uftenfiles propres à fabriquer des monnoies.
4°. Des vols faits dans l’intérieur des hôtels
des monnoies.
50. Des conteftations qui s elèvent entre les directeurs,
les changeurs & les particuliers, qui apportent
au change des matières d’or 8c d’argent.
6°. Des abus & maîverfation.s qui fe cothmet-
tent, tant par les officiers des monnoies, .que par
tous les artiftes 8c ouvriers qui achètent, vendent
& emploient les matières d’or & d’argent.
7°. De l’enregiftement des ftatuts des communautés
de ces ouvriers, de leur admifllon à la
maîtrife * 8c de leur preftation de ferment.
8°. Enfin, des appellations des jugemens rendus,
tant en matière civile que criminelle !|Fpar
fes propres commiffaires , par les commiffaires en
l’hôtel des monnoies , les prévôts, jurés , gardes
& juges ordinaires dans les jurifdiétions établies
dans les provinces.
Jufqu’ en 1738, il a exiftê trente hôtels des
monnoies, où l ’on fabriquoit des efpèces, 8c auxquels
étoient attachées des jurifdiétions 3 mais au
mois de juin de cette même année, un édit fuppri-
ma la monnoie, en biffant firbfifter la jurifdiétion».
A u mois de février 1772- , un autre édit fup-
rima treize monnoies , dans les villes d’Amiens,
efançon, Bourges , C a en , Dijon , Grenoble,
Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Tours, Troies,
& Tou lou fe, en confervant les jurifdiétions
dans les villes j mais une déclaration du 2,2 fep-
tembre fuivant, rétablit celle de Touloufe j en
forte , qu’il exifte toujours le nombre de trente
jurifdiélions des monnoies, 8c feulement dix-fept
hôtels où l’on fabrique. C e font A ix , Bayonne,
Bordeaux, la Rochelle , L ille , Limoges, L y on ,
M e t z , Montpellier, Nantes, Orléans, Paris,
Pati, Perpignan, R ou en, Strasbourg, T ou loufe.
En conféquence de l’article 1 2 , de l’édit du
mois de février 1772, on ne peut être pourvu
d’aucun office dans les monnoies, fans l’agrément
du miniftre des finances.
Pour avoir au furplus des connoiffances exactes
de tout ce qui concerne Tadminiftration des
monnoies ; leur fabrication , . leur titre, 8c même
la valeur des efpèces étrangères, comparées aux
nôtres , on né peut mieux faire que de confulter
l’almanach des monnoies, pour les années 1785 8c 1786. C ’eft l’ouvrage d’un homme d’efprit,
qui connoît parfaitement ce département auquel
il eft attaché, & qui a eu le talent de préfenter
l’inftrudion fous une forme auffi agréable qu’amu-
fante.
M onnoie des M édailles. Etablifiement
fait en 15^0, pour fabriquer des efpèces jufqu’en
17 cy } qu’il fut confaçré à la feule fabrication des
jetons 8c des médailles.
L’édit de juin 1696 , article 1 7 , défend de fabriquer
ou faire fabriquer aucuns jetons , médailles
, ou pièces de plaifir, d’o r , d’argent ou
d ’autres métaux , ailleurs qu’en la monnoie des me-
' dailles, à peine de confifcation des outils.& matiè
res , 8c de mille livres d’amende contre chacun
des contrevenans.
Les médailles d’or fé paient à la monnoie des
médailles (en 178 y) , àraifon de huit cent vingt-
quatre livres le marc, 8c les jetons ronds à huit
cent huit livres le marc.
C e prix eft indépendant de celui des quarrés
qui fe payent au graveur, fuivantda nature de fon
travail.
Les médailles 8c les jetons d’argent à Paris,
font de foixante - treize livres le marc ; les jetons
ronds, cinquante-fept livres quinze fols le marc.
Le prix des médailles de bronze, varie félon
leur diamètre.
..Quant aux tribunaux qui ont connu anciennement,
,8c qui connoiffent des délits relatifs aux
monnoies. Voyez le Dictionnaire de Jurifprudence,
Il fuffit de dire qu’il n’exifte plus dans le royaume
de cour fouveraine des monnoies, qu’à Paris, 8c que
fa compofition a été fixée par l’édit du mois de
juillet 1778.
M O N O P O L E , f. m ., ce terme vient de deux
mots grecs , qui lignifient vendre feul. On a donne
ce nom au trafic ou commerce exclufif d’une mar-
chandife fait par un feul particulier j en forte qu’il
eft Je maître d’y mettre le prix que règle fa cupidité.
En général, le mot de monopole ne fe Pr e ,
qu’en mauvaife part 8c emporte toujours 1 idee
d’un trafic odieux, foit qu’il appartienne à un feul,
foit qu’il ait été concédé à une compagnie, parce
que l’effet en eft conftamment Je même ^ celui de
la cherté des marchandifes, qui font j objet de
ce trafic. Il eft fenfible que la liberté d’ en vendre
étant générale, la concurrence des vendans tour-
neroit au bénéfice des acheteurs. On n’a pas d e -
xemple que le monopole d’une denree ait jamais
produit autre chofe que le bien particulier de celui
qui- eft autorifé à l’exercer.
Chez les Romains, le crime de monopole étoit
puni par la confifcation de tous les biens-, 8c un
exil perpétuel, comme on le voit par la loi unique
, au code de monopoliis.
Dans tous les tems 8c dans tous les Etats, il y
a eu des loix pour réprimer le monopole des particuliers
; mais les fouverains fe font attribués le
droit de le faire, fur différentes denrées néceffaires
à,, la vie.
Il eft un monopole, 8c peut-êrre le feul qu’ un
Etatpourroit exerceravec autant de gloire que d’avantages
î c’eft celui des grands talens dans tous
les genres., & la France a de grandes facilités à
cet égard 5 les dons variés de la nature, un climat
favorable, un gouvernement modéré, des couronnes
d’ opinion & de vanité qu’on y fait fi bien faire
; & fi bien donner ; que faut-il de plus pour attirer
les hommes ; & fi l’on joint à ces jouiffances, des
largeffes de la part du fouverain, il eft peu d’hommes
fupérieurs en Europe, qui ne s’emprefsât
d’accourir aux invitations qui lui feroient faites
defe fixer, ou au moins de féjourner quelque tems
dans un pays fi agréable.
Ecoutons fur ce fujet un miniftre des finances,
celui q u i, de tous ceux que nous avons vus , a
fait le plus d’économies, dirigées par l’amour du
bien public.
« Les miniftres des finances les plus auftères 8c
*>. les plus étrangers aux plaifirs du monde, ne 1m doivent point réfifter aux .petits facrifices nécef-
« faires, pour attirer en France les compofiteurs
m célèbres , 8c pour y retenir les talens qui bril-
V i j