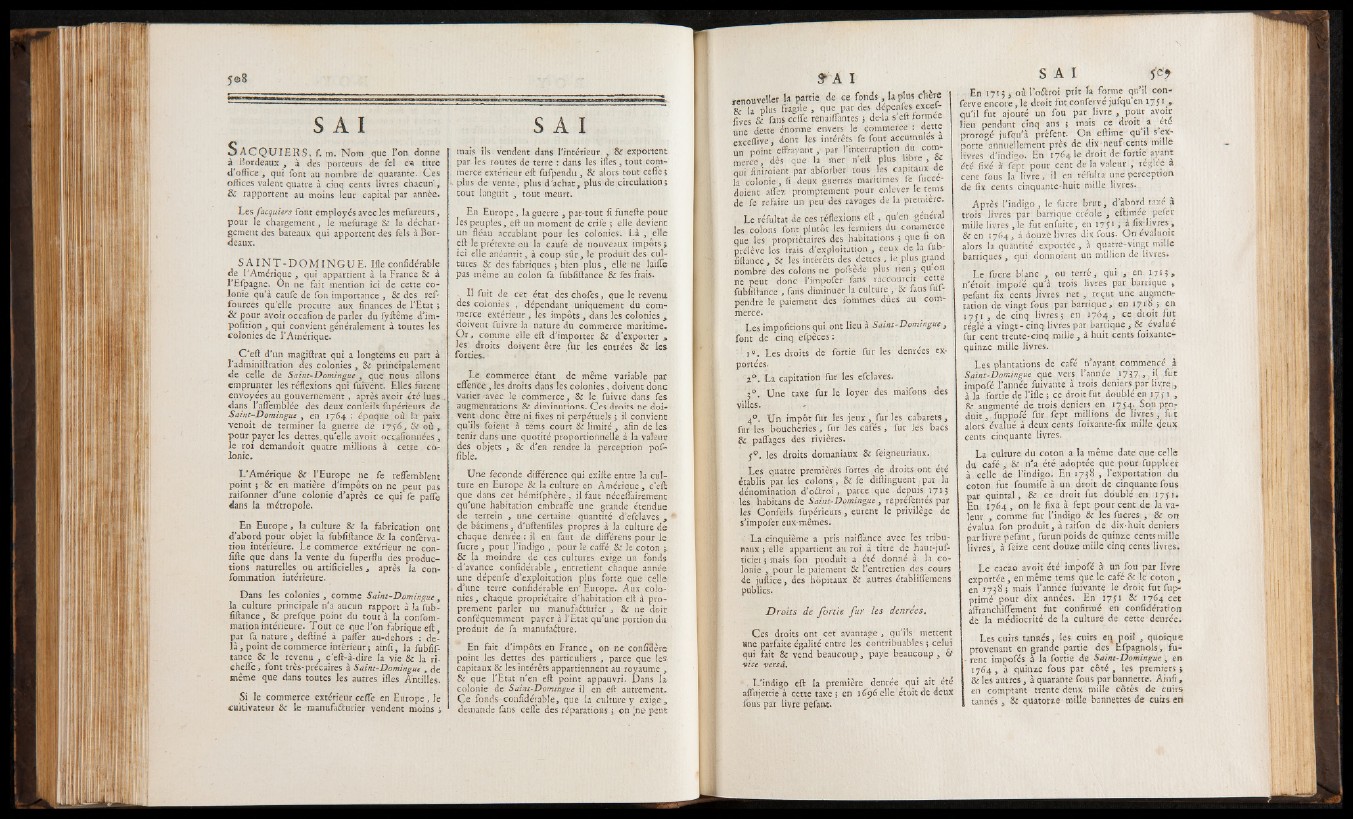
j®8
S A I S A I
S a C Q U I E R S , f. m. Nom que Ton dorme
Bordeaux , à des porteurs de Tel m titre
d’office , qui font au nombre de quarante. Ces
offices valent quatre à cinq cents livres chacun ,
& rapportent au moins leur capital par année.
Les /acquiers font employés avec les mefureurs,
pour le chargement, le mefurage & le déchargement
des bateaux qui apportent des fels à Bordeaux.
S A I N T - D O M I N G U E . Ifle considérable
de 1 Am é r iq ue , qui appartient à la France & à
l ’Efpagne. On ne fait mention ici de cette colonie
qu'à caufe de fon importance , & des ref-
fources quelle procure aux financés de l'Etat » 8c pour avoir occafion de parler du fyftême d’im-
pofition, qui convient généralement à toutes les
colonies de l ’Amérique.
C ’ eft d'un magiftrat qui a longtems eu part à
J’adminiftration des colonies , 8c principalement
de celle de Saint-Domingue , que nous allons
emprunter les réflexions qui fuivént. Elles furent
envoyées au.gouvernement, après avoir été lues
dans l’ aflfemblée des deux confeils Supérieurs de
Saint-Domingue 3 en 17 6 4 : époque ou la paix
venoit de terminer la guerre de i ? f 6 , & o ù ,
pour payer les dettes.qu’elle avoir occafionnées,
le roi demandoit quatre millions à cette colonie.
L ’Amérique 8c l’Europe ne fe reflemblent
point j & en matière d’impôts on ne peut pas
xaifonner d’une colonie d’après ce qui fe pafle
dans la métropole.
En Europe, la culture & la fabrication ont
d’abord pour objet la fubfiftance & la conferva-
tioa intérieure. Le commerce extérieur ne con-
fifte que dans la vente du fuperflu des productions
naturelles ou artificielles , après la con-
fommation intérieure.
Dans les colonies , comme Saint-Domingue
la culture principale n’a aucun rapport à la fub-
fiftance, & prefque point du tout à la confom-
mation intérieure. Tout ce que l’on fabrique eft
par fa nature, deftiné à palier au-dehors : delà
, point de commerce intérieur 5 ainfi, la fubfif-
tance 8c le revenu , c ’eft-à-dire la vie & la ri-
chelfe, font très-précaires à Saint-Domingue x de
même que dans toutes les autres ifles Antilles.
Si le commerce extérieur cefife en Europe, le
cultivateur & le manufacturier vendent moins »
mais ils vendent dans l’intérieur., 8c exportent
par les routes de terre : dans les ifles, tout commerce
extérieur eft fufpendu, & alors tout celle;
plus de vente, plus d ’achat, plus de circulation,
tout languit , tout meurt.
En Europe, la guerre , par-tout fi funefte pour
les peuples,.eft un moment de crife ; elle devient
un fléau accablant pour les colonies. Là , elle
ell le prétexte ou la caufe de nouveaux impôts 5.
ici elle anéantit, à coup sûr, Je produit des cultures
& des fabriques ; bien plus, elle ne laifîe
pas même au colon fa fubfîftance 8c fes frais.
-- U Elit de cet état des chofes, que le revenu,
des colonies , dépendant uniquement du commerce
extérieur, les impôts, dans les colonies ,
doivent fuivre la nature du commerce maritime.
O r , comme elle elt d’importer 8c d’exporter *
les droits doivent être fur les entrées & les
for des.
Le commerce étant de même variable par
enence, les droits dans les colonies, doivent donc
varier avec le commerce, & le fuivre dans fes
augmentations & diminutions. Ces droits ne doivent
donc être ni fixes ni perpétuels 5 il convient
qu’ils foient à tems court 8e limité , afin de les
tenir dans une quotité proportionnelle à la valeuir
des objets , 8c d’en rendre la perception pof*
lible.
Une fécondé différence qui exilte entre la culture
en Europe & la culture en Amérique, c’eft
que dans cet hémifphère, il faut nécelfairement
qu’une habitation embrafle une grande étendue
de terrein , une certaine quantité d’efclaves , *
4e bâtimens, d’uftenfiles propres à la culture de
chaque denrée : il en faut de différens pour le
fucre , pour l’indigo , pour le caffé 8c le coton j,
& la moindre de ces cultures exige un fonds
d ’avance confidérable, entretient chaque année
une dépenfe d’exploitation plus forte que celle,
d’ une terre confidérable en'Europe. Aux colonies
, chaque propriétaire d’habitation eft à proprement
parier un manufacturier , & ne doit
conféquemment payer à l’Etat qu’ une portion du
produit de fa manufacture.
En fait d’impôts en France, on ne conficlère
point les dettes des particuliers , parce que les
capitaux & les intérêts appartiennent au royaume ,
& que l’Etat n’en eft point appauvri. Dans la-
colonie de Saint-Domingue il en eft autrement.
C e fonds confidérable, que la culture y exige,
demande fans celle des réparations 4 on [ne peut
» A I
renouveller U partie de ce fonds, lapins chère
& la plus fragile, que par des depenies excelfives
& fans celle renailfantes ; de-là s eft formée
Une dette énorme envers le commerce : dette
exceffive, dont les intérêts fe font accumules a
un point effrayant, par l’interruption du commerce
, dès que la mer n’eft plus lib re , oc
qui finiroient par abforber tous les capitaux de
la colonie , fi deux guerres maritimes fe fucce-
doient allez promptement pour enlever le tems
de fe refaire un peu des ravages de la première;
Le léfultat de ces réflexions eft , qu’en général
les colons font plutôt les fermiers du commerce
que les propriétaires des habitations > que fi_on
prélève les frais d’exploitation , ceux de la fubfiftance
, 8c les intérêts des dettes , le plus grand
nombre des colons ne pofsède plus rien ; qu on
ne peut donc l’impofer fans raccourcir eette
fubfiftance , fans diminuer la culture / 8c fans fuf-
pendre le paiement des fommes dues au coin- .
merce.
Les impofitions qui ont lieu à Saint-Domingue ,
font de cinq efpèces :
i ° . Les droits de fortic fur les denrées exportées.
2°. La capitation fur les efclaves.
3°. Une taxe fur le loyer des maifons des
villes.
4°. Un impôt fur les jeux, fur les cabarets,
fur les boucheries, fur les cafés , fur les bacs
& pa!Tages des rivières.
les droits domaniaux 8c feigneuriaux.
Les quatre premières fortes de droits ont été
établis par les colons , & fe diftihguent par la
dénomination d’ oCtroi , parce que depuis 1713
les habitans de Saint-Domingue , repréfentés par
les Confeils fupérieurs, eurent le privilège de
s’impofer eux-mêmes.
La cinquième a pris nailfance avec les tribunaux
j elle appartient au roi à titre de haut-juf-
ticiei j mais fon produit a été donné à la colonie
, pour le paiement & l’entretien des cours
de juftice, des hôpitaux 8c autres établilfemens
publics.
D r o its de /ortie fu r les denrées.
Ces droits ont cet avantage , qu’ ils mettent
une parfaite égalité entre les contribuables ; celui
qui fait & vend beaucoup, paye beaucoup, &
vice versa.
L ’indigo eft la première denrée qui ait ete
aflujettie â cette taxe > en 1696 elle étoitde deux
fous par livre pefant:.
S A I j e?
En 1713 j où l ’oCtroi prit îa forme qu’il con-
ferve encore, le droit fut.conferve jufqu en 1751»
qu’il fut ajouté un fou par l iv r e , pour avoir
fieu pendant cinq ans ; mais ce droit a tté
prorogé jufqu’à préfent. On eftime qu il s exporte
annuellement près de dix-neuf cents mille
livres d’indigo. En 1764 le- droit de fortie ayant
été fixé à fept pour cent de la valeur , réglée a
cent fous la livre , il en refait a une perception
de fix cents cinquante-huit mille livres. .
Après l’indigo, le fucre brut, d’abord taxe a
trois livres par barrique créole , eftinlée pefer
mille livres , 1e fut enfuite, en 1751 j a fix-livres^
& en 1764, à douze livres dix fous. On évaluoic
alors la quantité exportée , à quatre-vingt mille
barriques, qui donnoient un million de livres.
Le fucre blanc , ou terré, qui , en. 171
n’étoit imposé qu’à trois livres par barrique ,
pefant fix cents livres n e t , reçut une augmentation
de vingt fous par barrique, en 17118 j en
1 7 5 1 , de cinq- livres; en 1764 , ce dioit fut
réglé à vingt - cinq livres par barrique , 8c évalué
fur cent trente-cinq miiie, à huit cents foixante-
quinze mille livres.
Les plantations de café n’ayant commencé à
Saint-Domingue que vers l’année 1737,,. il fut
impofé l’année fui vante à trois deniers par liyre-,
à la fortie de l’ifle ; ce droit fut doublé en 1751 ,
& augmenté de trois deniers en I7J 4-. Sc$n prod
u it, fuppofé fur fept millions de livres , fat
alors évalué à deux cents foixante-fix mille deux
cents cinquante livres.
La culture du coton a la même date que celle
du c a fé , 8c n’ a été adoptée que pour fuppléer
à celle de l ’indigo. En 17 38 , l’exportation du
coton fut foumife à un droit de cinquante fous
par quintal, 8c ce droit fut doublé en. 1751 i
En 17 6 4 , on le fixa à fept pour cent de la valeur
, comme fur l’indigo & les fucres,, & on
évalua fon produit, à raifon de dix-huit deniers
par livré pefant, furun poids de quinze cents mille
livres, à feize cent douze mille cinq cents livres.
Le cacao avoit été impofé à un fou par livre
exportée, en même tems que le café & le coton ,
en 1738 ; mais l’année fuivante le droit fut fup-
primé pour dix années. En 1751 8c 1764 cet
affranchiflement fut confirmé en confédération
de la médiocrité de la culture de cette denrée.
Les cuirs tannés, les cuirs et\ poil , quoique
provenant en grande partie des Efpagnols, fu-
- rent impofés à la fortie de Saint-Domingue , en
17 6 4 , à .quinze fous par c ô t é , les premiers ; 8c les autres, à quarante fous par bannette. Ainfi ,
en comptant trente deux mille côtés de cuirs
tannés , & quatorze mille bannettes de cuks en