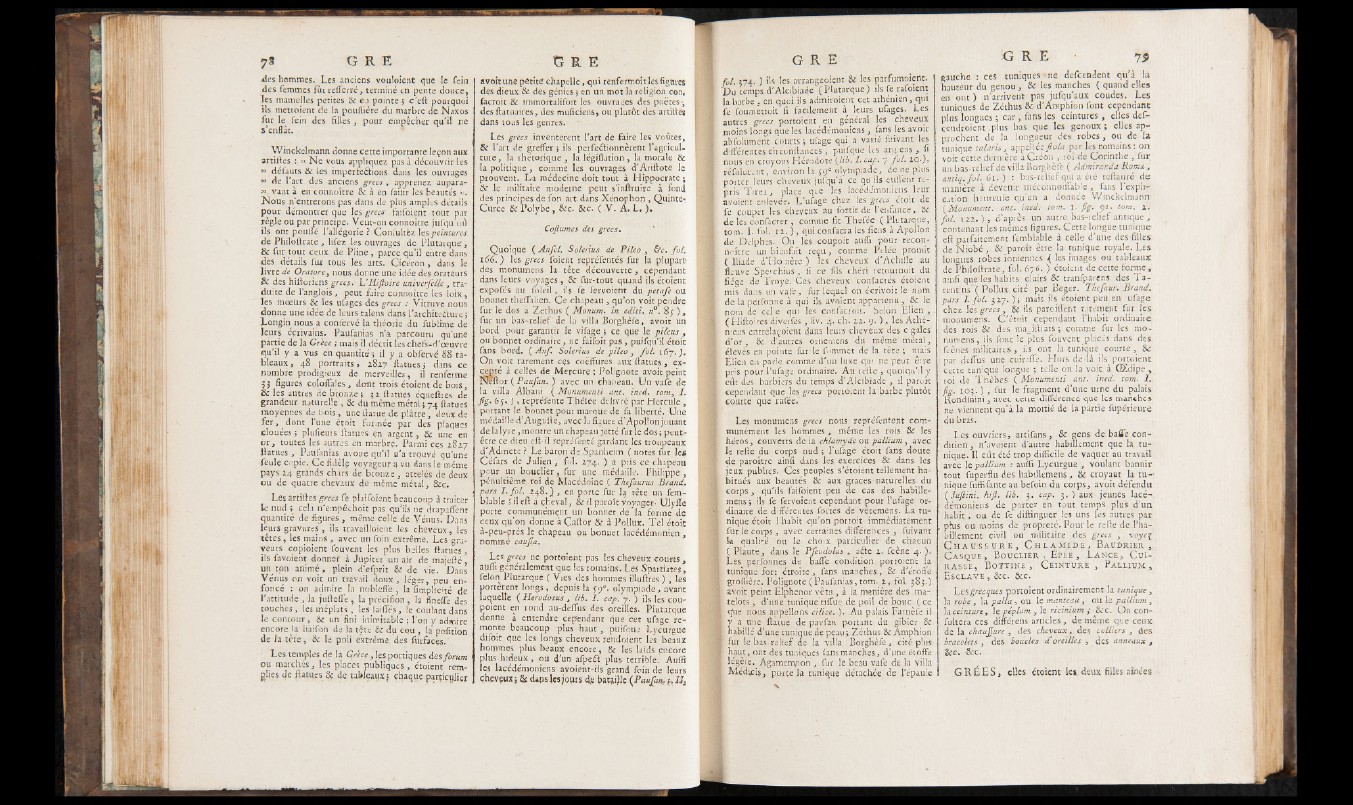
des hommes. Les anciens vouloient que le fein
des femmes fût refferré, terminé en pente douce,
les mamelles petites & en pointe ; c'eft pourquoi
ils mettoient de la pouffière du marbre de Naxos
fur le fein des filles, pour empêcher qu'il ne
s’ enflât.
Winckelmann donne cette importante leçon aux
artiftes : « Ne vous appliquez pas à découvrir les
« délauts & les imperfections dans les ouvrages
de l'art des anciens grecs, apprenez aupara-
*>, vant à en connoître & à en faiiir les beautés
Llous n’entrerons pas dans de plus amples détails
pour démontrer que les grecs faifoient tout par
règle ou par principe. Veut-on connoître jufqu où
ils ont poulie l ’allégorie? Confultèz les peintures
de Philollrate, lifez les ouvrages de Plutarque,
& fur-tout ceux de Pline, parce qu’il entre dans
des détails fur tous les arts. Cicéron , dans le
livre de Oratore, nous donne une idée des orateurs
3c des hifioriens grecs. L.3HiJtoire univerfelle , traduite
de l’anglois, peut faire connoître les loix,
les moeurs & les ufages des grecs : Vitruve nous
donne une idée de leurs talens dans l’architedture ;
Longin nous a conlèrvé la théorie du fubliirie de
îeurç. écrivains. Paufanias n’a parcouru qu’une
partie de la Grèce ; mais il décrit les chefs-d’oeuvre
qu’il y a vus en quantité ; il y a obfervé 88 tableaux,
48 portraits » 28*7 ftatues; dans ce
nombre prodigieux de merveilles, il renferme
33 figures coloflales, dont trois étoient de bois,
& les autres de bronze 5 3 2 ftatues équeftres de
grandeur natureHe , & du même métal ; 74 fiatues
moyennes de bois , une ftatue de plâtre , deux de
fe r , ^ dont l'une étoit formée par des plaques
plouées ; plufieurs ftatues çn argent, & une en
o r , toutes les autres en marbre. Parmi cçs 2827
llatues , Paufanias avoue qu’ il n’a trouvé qu’une
feule copie, Ce fidèle voyageur a vu dans le même
pays 24 grands chars de bronze , attelés de deux
ou de quatre chevaux de même métal, &c.
Les artiftes grecs fe plaifolent beaucoup à traiter
le nud î cela n’ empêchoit pas qu’ils ne drapaffent
quantité de figures , même celle de Vénus. Dans
leurs gravures, ils travaillent les cheveux, les
tê te s , les mains , avec un foin extrême. Les graveurs
copioient fouvent les plus belles ftatues,
ils favoient donnef à Jupiter-un air de majefté,
un ton animé, plein d’efprit & de vie. Dans
Vénus on voit un travail doux, léger, peu enfoncé
: on admire la nobleflfe, la fimplieté de
l ’attitude, la jufteffe , la préeifiôn , la fineffe des
touches , les méplats, les laiffés, le coulant dans
le contour, & un fini inimitable : l’on y admire
encore la liâifon de la tête 8è du cou , la pofition
de la tê te , & le poli extrême, des furfaces.
• Les temples de la Çrèce, les portiques des forum
ou marchés, les places publiques, étoient remplies
4e ftatues & de-tableaux^ chaque parpçuliçr
avoit une petite chapelle, qui renfermoîtles figures
des dieux & des génies} en un mot la religion con.
facroit & immortalifoit les ouvrages des poètes-,
des ftatuaires, des muficiens» ou plutôt des artiftes
dans tous les genres. ■*
Les grecs inventèrent l'art de faire les voûtes,
& l’art de greffer} ils perfectionnèrent l’agriculture,
la rhétorique, la légiflation, la morale &
la politique, comme les ouvrages d’Ariftote le
prouvent. La médecine doit tout à Hippocrate ;
& le militaire moderne peut s’instruire à fond
des principes de fon art dans Xénophon, Quinte^.
Curce &: Polybe, &c. &c. ( V . A. L. )*.
Cof urnes des grecs.
Quoique ( Atifel. Solerius de Piled , &c. fol.
166.) les grecs foîent repréfentés fur la plupart
des monumens la tête découverte, cependant
dans leurs voyages * & fur-tout quand ils étoient
expofés au foleil, ils fe fervoient du petafe ou
bonnet theffalien. Ce chapeau , qu’ on voit pendre
fur le dos à Zéthus ( Monum. in edUi. n°. 8 y ) ,
fur un bas-relief'de la villa Borghèfe, avoit un
bord pour garantir le vifage } ce que le piteus ,
ou bonnet ordinaire, ne faifoit pas, puifqu’il étoit
fans-bord. (- A n f Solerius de pileo , fol. 167. ).
On voit rarement cçs coëffures aux ftatues , excepté
à celles de Mercure ; Polignote avoit peint
Neftor ( Paufan. ) avec un chapeau. Un vafe de
la villa Albaiii ( Monu,menti ant. ined. tom, I.
fg- 6 ) * repréfente Théfée délivré par Hercule,
portant le bonnet pour marque de fa liberté. Une
médaille d’Augulte, avec la figure d’Apollon jouant
de la lyre, montre un chapeau jette fur le dos ; peut-
être ce dieu^ll- il repréfenté gardant les troupeaux
d’Admete ? Le baron de Spanheim ( notes fur le*
Céfars de Julien , fol. 274. ) a pris ce chapeau
pour un bouclier, fur une médaillé. Philippe,
pénultième roi de Macédoine ( Tkefaurus Brand.
pars J. fol. 2 4 8 .} , en porte fur la tête un fem-
blable > il eft à çbeval, & il paroîc voyager- UJyffe
porte communément un bonnet de la forme de
ceux qu’on donne à Çaftor & à Pollux. Te l étoit
à-peu«près le chapeau qu bonnet lacédémonien ,
nommé cap.fla^
Les grecs ne portoient pas les cheveux courts ,
auflî généralement que les romains. Les Spartiates,
félon Plutarque ( Vies des hommes illuftres ) , les
portèrent longs, depuis la 59e. olympiade , avant
laquelle ( Herodotus , lié. Jf. cap. 7. ) ils les cou-
poient en rond au-deffus des oreilles. Plutarque
donne à entendre cependant que cet ufage remonte
beaucoup plus haut, puifqu; Lycurgue
difoit .que les longs cheveux rendoient les beaux
hommes plus beaux encore, & les laids encore
plus hideux, ou d’un afpeél plus terrible. Auffi
les lacédémoniens avoient-ils grand foin de lçurs
cheveux; & dans les jours dp babille (Paufanr^ l i 9
t fol. 574. ) ils les arrangeoient & les parfumoient. I Du temps d’Alcibiade (Plutarque) ils fe rafoient I la barbe, en quoi ils admiroient cet athénien, qui
I fe foumèttoit fi facilement i leurs ufages. Les I autres grecs portoient en général les cheveux
K moins longs que les lacédémoniens, fans les avoir
| abfolùment courts; ufage qui a varié fuivant les
K différentes circonftances , puifque les arg.ens , fi
■ nous en croyons Hérodote {lié. I- cap. 7 fol. 20-),
I réfoluivnt, environ h 5.9e olympiade^ de ne p.us
I porter leurs cheveux jufqu’ à ce qu'ils enflent re-
■ pris Tirea , place que les • lacédémoniens ; leur
| avoient enlevée. L ’ufagé chez \es grecs étoit de
K fe couper les cheveux au Sortir de l’eiifance, &
B de les confacrer, comme fit Thefée ( Plutarque,
B tom. I. fol. 12. ) , qui confaçra les fiens a Apoilpn B de Dclphesi On les coupôit aufli pour recon- B nrître un bienfait reçu, comme Pelée promit
I ( Iliade d’Homère ) les cheveux d’Achille au B fleuve Sperchius, fi ce fils chéri retoutnoit du
■ fiége de Troye. Ces cheveux confacrés étoient
■ mis dans un vafe, fur lequel dn écrivoit le nom
I de la pèrfonne à qui ils avaient appartenu , le
I nom de cel e qui les confacroit. Selon Elien ,-
■ ( Hiftoires diveifes, liv. 4. ch. 22. 9. ) , les Athé-
I mens entrelaçoient dans leurs cheveux des c gales
■ d’o r , & d’autres Ornemens du même métal,
■ élevés en pointe furie fommet de la tête; mais
■ Elien en parle comme d’un luxe qui ne peut erre
■ pris pour l’ ufage ordinaire. Au relie , quoiqu’il y
I eût des barbiers du temps d’Alcibiade , il paraît
■ cependant que les grecs portoient la barbe plutôt
■ courte que rafée.
Les monumens grecs nous repréfentent com-
■ munément les hommes, même les rois & les
■ héros, couverts de la chlamyde ou pallium3 avec
■ le relie du corps nud '} i’ ufage étoit fans doute
■ de paroître ainfi dans les exercices & dans les
K jeux publics. Ces peuples s’étoiént tellement ha-
J bitués aux beautés & aux grâces naturelles du
B corps, qu’ils faifoient peu de cas des habille-
■ mens ; ils fe fervoient cependant pour l’ufagei or-
B dinaire de d:fférentes.foi'tes de vetemens. La tu-
B nique étoit l’habit, qu’on portoit immédiatement
H fur lë corps , avec certaines différences , fuivant
B k qualité ou le choix particulier de chacun
B ( Plaute, dans le Pfeudolus, a6le 2. fcène 4. ).
B Les perfonnes de baffe condition portoient la
B tunique fort étroite, fans manches, & d’étoffe
B gtoflière. Polignote (Paufanias, tom. 2, fol. 383.).
B avoit peint Elphenor vêtu , à la manière des .ma-
B telots, d’une tunique tiffue de poil de bouc ( ce
B nous appelions cilice.). Au palais Farnèi’e il
B y a une ftatue de payfan portant du gibier &
B habillé d’une tunique de peau; Zéthus & Amphion
B fur le bas-relief de la villa Borghèfe, cité plus
B haut, ont des tuniques fans manches, d’une étoffe
B légère. Agamemnon , fur le beau vafe de la villa
B Médicis, porte la tunique détachée de l’épaule
gauche : ces tuniques »ne defeendent qu’ à la
hauteur du genou , & les manches ( quand elles
en ont ) n'arrivent pas jufqu’aux coudes. Les
tuniques de Zéthus & d'Amphion font cependant
plus longues ; ca r , fans les ceintures, elles def-
cendroient .plus bas que les genoux; elles approchent
de la longueur des robes, ou de la
tunique talaris, appel!ésjîola par les romains : on
voit cette dernière àCréon roi'de Corinthe , fur.
un bas-relief de villa Borghèfe ( Admiranda Roma ,
antia. fol. 6 1 .) ■ bas-relief qui a été reftauré de
manière à devenir méconnoiffable, fans l'exph-
Cation heuteufe qu'en a donnée Winckelmann
(Monument, ant. ined: tom. î. fig. 91. tom. 1.
fol. t r a i te , d'après un autre bas-relief antique ,
contenant les memes figures. Cette longue tunique
eft parfaitement fcmblable à celle d'une des filles
de N io b é , & paraît être la tunique royale. Les
longues robes ioniennes ( les images ou tableaux
de Philoftrate, fol. 676. ) étoient de cette forme,
ainfi que-les ha.bits clairs & tranfparens des T a-
rentins^C Pollux cité par Be^er. Thcfaur. Brand.
pars I. fol. 3 1 7 .) ; mais ils etoient peu en ufage
chez les grecs, & ils. patoifient rarement fur les
monumens. C'étoit cependant l'habit ordinaire
• des rois & des ma .iftiats ; comme fur les mo-
: numens, ils fontie plus fouvent placés dans des
feenes militaires , ils ont la tuhique courte, &
; par defftis une cuir-rfife. Hors de-là ils portoient
cette tun'que longue ; telle on la voit à OEdipe ,
roi de Thèbes ( Monumenti ant. ined. tom. I.
fa . 103. ) , fut le fragment d’une urne du palais
Rondinini, avec cette différence que les manches
( ne viennent qu’ à la moitié de la partie fupéiieure
du bras.
Les ouvriers, artifans, & gens de baffe con-
1 dition, n'avoient d'autre habillement que l ï tunique.
Il eût été trop difficile de vaquer au travail
avec le pallium : auflt Lycurgue , voulant bannir
tout fuperflu des habillemens , & croyant la tunique
fuffifante au befoin du corps, avoit défendu
( Infini, hift. iii. 3. cap. 3 .-l aux jeunes lacé-,
démoniens de porter en tout temps plus d'un
habit f ou de fe diftinguer les uns les autres par
plus ou moins de propreté. Pour le refte de l'ha-,
billement civil ou militaire des grecs , voye^
C h a ü 's s u r e , C h l a Kid e , Baudrier,.
C asque, Bouclier , Épée , Lance, C uirassé,
Boïtine",: C einture , Pallium,
Esclave, &c. &c.
htsgrecques portoient ordinairement la tunique,
la robe., la palla , ou le manteau,■ ou le pallium,
IdiCeinture. le péplum , le, ricinium ,* & c . On con-
fultera ces différens articles, de même que ceux
de la chauffure , des cheveux, des colliers , des
bracelets , des boucles d.’ oreilles , des anneaux ,
& c . &c.
G R É E S , elles étoient le».deux filles aînées