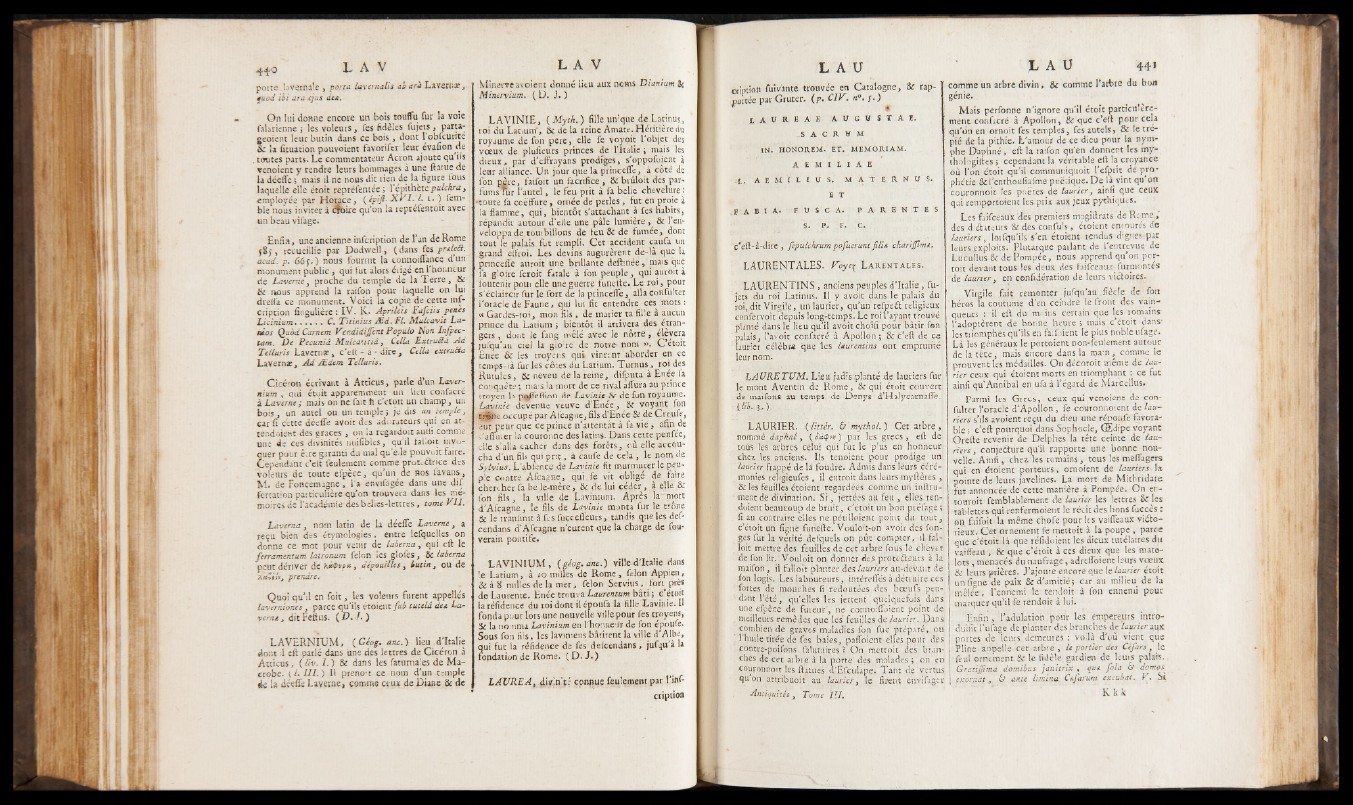
L A V
porte lavernale , porta laxernalis ai ara LaverfiX. ,
fuod i'bi ara ejus dea.
On lui donne encore un bois touffu fur la voie
falarienne ; les voleurs , fes fidèles fujets, parta-
geoient leur butin dans ce bois , dont l’obfcurite
& la fituation pouvoient favorifer leur evafion de
. toutes parts. Le commentateur Acron ajoute qu ils
venoient y rendre leurs hommages à une ftatue de
la déeffe > mais il ne nous dit rien de la figure fous
laquelle elle étoit repréfentéej l’épithète pulchra,
employée par Horace, (épijl. X V I . L i . ) fem-
ble nous inviter à dfbire qu’on la repréfentoit avec
un beau vifage.
Enfin, une ancienne infeription de l’an de Rome
5S5 , recueillie par Dodwell, ( dans fes pr&left.
acad. p. 66y .) nous fournit la connoiflànce d’un
monument public , qui lut alors érigé en 1 honneur
de Laver ne y proche du temple de la T e r re , &
& nous apprend la raifon pour laquelle on lui
dreifa ce monument. Voici la copie de cette infeription
fîngulière : IV. K. Aprileis Fafciis penes
Licinium............C. Titinius Æd. FL Mulcavit Lanios
Quod Carnem Vendidijfent Populo Non Injpec-
twn. De Fecuniâ. Mulcatitiâ, CelLi Extruétd Ad
Telluris Lavernx, c ’elt - à - dire , Ce lia extruéia
Lavernx , Ad Ædent Telluris.
Cicéron écrivant à Atticus, parle d’un Laver-
nium y qui étoit apparemment un lieu confacré
à Laverne j mais on ne fart fi c’étoit un champ, un
bois , un autel ou un temple 5 je dis un temple,
car fi cette déeffe avoit des adorateurs qui en attendaient
des grâces , on Sa regar-doit aulfi comme
une de ces divinités nuifibles, qu’ il falloir invoquer
pour ê;re garanti du mal qu’effe pouvait faire.
Cependant c’elt feulement comme prot-.Ctnce des
voleurs de toute efpèce, qû’ un^de nos lavans,
M . de Foncemagne, l a envifagée dans une d if
fcrtation particulière qu’on trouvera dans les mémoires
de l'académie des belles-lettres, tome VII.
Laverna, nom latin de la déeffe Laverne 3 a
reçu bien des étymologies, entre lefquelles on
donne ce mot pour venir de laberna, qui eft le
ferramentum latronum félon les glofes, & laberna
peut dériver de hxtyvf«, dépouilles, butin, ou de
prendre.
Quoi qu’ il en fo it, les voleurs furent appelles
lavemiones, parce qu'ils étoient fub tutelâ des. La-
v enu, dit Feftus. ( D .J . )
L A V E R N IU M , ( Géog, a ne. > lieu d'Italie
dont il eft parlé dans une des lettres de Cicéron à
Atticus, ( liv. 1. ) & dans les faturnales de Ma-
crobe. ( /. III. ) Il preno:t ce nom d’un temple
de la déeffe Laverne, comme ceux de Diane & de
L A V
Minerve àvoient donné lieu aux noms Dianium 8c
Minervium. ( D. J. )
L A V IN IE , ( Mytk. ) fille unique de Latinus,
I toi du Latium’, & de la reine Amate. Héritière du
royaume de fon pere, elle fe voyoit l’objet des
voeux de plufieurs princes de l’Italie ; mais les
dieux, par d’ effrayans prodiges, s’oppofoient à
leur alliance. Un jour que la princeffe, à côté de
fon père, faifoit un facrifice , & brûloit des parfums
Tur l'autel, le feu prit à fa belie chevelure :
-toute fa ccëffure, ornée de perles, fut en proie à
la flamme, qui, bientôt s’attachant à fes habits,
répandit; autour d’elle une pâle lumière & 1 enveloppa
de touibillons de leu & de fumee, dont
tout le palais fut rempli. Cet accident caufa un
,grand effroi. Les devins augurèrent de-là que la
princeffe auroit une brillante deftmée, mais que
fa gloire feroit fatale à fon peuple, qui auro.t a
foutenir pour elle une guerre funeite. Le roi, pour
s'éclaircir fur le fort de la princeffe, alla confultet
l’oracle de Faune, qui lui fit entendre ces^ mots :
« Gardes-toi, mon fils, de marier ta fille à aucun
prince du Latium ; bientôt il arrivera des étran-
; gers, dont le fang mêlé avec le nôtre, élèvera
: jufqu’au ciel la glo’re de notre- nom ». C ’etoit
; Enée & les troyens qui vinrent aborder en ce
temps-ià fur les côtes du Latium. Turnus, roi des
Rutules, & neveu de la reine, difputa à Enee fa
conquête *, mais la mort de ce rival affura au prince
croyen la p^feflion de Lavinie & de fon royaume.
I Lavinie devenue veuve d'Enée, & voyant fon
ggfeil occupé par Alcagne, fils d’Enée & de Creufe,
eut peur que ce prince n’attentât à fa vie , afin de
s'affin er ia couronne des latins. Dans cette penfée,
elle s’alla cacher dans des forêts, où elle accoucha
d'un fils qui p r it, à caufe de cela L le nom de
Sylvius. L'abfence. de Lavinie fit murmurer le peuple
contre Afcagne, .qui fe vit obligé de faire
chercher fa be.le-mère, & de lui céder, à elle &
ton fils, la ville de Lavinium. Après la'mort
d'Afcagne, le fils de Lavinie monta fur le trône
& le tranfmjt à fes fucceffeurs, tandis que les def-
cendans d’Afcagne n'eurent que la charge de fou-
verain pontife.
L A V IN IU M , ( géog.anc.) ville d’Italie dans
!e Latium, à xo milles de Rome, félon Appien,
& à 8 milles de la mer, félon Servius, fort près
de Laurente. Enée trouva Laurentum bâti ; c'étoit
la réfidence du roi dont il époufa la fille Lavinie. Il
fonda pour lors une nouvelle ville pour fes troyens,
1 Sc la nomma Lavinium en l'hooneii'r de fon epoufe.
Sous fon fiis, les lavimens bâtirent la ville d’Albe,
qui fut la réfidence de fes defeendans, jufqu’ à la
j fondation de Rome. ( D . J.)
1 LAURE A , div’t ù é connue feuleipent par l ’infcription
L A U
criptton fuivante trouvée en Catalogne, & rapportée
par Gruter. (p, CIV, n°, $•)
L A U R E A E A U G U S T A E . !
_S A C R W M
IN. HONOREM. ET. MEM O R IAM .
A E M I L I A E
;1 . A E M I L I U S . M A T E R N U S .
E T
A B I A* F U S C A. P A R E N T E S
|S, P- F. ! C.
c’ eff-à-dire , fepulchrum pofuerunt filis. charijjims,
LAURENTALES. Voyeç Larèntales.
LAUR EN TINS , anciens peuples d’ Italie, fujets
du roi Latinus. Il y avoit dans le palais du
roi, dit Virgile, un laurier, qu’un refpeél religieux
confervoit depuis long-temps. Le roi l ’ayant trouvé
planté dans le lieu qu’il avoit çhoîfî pour bâtir fon
palais, l’avoit confacré à Apollon ; .Ékc’eftde ce
laurier célèbre que les Uurentins ont emprunté
leur nom.
LAURETUM. Lieu jadis planté de lauriers finie
mont Aventin de Rome, & qui étoit couvert
de maifons au temps de Denys d’Halycarnaffe.
3>).
LAURIER. ( lit ter. & mythol. ) Cet arbre,
nommé daphné, ( ) par les grecs, eff de
tous les arbres celui qui fut le p'us en honneur-
chez les anciens. Ils tenoient pour prodige un;
laurier frappé de la foudre. Admis dans leurs céré-:
rnonies religieufes , il entroit dans leurs myffères ,
& les feuilles étoient regardées comme un inffru-
mentde divinatioiiv S i, jettées au feu , elles ren-
.doiënt beaucoup de briiit, c’étoit un bon préfage;
fi au contraire elles ne pétilloient point du tout,
c’étoit Un figtié furieffe. Vouloit-on avoir des îon-i
ges fur la vérité defquels on pût compter, il falloit
mettre des feuilles de cet arbre fous lé chevet
de fon lit. Vouloit on donner des protecteurs à la
maifon, il falloit planter des lauriers au-devant de
fon logis. Les laboureurs, intérefies à détruire ces
fortes de mouches fi redoutées des boeufs pendant
l’été, qu’elles les iectent quelquefois dans
une efpèce de fureur, né connoiffoient point de
meilleurs remèdes que les feuilles de laurier. Dans
combien.de grave-s maladies fon fuc préparé, ou
1 huile tirée dé fes baies, paffoient-elles pour des
contre-poifôns falutaires ? On mettoit des/ branches
de cet arbre à la porte des malades ; on en
couronnoit les ftatues d’Efculape. Tant de vertus
qu on attribuoit au laurier, le firent envifiger
Antiquités , Tome I I I ,
%, A U 4 4 »
comme un arbre divin > & comme l’arbre du bon
génie.
Mais perfonne n’ignore qu’il étoit partîcuîere-
ment confacré à Apollon, ôc que c’eit pour cela
qu’ôn en ornoit fes temples, fes autels, & le tre-
pié de la pithie. L ’amour de ce dieu pour la nymphe
Daphné > eft la raifon qu’en donnent les my-
thôlogiftes ; cependant la véritable eft la croyance
où l’on étoit qu’il communiquoit l’efprit dé prophétie
& l’enthoufiafme pcërique. D e là vint qu on
couronnoit les poètes de laurier3 ainfi que ceux
qui rempprtoient les prix aux jeux pythiques.
Les faifeeaux des premiers magiftrats de Rome,
des dictateurs & des confuls, étoient entoures de
Lauriers, lorfqu’ils s’en étoient rendus d’gnes-par
: leurs,.exploits. Plutarque parlant de l’entrevue de
Lucuîlus & de Pompée, nous apprend qu’on per-
toit devant tous les deux des faifeeaux furmontes
de laurier3 en çonfidération de leurs victoires.
1 Virgile fait remonter jufqu’au fiècle de fon
. héros la coutume d’en ceindre le front des vainqueurs
; il eft du moins certain que les romains-
l'adoptèrent de bonne heure ; mais c’étoit dansr
les triomphes qu’ils en faifoient le plus noble ufage.
Là les généraux le portoient non-feulement autour
de la tê te , mais encore dans la ma;n, comme le
prouvent les médailles. On décoroit même de laurier
ceux qui étoient morts en triomphant : ce fuc
ainfi qu’Annibal en ufa à l’égard de Marcellus.
Parmi les Grecs, ceux qui venoient de con-
fulter I’oraclé d’Apollon, fe couronnoient de lauriers
s Us avoientreçu du dieu une réponfe favorable;
c’eft pourquoi dans Sophocle, CÈdipe voyant
Orefte revenir de Delphes la tête ceinte de lauriers
, conjecture qu’il rapporte une bonne nouvelle.
Ainfi, chez les romains, tous les meffagers
qui en étoient porteurs, ornoient de lauriers■ la
pointe de leurs javelines. La mort de Mithridate
fut annoncée de cette manière à Pompée. On er-
touroit femblablement de laurier les lettres & les
tablettes qui renfermoient le récit des bons fuccès :
on, faifoit la même chofe pour les vaiffeaux victorieux.
Cet ornement fe mettoit à la poupe, parce
que c’étoit là que réfidoient les dieux tutélaires du
vaîffeaü , & que c’étoit à ces dieux que les matelots
, menacés du naufrage, adreffoient leurs voeux
& leurs prières. J’ajoute encore que le laurier étoit
un ligne de paix & d’amitié ; car au milieu de la
mêlée, l’ennemi le tendait à fon ennemi pour
marquer qu’il fe rendoit à lui.
Enfin, l’adulation polir les empereurs intro-
duifit l’ ufage de pianter des branches de laurier aux
portes de leurs, demeures : voilà d’où vient que
Pline aopelie cet arbre , U portier des Céfars, le
feul ornement & le fidèle gardien de leurs palais.
Gratijjima domibus janitrix , que, fola & domos
ex ornât,, 6’ ante limina C&farum ex cubât. V. Si
K k k