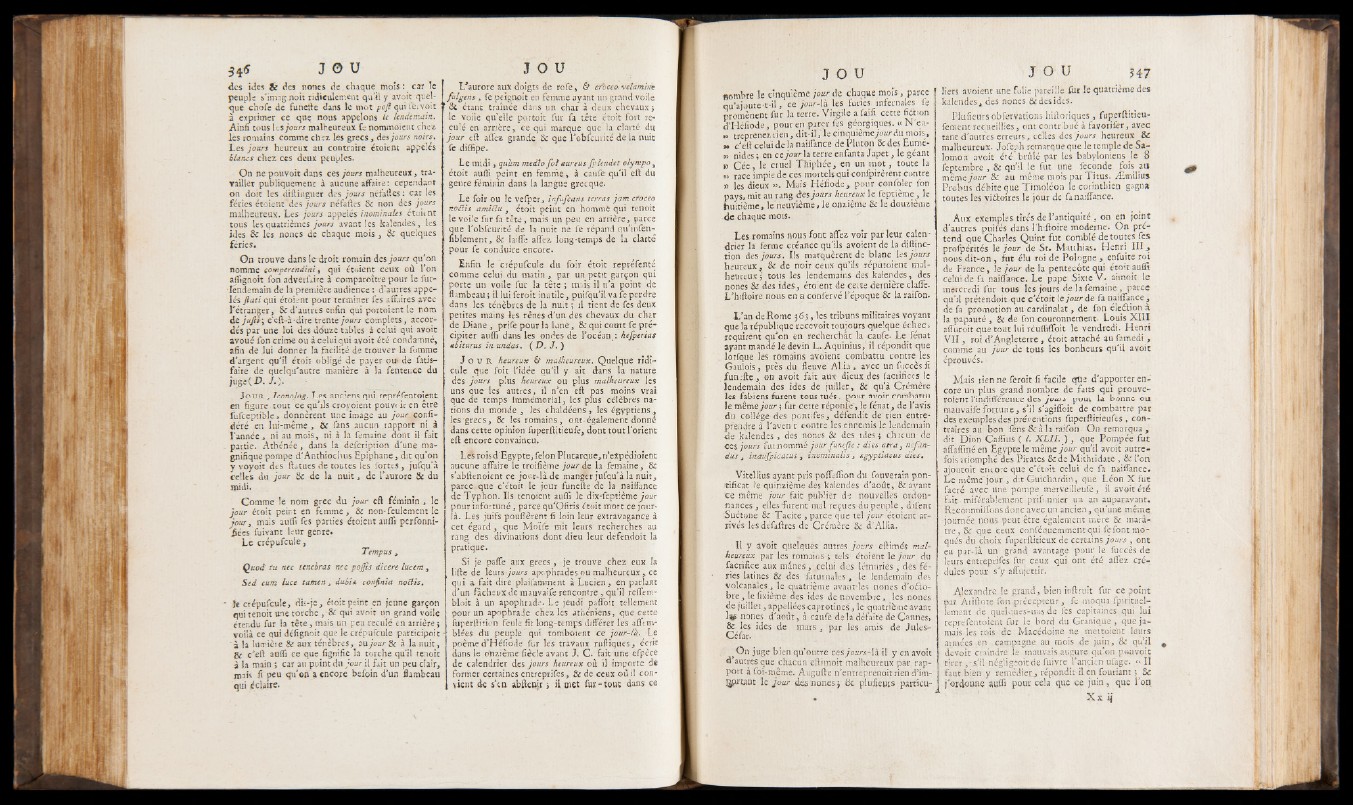
34S J © U
des ides & des nones de chaque mois: car îe I
peuple s’imagnoit ridiculement qu’il y avoir quelque
chofe de furiefte dans le mot pofi qui iéivoit |
à exprimer ce que nous appelons le lendemain.
Ainfî tous k s jours malheureux fe nommoient chez
les romains comme chez les grecs , des jours noirs*
Les jours heureux au contraire étoient appelés
Blancs chez ces deux peuples.
On ne pouvoit dans ces jours malheureux, travailler
publiquement à aucune affaire : cependant
on doit les diilinguer des jours ncfaUes : c.ar les
fériés étoient des jours néfaftes & non des jours
malheureux. Les jours appelés inominales étoit nt
tous les quatrièmes jours avant les kalendes r les
ides & les nones de chaque mois , de quelques
fériés.
On trouve dans le~droit romain des jours qu’ on
nomme çomperendini * qui étoient ceux où Ion
affignoit fon adver faire à comparoître pour le fur-
lendemain de la première audience : d’autres appelés
ftati qui étoient pour terminer fes affaires avec
l’étranger, & d’autres enfin qui portoient le nom
de jujti ; e’eft-à-dire trente jours complets, accordés
par une loi des douze tables à celui qui avoit
avoué fon crime ou à celui qui avoit été condamné,
afin de lui donner la facilité de trouver la fomme
d’argent qu’il étoit obligé de payer ou» de fatis-
faire de quelqu’autre manière à la fenteuee du
jugeCD. J.).
J o u r , Iconolog. Les anciens qui repréfeptoient
en figure tout ce qu’ils croyoient pouvr ir en être
fufceptible, donnèrent une image au jour, confî-
déré en lui-même, & fans aucun rapport ni à
l ’année, ni au mois, ni à la femaine dont il fait
partie. Athénée, dans la defc.ription d’une magnifique
pompe d’Anthiochus Epiphane, dit qu’on
y voyoit des ftatues de toutes les fortes, jufqu’à
celles du jour & de la nuit, de l’aurore & du
midi.
Comme le nom grec du jour eft féminin, le
jour étoit peint en femme, & non-feulement le
jour, mais suffi fes parties étoient auffi personnifiées
fuivant leur genre.
Le crépufcule,
Tempus ,
Quod tu nec tenebras nec pojjts dicere lucem,
Sed cum luce tamen, dubi& confinia noclis.
■ le crépufcule, dis-je, étoit peint en jeune garçon
qui tenoit une torche, & qui avoit un grand voile
étendu fur la tê te , mais un peu reculé en arrière >
voilà ce qui défignoit que le crépufcule participoit à la lumière & aux ténèbres, au jour & à la nuit,
& c’ eft auffi ce que lignifie la torche qu'il tenoit
ù la main ; car an point du jour il fait un peu clair,
mais fi peu qu’on a encore befoin d’un flambeau
qui éclaire.
j o u
L ’aurore aux doigts de rofe, & edbceo velatnirt't
fulgens, fe peignait en femme ayant un grand voile
& étant traînée dans un char à deux chevaux ;
le voile qu’elle portoit fur fa tête étoit fort reculé
en arrière, ce qui marque que la clarté du
jour eft allez grande de que l’obfcuiité de la nuit
fe diffipe.
Le midi , quùm medîo fo i aureus fplendet olympo ,
étoit auffi peint en femme, à caufe qu’il eft du
genre féminin dans la langue grecque.
Le foir ou le vefper, infufeans terras jam croceo
noftis arrùElu , étoit peint en hommè qui tenoit
le voile fur fa tête, mais un peu en arrière, parce
que l’obfcurité de la nuit ne fe répand qu’ infen-
fiblement, 8e laiffe affez long-temps de la clarté
pour fe conduire encore.
Enfin le crépufcule du loir étoit repréfenté
comme celui du matin , par un petit garçon qui
porte un voile fur la tête ; mais il n’a point de
flambeau ; il lui feroit inutile, puifqu’il va fe perdre
dans les ténèbres de la nuit ; il tient de fes deux
petites mains les rênes d’un des chevaux du char
de Diane , prife pour la lune, 8«: qui court fe précipiter
auffi dans les ondes de l’océan,: hefperias
abiturus in undas. (D . J. )
J o u r heureux & malheureux. Quelque ridicule
que foit l’idée qu’il y ait dans la nature
des jours plus heureux ou plus malheureux les
uns que les autres, il n’en eft pas moins vrai
que de temps immémorial, les plus célèbres nations
du monde , les chaldéens, les égyptiens*
les grecs, & les romains, ont-également donné
dans cette opinion fuperftitieufe, dont tout l’orient
eft encore convaincu.
Le% rois d'Egypte, félon Plutarque,n’eîpédioient
aucune affaire le rroifième jour do. la femaine , de
s’abftenoient ce jour-lide mander jufqu’à la nuit,
parce.que c’étoit le jour funette de la naiffance
de Typhon. Ils tenoient auffi le dix-feptième jour
pour infortuné, parce qu*Ofiris ctoit mort ce jour*
là. Les juifs pouflerent fi loin leur extravagance à
cet égard , que Moïfe mit leurs recherches au
rang des divinations dont dieu leur défendoit la
pratique.
Si je paffe aux grecs, je trouve chez eux la
lifte de \tuxs-jours apephrades ou malheureux , ce
qui a fait dire plaifamment à Lucien, en parlant
d’un fâcheux de mauvaife rencontre, qu’il reffem-
bloit à un apophrade. Le jeudi paffoit tellement
pour un apophrade chez les athéniens, que cette
fuperftirion feule fit long-temps différer les afftnv
blées du peuple qui tomboient ce jour-la. Le
poème d’Héfiode fur les travaux rnfiiques, écrit
dans le onzième fiècle avant J. C . fait une efpèce
de calendrier des jours heureux où il importe de
former certaines entreprifes, & de ceux où il convient
de s’tn abftefcjr > il^tnet fur-tout dans ce
J O U 5 4 7
liers avoient une folie pareille fur le quatrième des
kalendes, des nones 8e des ides.
Plu fleurs obfervations hiftoriques , fuperftitïeu-
fement recueillies, ont contribué à favorifer, avec
tant d’autres erreurs, celles des jours heureux &
malheureux. Jofeph remarque que le temple de Salomon
avoit été brûlé par les babyloniens le 8
feptembre, & qu’ il le fut une fécondé fois au ^
même jour de au même mois par Titus. Æsnilius
Probus débite que Timolcon le corinthien gagna
toutes les vi&oires. le jour de fa naiffance.
Aux exemples tirés de l’antiquité, on en joint
d’autres puifés dans l'hiftoire moderne. On prétend
que Charles Quint fut comblé de toutes fes
profpérités 1 o jour de St. Matthias. Henri III j
nous dit-on, fut élu roi de Pologne, enfuite roi
de France, le jour de la pentecôte qui étoit auffi
celui de fa naiffance. Le pape Sixte V . aimoit le
mercredi fur tous les jours de la femaine, parce
qu’il prétendoit que c’étoit le jour de fa naiffance ,
de fa promotion au cardinalat, de fon éleétion a
la papauté, & de fon couronnement. Louis XIII
affuroit que tout lui rcuflîffoit le vendredi. Henri
V I I , roi d’Angleterre, étoit attaché au famedi,
comme au jour de tous les bonheurs qu’il avoit
éprouvés. .
Mais rien ne feroit fi facile que d’apporter encore
un plus grand nombre de faits qui prouve-
roient l’indifférence des jours pour la bonne ou
mauvaife fortune, s’ il s’agiffoit de combattre par
des exemples des préventions fuperftitieufes , contraires
au bon fens & à la raifon On remarqua,
dît Dion Caffius ( L XLII. ) , que Pompée fut
affaffiné en Egypte le même jour qu’il avoit autrefois
ariomphé des Pirates & d e Mithridate , de l’on
ajoutoit encore que c’étoit celui de fa naiffance.
L e même'jour , dit Guichardin, que Léon X fut
facré avec une pompe merveilleufe, il avoit été
fait milérablement prifonnier un an auparavant.
Rsconnoiffons donc avec un ancien, qu’une même
journée nous peut être également mère & marâtre,
& que ceux conféquemment qui fe font moqués
du choix fuperftitieux de certains jours , ont
eu par-là un grand avantage pour le fuccès de
leurs entreprifes fur ceux qui ont été affez. crédules
pour s’y affujettir.
J O u
nombre le cinquième jour de chaque mois , parce
qu’ ajoute t-il, ce jour-là les furies infernales fe
promènent fur la terre. Virgile a faifi. cette fiéhon
d’Héfiode, pour en parer fes géorgiques. « N ’en-
„ treprenez rien, dit-il, le cinquièmeyWdu mois,
„ c’ éft celui de la naiffance de Pluton 8e des Eumé- ,
» nides; en ce jour la terre enfanta Japet, le géant
» C é e , le cruel Thiphée, en un ip ot, toute la
» race impie de ces mortels qui confpirèrent contre
» les dieux ». Mais Héfiode, pour confoîer fon
pays, mit au rang des jours heureux le feptième& le
huitième, le’neuvième, le onzième de le douzième
de chaque mois.
Les romains nous font affez voir parleur calen*
drier la ferme créance qu’ils avoient de la diftinc-
tion des jours. Ils marquèrent de blanc les jours
heureux. & de noir ceux qu’ils répütoient malheureux
j tous les lendemains des kalendes, des
nones 8e des ides, étoient de ceite dernière claffe.
L ’hiftoire nous en a confervé l’époque & la raifon.
L ’an de Rome 365, les tribuns militaires voyant
que la république recevoit toujours quelque échec>
requirent qu’on en recherchât la caufe. Le fénat
ayant mandé le devin L. Aquinius, il répondit que
lorfque les romains avoient combattu contre les
Gaulois, près du fleuve ALia, avec un fuccès fi
fun:fte , on avoit fait aux dieux des facrificcs le
lendemain des ides de juillet, & qu’à Crémère
les fabîens furent tous tués, pour avoir combattu
le même jour ; fur cette réponfe-, le fénat, de l’avis
du collège-des pontifes, défendit de rien entreprendre
à l’aven r contré les ennemis le lendemain
de kalendes, des nones & des ides'i chacun de
ces jours fut nommé jour ƒunefie : dies atra, nefan-
dus , inctufpicatus , inominalis , sgyptiacus dies•
Vitellius ayant pris poffeffion du fouverain pontificat
le quinzième des kalendes d’août, & ayant
ce même jour fait publier de nouvelles ordonnances,
elles-Furent mal reçues du peuple , difent
Suétone & Tacite , parce que tel jour étoient arrivés
les défaftres de Crémère '& d'Allia.
Il y avoit quelques autres jours eftimés malheureux
par les romains -; tels étoient le jour du
facrifice aux mânes, celui des lémuries, des fé*
ries latines & des faturnal.es, le lendemain des
volcanàies, le quatrième avanrles nones d’oélo-
bre, le fixième des ides de novembre, les.nones
de juillet, appelléescaprotines, le quatrième avant
1# nones d’août, à caufe de la défaite de Cannes»
& les ides de mars , par les amis de Jules-
Céfar.
> On juge bien qu’outre ces jours-là il y en avoit
d autres que chacun eftimoit malheureux par rapport
à foi-même. Augufte n’entreprenoitrien d’im-
gpftant 1 z jour des nones j Ôc plufieuis particu-
Alexandre. le grand, bien inftruit fur ce point
par Ariftote fon précepteur , fe moqua fpirituel-
iement de quelques-uns de fes capitaines qui lui
repréfentoient fur le bord du Granique , que jamais
les rois de Macédoine ne mettoient leurs
armées en campagne au mois de juin, & qu’il @
devoit craindre le mauvais augure qu’ on p&uvoit
tirer , 's ’il négligeoitde fuivre l’ancien ufage. « II
faut bien y remédier, répondit il en fouriant ; &
j’ordonne auffi pour cela que ce juin, que l’on
X x ij