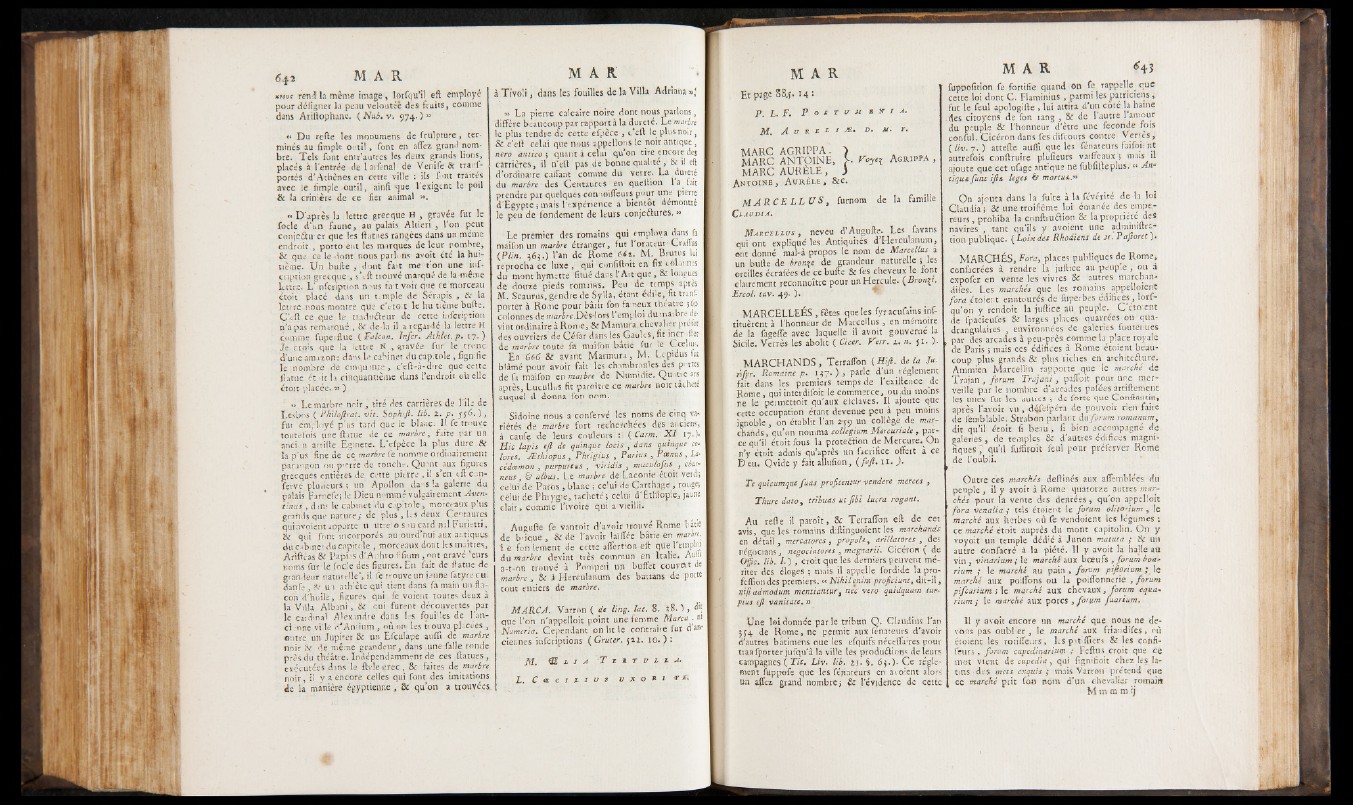
xiovs rend la même image , lorfqu*il eft employé
pour déftgner la peau veloutée des fruits, comme
dans Ariftophane. (N u b .v . 974. ) »'
« Du refte les monumens de fculpture, terminés
au fimple ou til, font en affez grand nombre.
Tels font entr’autres les deux grands lions,
placés à l'entrée de larfenal de Venife & tranf-
portés d’ Athènes en cette ville : ils fuit traites
avec ie fimple outil, ainfi que l ’exigent le poil
& la crinière de ce fier animal jgl
«• D ’après la lettre grecque H , gravée fur le
Xocle d’un faune, au palais Altie ri, l’on peut
conjeéhrer que les ftatues rangées dans un même
endroit, porto eut les marques de leur nombre,
& que ce le dont nous parlons avoit été la huitième.
Un bufte, dont fait me ton une inf-
cnption grecque , s’ eft trouvé marqué de la-mêmc
lettre. L’ nfçripnon n^us fa t voir que ce morceau
étoit placé dans un temple dé Séra^is , la
letrre nous montre que c’eto t le hu tième bufte.
Ç ’cft ce que le traducteur de cette infeription
n’a pas remarqué , & de-la il a regardé la lettre H
Comme fuperflue ( Falcon. Infer. Athlet.p. 17 .)
Je crois que la lettre N , gravée fur le tronc
d’une amazone dans le cabiner du cap.tole, fign.fie
le nombre de cinquante, c eft-à-dire- que cette
ftatue et >ît la cinquantième dans l’endroit où elle
étoit placée..» ) .
» Le marbre noir, tiré des carrières de l’île de
Lesbos ( Pkilofirat. vit. Sopkift. lib. 2. p. ) ,
fut employé p’us tard que le blanc. 11 fe trouve
toutefois une ftatue de ce marbre, faite par un
ancien artifte. Eginete. L ’efpèce la plus dure &
la p us fine de ce marbre le nomme ordinairement
parangon ou p*-?rre de touche. Quant aux figures
grecques entières de cette pitrre , i! s en tft conserve
plusieurs ; un Apollon da --s !a galerie du
palais Farnefe; le Dieu nommé vulgairement Aven-
tlnus , dm? le cabinet du Capitole, morceaux p'us
grands que nature,* de plus , Us deux Centaures
quiavoient appartê 11 .litreio Sau card nalFurietti,
& qui font incorporés au;ourd’hui aux antiques
du cabinet du ,capitede , morceaux dont les maîtres,
Ariftéas & Papias d'Aohro lifium , ont gravé ’eurs
noms fur le (ode des figures. En fait de ftatue de
grandeur naturelle*, il fe rrouveun jeune fatyre eu;
danfe , & un ath’ète qui tient dans fa main un flacon
d'huile, figures qui fe voient toutes deux à
la Villa Albani, & qui furent découvertes par
le cardinal Alexandre dans 1rs foui’les de l'an-
ci nne vi’.le rvAntinm , où qn les trouva.placées ,
outre un Jupher & un Efculape aufli de marbre
noir & de même grandeur, dans ■ une falle ronde
près du théâtre. Indépendamment de ces ftatues,
exécutées dans le ftvle grec , & faites de marbre
noir, il y a encore celles qui font des imitations
de la manière égyptienne, & qu’on a trouvées
à T ivoli, dans les fouilles de la Villa Adriaha
» La pierre calcaire noire dont nous parlons,
diffère beaucoup par rapport à la dureté. Le marbre
le plus tendre de cette efpèce , c’eft le plus noir,
& c’eft celui que nous appelions le noir antique,
nero antico ; quant à celui qu’on tire encore des
carrières, il n'eft pas.de bonne qualité , & il eft
d’ordinaire cailant comme du verre. La durete
du marbre des Centaures en queftion l’a fait
prendre par quelques conioiffeurs pour une pierre
d'Egypte j mais l'expérience a bientôt démontré
le peu de fondement de leurs conje&ures. »
Le premier des romains qui employa dans fa
rnaifon un marbre étranger, fut 1 orateur* Craflus (P Un. 363.) l’an de Rome '66t. M. Brutus lui
reprocha ce luxe , qui confiftoit en fix colonnes
du mont hymette fîtué dans l’Attaque, & longues
de douze pieds romains. Peu de ttmps apres
M. Scaurus, gendre de Syila, étant ediie, fit tranf-
porter à Rome pour bâtir fon fameux théâtre 36.0
! colonnes de marbre.Dès-lors 1 emploi du mai bre devint
ordinaire à Rome, & Mamura.chevaher prefet
des ouvriers de Céfar dans les^Gaules, fit incr ,fter
de marbre toute fa rnaifon bâtie fur le Ccelius.
En 666 & avant Marmura, M. Lepidus fut
blâmé pour avoir fait les chambranles des portes
d é f i rnaifon en marbre "de Numidie. Quatre ans
- après, Lucullus fit paroître ce marbre noir tâchete
auquel il donna fon nom.
Sidoine nous a confervé les noms de cinq variétés
de marbre fort recherchées des anciens)
à caufe de leurs couleurs :> ( Carm. X>I 17.)*
Hic lapis efl de quiiique locis , dans quinque colores.
Æthiopus y Phrigius , Parius , Pcenus , La-
cédoemon , purpureus , viridis , muculofus^, ebur-
neus , & albus. Le marbre de Laconie étoit verd>
celui de Paros , blanc s celui de Çarthage-j rougej
celui de Phrygte, tacheté j celui^ d'Ethiopie, jaune
clair, comme l’ ivoire qui a vieilii.
Augufte fe vantoit d’avoir trouvé Rome bâtie
de brique , & de l'avoir laiiïée bâtie en marbre.
l e fondement de cette affertion eft que l’emploi
du marbre devint très commun en Italie. Aufli
a-t-on trouvé à Porripeii un buffet c o u v â t de
. marbre, & i Heréulanum des battans de porte
tout entiers de marbre.
MARCA. Varron ( de ling. lat. 8. a8. dit
que Ton n’appelloit point une femme Marca. ni
Numcria. Cependant on lit le contraire fur d anciennes
inferiptions ( Gruter. 512. 10 .) :
M . x / A T X a T V L L jt.
L . C OE C J i 1 V S U X O » I * 2'
Et page S8.j. 14 :
P. L. F. P o s t c / a n i r i a .
M. A U R E L I JE. D. M. F.
M ARC A G R IP P A ’. 7
M A R C A N TO IN E , V°y‘ l A grippa ,
M A R C A U R È L E , }
A n to in e , A u r è l e , & c.
M A R C E L L U S , furnora de la famille
C l-AU DI A.
Ma r c e l l u s , neveu d’Augufte. Les favans
qui ont expliqué les Antiquités dHerculanum,
ont donné mal-à propos le nom de Marcellus a
un bufte de bronze de grandeur naturelle ; les
oreilles écrafées de ce bufte & fes cheveux le font
clairement reconnoître pour un Hercule. (Bron^t.
Fr col. tav. 49. ).
MARCELLEÉS , fêtes que les fyraeufains inf-
tituèrent à l’honneur de Marcellus , en memoire
de la fageffe avec laquelle il avoit gouverne la
Sicile. Verrès les abolit ( Cicer. Verr. 2. n. j j . ).
M A R C H A N D S , Terraffon (Hiß. delà Ju.
t\fpr. Romaine p. 137. )_> parle d’un réglement
fait dans les premiers temps de l’exiftence de
Rome, qui interdifoic de commerce, ou ,du moins
re le permettoit qu’aux efclaves. Il ajoute que
cette occupation étant devenue peu à peu moins
ignoble, on établit l ’an 2^9 un collège de marchands
» qu’on nomma collegium Mercuriale , parce
qu’il étoit fous la prote&ion de Mercure. On
n’y étoit admis qu’après un facrifice offert a ce
D eu. Qvide y fait allufion, ( fiß» 11. )•
Te quicumque fuàs proficentur vendere merces ,
Thure dato, tribuas ut fibi lucra rogant.
Au refte il paroît, & Terraffon eft de c e t(
avis, que les romains diftinguoient les marchands
en détail, mercatores, propoU, arillatores , des
négocians, négociatores , magnarii. Cicéron t, de
Offic. lib. /.) , croit que les derniers peuvent mériter
des éloges ; mais il appelle fordide la pro-
feffioti des premiers. « Nihilenirn proficiunt, dit-il,
piß admodum mentiantur, nec vero quidquam tur-
pius efl vanitate. »
Une loi donnée par le tribun Q. Claudius l'an
3 J4 de Rome, ne permit aux fénateurs d’avoir
d’autres bâtimens que les efquifs néceffa:res pour
tranfporter jufqu’à la ville les produ&ions de leurs
campagnes ( Tit. Liv. lib. 21. §. 63.). Ce réglement
fijppofe que les fénateurs en a votent alors
un ajfez grand nombre i & Tévjdençe de cette
fuppofition fe fortifie quand on fe rappelle que
cette loi dont C. Flaminius , parmi les patriciens,
fut le feul apoîogifte , lui attira d’un coté.la haine
des citoyens dé fon rang , & de I autre 1 amour
du peuple & l'honneur d'être une fécondé fois
conful. Cicéron dans fesdifeours contre Verrès,
( liv..7. ) attefte aufli que les fénateurs faifoi: nt
autrefois conftruire plufieurs vaiffeaux ; mais il
ajoute que cet ufage antique ne fublîfteplus. « An-
tiqua futtt ifta leges & mortua.n
On ajouta dans la fuite à la feverite do-la loi
Claudia î & une troifïème loi émanée des empereurs
, prohiba la conftruétion & la propriété des
navires , tant qu’ils y avoient une adminiftrr.-
tion publique. ( Loix des Rhodiens de m: Pafioret ).
MARCHÉS, Fora, places publiques de Rome,
confacrées à rendre la juftice au peup.e, ou à
expofer en vente les vivres & autres marchan-
difes. Les marchés que les romains appelloient
fora étoîent enntourés de fuperbes édifices, lorf-
qu’on y rendoit la juftice au peuple.^ C eto:ent
de fpacieufes & larges places quarrées ou qua-
drangulaires , environnées de galeries fou tenues
par des arcades à peu-près comme la place royale
de Paris i mais ces édifices à Rome étoient beaucoup
plus grands & plus riches eh archite.dme.
Ammien Marcellin rapporte que le marché de
Trajan , forum Trajani , pafloit pour une merveille
par le nombre d’ arcades pofees artiftement
les unes fur les autres ; de forte que Confiant«,’
après l’avoir vu , difefpéra de pouvoir rien faire
de femblable. Strabon parlant du forum romanum,
dit qu’il étoit fi beau, fi bien accompagné de
galeries, de temples & d’ autres édifices magnifiques
7 qu’il fuffiroit feul pour préfevver Rome
de l’oubli.
Outre cès marchés deftinés aux affemblées du
peuple, il y avoit à Rome quatorze autres marchés
pour la vente des denrées, qu’on appelloit
fora venalia ,* tels étoient le forum oliforîum , le
marché aux herbes- ou Ce vendoient les légumes :
ce marché étoit auprès du mont capitolin. On y
voyoit un temple dédié à Junon matuta y & un
autre confacré à la piété. 11 y, avoit la halle au
vin, vinarium; le marché aux boeufs , forumboa-
rium ; le marché au pain , forum pifiçrium ; le
marché aux poilfons ou la poiffonnefie , forum
pifearium ; le marché aux chevaux, forum equa-
rium y le marché aux porcs , forym fuarium.
Il y avoit encore un marché que nous ne devons
pas oublier , le marché aux friandifes, où
étoient les ronfleurs, L s p it fliers & les confi-
feurs , forum cupcd,it}4rium ; Feftus croit que ce
mot vient de cupedia, qui fignifioit chez les latins
des mets exquis y mais Varron prétend que
ce marché prit fou nom d’un chevalier romain
M m m m ij