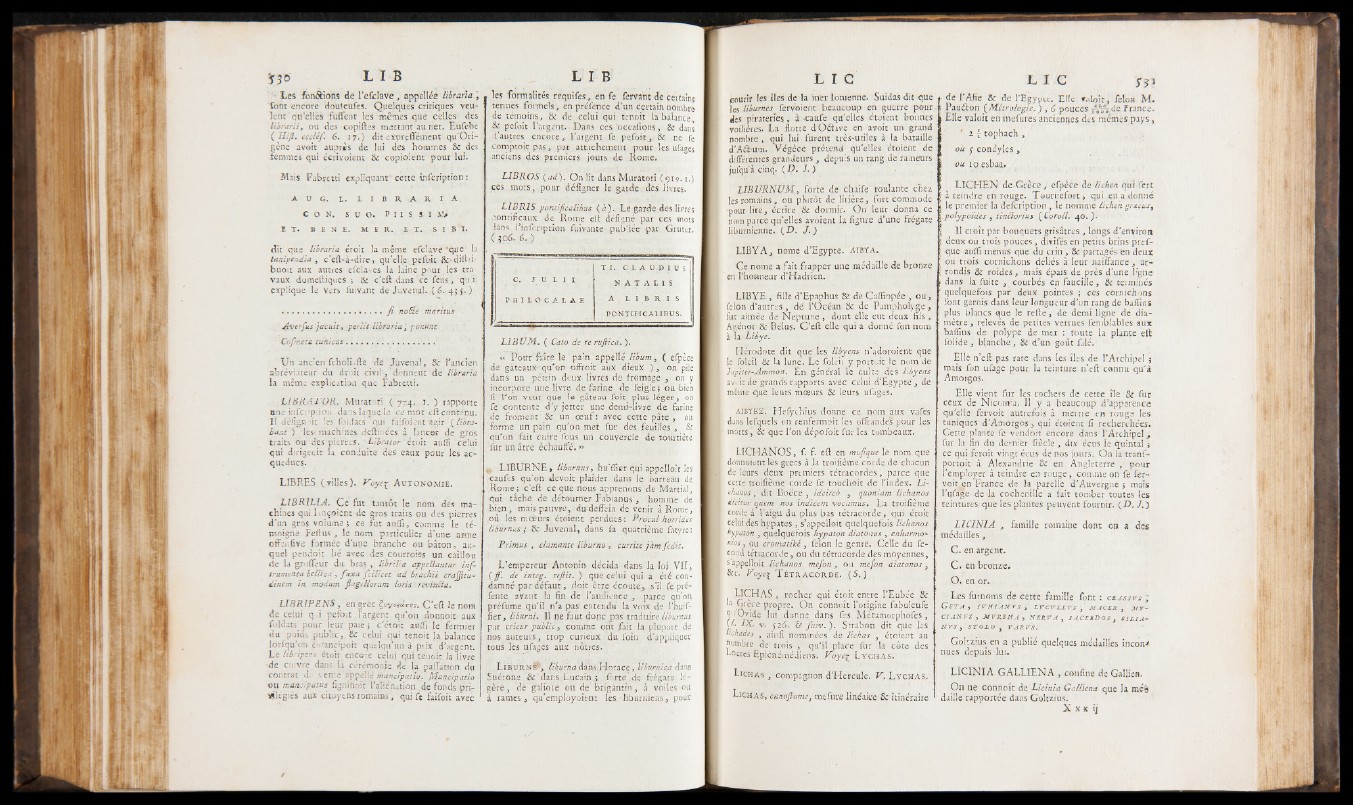
ÿjo L I B
Le s fondions de l ’efclave, appellée libraria ,
font encore douteufes. Quelques critiques veulent
qu’elles fuflent les mêmes que celles des
librarii, ou des copiftes mettant au net. Eufebe
( Hifi. eccléf. 6. 17 .) dit expreflement qu’Ori-
gène avoit auprès de lui des hommes & des
femmes qui écrivoient & copioient pour lui.
l 1 B
les formalités requifes, en fe fervant de certains
termes formels, en préfence d’un certain nombre
de témoins, & de celui qui tenort l'a balance
& pefoit l’argent. Dans ces oecafions, & dans
d’autres encore, l’argent fe pefoit,, & ne fe
comptoit pas, par attachement pour les triages
anciens des premiers jours de Rome.
Mais Fabretti expliquant'cette infeription:
A U G. L . L I B R A R I A
C O N. S U O. P I I S J I W#
E T . B E N E. M E R. E T. ,S I B ï .
dit que libraria étoit la même efclavé *que la
lanipendia 3 c ’eft-à-dire, qu’ell,e pefoit &-dilbi-
buoit aux autres efclaves la laine pour les tra
vaux domelliques ; & c’eft dans ce fens, qiî i;
explique le vers fuivant de Juvenal. (6.. 43 y. )
...........................................f i noSle maritus
^Lverfus jacuit, periit libraria ÿ pônunt
CofmetA [unicas..................................
Un anc:en fcholLfte de Juvenal, & l’ancien
abréviateur du droit civil-, donnent de libraria
la même explication que Fabretti.
L IBRATOR. Müratori ( 774. 1. ) rapporte
une infcnpûoii dans laquelle ce mot eft contenu.
Il défignoit les foi d a es qui faifoient agir ( libra-
bant ) les-machines deftinées à lancer de gros
traits ou des pierres. Li b rat or étoit auffi celui
qui dirige oit U conduite des eaux pour les ac-
queducs.
LIBRES (villes). Voyeç A uton om ie .
LIBRILIA. C e fut tantôt le nom des machines
qui 1 mçoient de gros traits ou des pierres
d’un gros volume; ce fut auffi, comme le témoigne
Feftus , le nom particulier d’une: ar-me
offji.five formée d’une branche ou bâton, auquel
pendoit lié avec des courroies un caillou
de la groffeur du bras , librilia appellantur inf-
trumenta belhcâ , ƒ axa fcihcet ad brachii crajjitu-
éinem in. modum fiagttiorum loris revihcla.
LIBRIPENS s en grec £1lyo'vdrijç. C ’ eft le nom
de celui q-i pefoit l’argent qu’on donpoit aux
foldats pour leur paie; c ’étoit suffi le fermier
du poids public,. & celui qui tenoit la balance
lorfqu’on é-rfancipoit quelqu’un à prix .d’argent.
Le libripens étoit encore celui qui tenoit la livre
de cuivre dans la cérémonie de la paffation du
contrat d. vente appelle mancipatio. Mancipatio
o n m andp atus fignihoit l'aliénation .de fonds privilégiés
aux citoyens romains, quif« faifoit avec
L1BROS (ad). On lit dans Müratori (919.1.)
ces mots, pour défigner le garde, dés livres.
LIBRIS pontificalibus ( a). Le garde des livres
pontificaux de Rome eii défigné par ces mots
dans l’infeription fuivante publiée par Gruter.
( 506. 6. ) -
c. J u L 1 i
P HI L 6 ,C A L A E
T I . C L A U.D I ü S
N- jA T A L I S
A / L I B R I S
PONTIFICALIBUS.
L 1BUM. ( Cato de re ruftied. ).
« Pour faire le pain appelle libum, ( efpèce
de gâteaux-qu’on offroit aux dieux ) , on pile
dans un pétrin deux livres de fromage j on y
incorpore une livre de farine de feigle; ou bien
fi l’on veut que le gâteau foit plus léger, on
fe contente d’y jetter une demi-livre de farine
de froment & un. oe uf : avec cette pâte , on
forme un pain qu’on met fur des feuille,s , &
qu’on fait cuire fous un couvercle de tourtière
fur un âtre échauffé, p
0 LIBURNE , liburnus, hu'ffier qui appelloit les
caufes qu’on devoir plaider dans le barreau de
Rome; c ’eft ce que nous apprenons de Martial,
qui tâche de détourner Fabianus , homme de
bien, mais pauvre, du deffein de venir à Rome,
,ou les moeurs étoient perdues : Procul horridus
liburnusÿ & Juvenal, dans fa quatrième fatyre:
Primas , clamante liburno , currite jam fedit.
L ’empereur Antonîn décida dans la loi VII,
(jf. de integ. refiit. ) que celui qui a été condamné
par défaut, doit être é cou té,, s’il fe préfente
avant la fin de l’audience , .parce qu’on
préfume qu’il ira pas entendu la voix de l’huif-
fier, libumi. Il ne faut donc nas traduire liburnus
par crieur public, comme ont fait la plupart de
nos auteurs., trop curieux du foin d’appliquer
tous les ufages aux nôtres.
L iburnè , liburna dans Florace, UburnicA dans
Suétone & dans Lueain ; forte de frégate légère,
de galioie ou de" brigantin, à voiles ou
à rames, qu’employoient les liburniens, pour
L 1 c
courir les îles de la mer Ionienne. Suidas dit que
les liburnes feWôient beaucoup en guerre pour
des pirateries, à -caufe qu’elles étoient bonnes
voilières. La flotte dOéhv e en avoit un grand
nombre , qui lui furent très-utiles à la bataille
d’A&ium. Végèee prétend qu’elles étoient de
différentes grandeurs , depuis un rang de rameurs
jufqua cinq. (D . J. )
LIBURNUM, forte de chai.fe roulante chez
les romains, ou plutôt de litière, fort commode
■ pour lire, écrire & dormir. On leur donna ce
nom parce qu’ elles avoient la figure d’une frégate
liburnienne. (D . J .)
L IB Y A , nome d’Egypte, aib ya .
Ce nome a fait frapper une médaille de bronze
en l’honneur d’Hadrien.
L IB Y E , fille d’ Epaphus & de Caffiopée , ou,
félon d’autres, dé l’Océan & de Pampholyge ,
fut aimée de Neptune , dont elle eut deux fils ,
Agénor & Bélus. C ’eft elle qui a donné fon nom
à la Libye.
Hérodote dit que les libyens n’adoroient que
le foleil & la lune. Le foleii y portait le nom de
Jupiter-Ammon. En général le culte des libyens
avrit de grands rapports avec celui d’Egypte , de
même que leurs moeurs & leurs ufages.
AIBTES. Hefychius donne ce nom aux vafes
dans lefquels on renfermoit les offrandes pour les
morts j & que l’on dépofoit fur les tombeaux.
L ICH AN O S , f. f. eft en mufique le nom que ,
donnoient les grecs à la troifième corde de chacun
de leurs deux premiers tétracordes, parce que
cette troifième coide fe touchoit de l’index. Li-
chanos, dit Boèce , idcirco , quoiûam lichanos
dickur quem nos indicem vocamus, La troifième
corde à l'aigri du plus bas tétracorde, qui étoit
celui des hypates, s’appelloit quelquefois lichanos
kypaton, quelquefois hypaton diatonos , enharmo~
nios, ou cromatiké, félon le genre. Celle du fécond
tétracorde, ou du tétracorde des moyennes,
s appelloit lichanos mefon , ou mefon diatonos ,
Sic, Voye\ T É T R A CO R D E . ( S . )
LîCHAS , rocher qui étoit entre l’Eubée & I
*a Grèce propre. On connoît l’origine fabuleufe
qn Ovide lui donne, dans fs s Mécamorphofes ,
(ƒ. IX. v. y26. & [uiv. ). Strabon dit que les
hchades , ainfî nommées de lichas- , étoient au
nombre de trois ; qu’il place fur la côte des
bocres Epicnémédiens. Voyeç L y c h a s .
lichas , compagnon d’HercüIe. V. L y ch a s .
Lichas, c»nofiome} mefure linéaire &: itinéraire
L I C 5’ 3 ï
• de I'Afie & de l'Egypte. Elle valoit, félon M.
Pauéton (Métrologie. ) , 6 pouces de France.
Elle valoit en mefures anciennes des mêmes pays,
* i \ tophach ,
ou y condyles ,
ou iq.esbaa. ,.
L ICH EN de.Grèce, efpèce de lichen qui fert
à teindre en rouge. Toumefort, qui en a donné
le premier la dèfcription, le nomme lichen gr&cuS)
^polypoïdes , tinttorius ( Coroll. 40.).
| U croît par bouquets grisâtres , longs d’environ
; deux ou trois pouces, divifés en petits brins pref-
que auffi menus que du crin , & partagés en deux
; ou trois cornichons déliés à leur naiffanee , ar-
! rondis & roides, mais épais de près d’une ligne
dans la fuite , courbés en faucille, & terminés
; quelquefois par deux pointes ; ces cornichons
font garnis dans leur longueur d’un rang de baflïns
plus blancs que le re lie , de demi ligne de diamètre
, relevés de petites verrues fembiables aux
baffins de polype de mer : foute la plante eft
folide, blanche , & d’ un goût Talé.
Elle n’ eft pas rare dans les îles de l’Archipel j
mais fon ufage pour la teinture n’eft connu qu’à
‘ Amopgos.
Elle vient fur les rochers de cette île & fur
ceux de Nicomia. Il y a beaucoup d’apparence
qu’elle fervoit autrefois à mettre en rouge les
tuniques d’Amôrgos, qui étoient fi recherchées.
Cette plante fe vendoit encore dans l’A rchipel,
fur la fin du dernier fiècle , dix écus le quintal ;
ce qui feroit. vingt écus de nos jours. On la tranf-
portoit à Alexandrie & en Angleterre, pour
l’employer à teindre en rouge, comme on fe fer-
voit ien France de la pareile d'Auvergne ; maïs
l’ufage de la cochenille a fait tomber toutes lés
teintures, que les plantes peuvent fournir. (D . J.)
LICINIA , famille romaine dont on a des
médailles,
C . en argent.
C . en bronze.
O. en or.
Les furnoms de cette famille font : cz.éssvs ;
G e T A , I V N Z A N V S i L V C V L . L V S , M A C E R , M V -
C I A N V S , M V R S t T A , NE R .V A , S 4CE J LD0 S , S I L I A -
N V S y S T O L O , V A r V s .
Gokzius en a publié quelques médailles incon*
nues depuis lui.
L IC IN IA G A L L IEN A , confine de Gallien.
On ne connoît de Licinia Galliena que la mc§
dailie rapportée dans Goltzius.X
x K ij