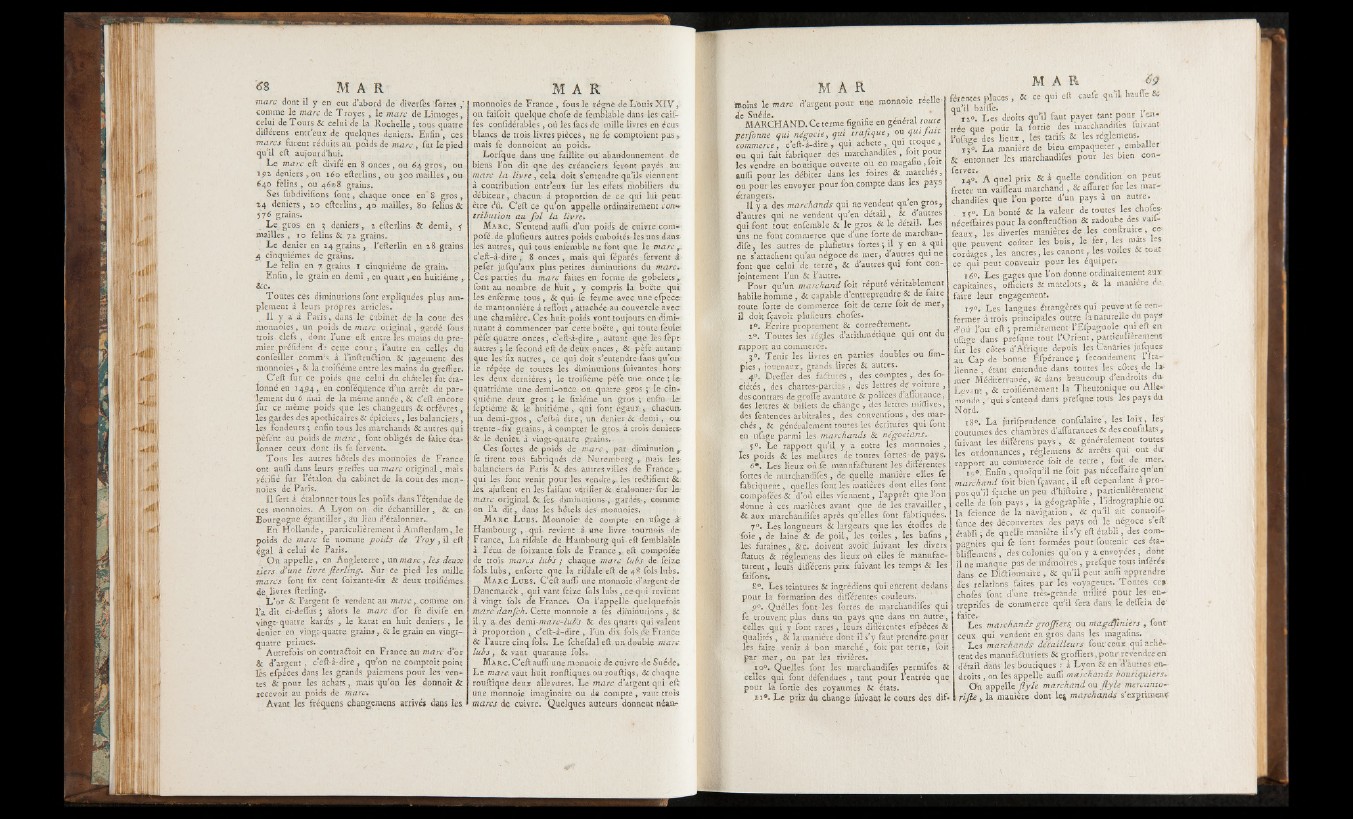
marc dont il y en eut d’abord de di^eiTès fortes
comme le marc de Troyes , 1t marc de Limoges,
celui de T ours & celui de la Rochelle, tous quatre
differens encr eux de quelques deniers. Enfin , ces
marcs furent réduits au poids de marc, fur le pied
qu’il eft aujourd’hui.
L e marc eft divife en 8 onces, ou 64 gros, ou
deniers ,011 160 efterlins, ou 3.0o mailles , ou
640 félins, ou 4608 grains.
Ses fubdivifions font, chaque once en* 8 gros ,
14 deniers, zo efterlins, 40 mailles, 80 félins &
576 grains.
L e gros en 3 deniers,. z efterlins 8c demi-, 5
mailles , 10 félins & 7 1 grains-
L e denier en 14 grains , l’efterlin en 28 grains
4 cinquièmes de grains.
L e félin en 7. grains 1 cinquième de grain*
Enfin, le grain en demi , en quart, en huitième ,.
&c.
Toutes ces diminutions font expliquées plus amplement
à leurs propres articles.
Il y a' à Paris, dans le- cabinet de-la cour des
monnoies, un poids de marc original, gardé fous
trois, clefs , dont l’une eft entre les mains du premier.
président de cette cour^ l’autre en celles du
confeiller comnfs à l’inftrnéiion & jugement des
monnoies-, & la troifiéme entre les mains du. greffier;
C’eft fur ce poids que celui du châtelet fut étalonné
en 145.4,. en.conféqüence "d’un arrêt du parlement
du 6 mai de la même année, & c’eft encore
fur ce même- poids que les changeurs & orfèvres,
les gardes des apothicaires & épiciers , les balanciers,
les fondeurs ; enfin tous les marchands & autres qui
pèfcnt au poids de marc , font obligés de faire étalonner
ceux dont ils fe fervente
Tous les autres Hôtels des monnoies de France
ont: auffi dans leurs greffes un marc original, mais
yçrifié fur l’étalon, du cabinet, de. la. cour des men-
noies de. Paris..
Il fert à étalonner-tous les poids dans l’étendue de
ces monnoies. A Lyon on dit échantiller, & en;
Bourgogne égantiller, àu lieu d’étalonner^
En Hollande, particulièrement a Amfterdam ,.le
poids de marc fe nomme p o ids de T ro y , il eft
égal à celui de Paris.
On appelle, en Angleterre, un marc, tes deux
tiers d’une livre, fierlin g . Sur ce pied les mille.
marcs font fîx cent foixante-fix & deux troifiémes,
de. livres fterding.
L ’or & l’argent fè vendënt au m a r c comme on.
l’a dit, ci-deffus ; alors le marc d’or fe divife, en.
vino-t-quatre karats , le karat en huit deniers-, le.
denier en vingt-quatre grains,. & le grain ça vingt-
quatre primes.-
Autrefois'oh contraétoit en France.au marc d’ôr
8c d’argent , e^èft-àrdire , qur’on ne comptoit point
lés efpèces dans les grands paiemens pour les ventes
& pour les achats ,. mais -qu’on les donnoit &
xecevoit au poids dè marc..
Avant les fréquens changemçns arrivés dans les.1
monnoies de France, fous le régné de Louis X IV ,
on faifoit quelque chofe de femblable dans les caif»
fes confidérables , où les facs de mille livres en écus
blancs de trois livres pièces,: ne fè comptoient pas
mais fe donnoient au poids.-
Lorfque dans une faillite ou' abandonnement de
biens l’on dit que des créanciers feront payés au
marc la liv r e , cela doit s’entendre qu’ils viennent
a contribution entr’eux- fur les effets! mobiliers dtt-
débiteur, chacun- à proportion de Ce qui lui peut
être dû.. .C’eft ce qu’on appelle ordinairement con~
tribution au f o l la livre.
Marc. S’entend auffi d’un poids de cuivre com-
pofé-de plufieurs autres poids emboîtés-les uns dans
les autres, qui tous enfemble ne font que le marc r.
. c’eft-à-dire , 8 onces, mais qui féparés ferrent à
pefer jufqu’aux plus petites diminutions du marc.
Ces parties du mare faites en forme de gobelets
font au nombre de huit, y compris la boëte qui
les enferme tous ,. & qui (e ferme avec une efpece.-
de mantonnière à reflortattachée au couvercle avec,
une charnière. Ces huit poids ydnt toujours en diminuant
à commencer par cette boëte , qui toute feule:
pèfe; quatre onces, c’eft-à-dire , autant que lés-fept
autres fie fécond eft de deux onces, 8c pèfe autant
. que lesffix autres , ce qui doit s’entendre fans qu’on
le répète de toutes les diminutions Suivantes hors
les deux dernières j le troifiéme pèfe une once ; 1er
quatrième une demi-once ou quatre gros ;; le cia*
quiéme deux gros le fix-iéme un gros $ enfin le
feptiéme & le huitième , qui font égaux., chacun,
un d em i-g ro sc ?efi>à dire, un denier.& demi,, .ou.
! trente-fix grains, à compter le gros, à trois deniers*
: & le denier à vingt-quatre grains* ■
Ces fortes de poids de marc 9 par diminution r
fe tirent tous fabriqués de Nuremberg r niais les-
balanciers de Paris & des autres villes de France K
qui les font venir pourries vendre^les reCrifient &
les ajuftent en les faifant vérifier & étalonner-fur le
marc original. 8c fes. diminutions-,-, gardés-, comme
on l’a dit, dans les hôtels des monnoies. Marc Lubs. Morin oie.' dè compte- en* ufage à'
Hambourg, qui- revient à-une livre tournois de-
France» La rifdale de Hambourg qui -eft femblable
à l’écu- de foixante. fols de France ». eft compofée
de trois marcs lubs ; chaque marc luBs de feize
fols lubs,.enforte que la rifdale eft de 48 fols lubs.
Marc Lubs. C’eft auffi une nionnoie .d'argent de
Danemarck, qui vaut feize fols lubs ,,ce qui'revient
à vingt fols de France; Gn l’appelle quelquefois
marc danfeh. Cette monnoie a fes diminutions , &
il.y a: des denù-marc-luB's & des quarts qui valent
à proportion , c’eft-à-dire , l’un dix fols_dë France
& l ’autre cinq. fols. Le fchefdal eft. un double marc
lubs, & vaut quarante fols.. Marc. C’eft auffi une monnoie de cuivre de Suède»
Le marcsaut huit ronftiques.o-urouftiqs, & chaque
rouftique deux allevures. L e marc d’argent qui eft
une monnoie imaginaire ou de compte, vaut trois
marcs de cuivre. Quelques auteurs donnent néant-
'»oins le marc d’argent pour «he monnoie réelle-
de Suède. , , ,
MARCHAND. Ce terme fignifie en général toute
verfenne qui négocie, qui trafique, ou qui fa i t
commerce, c’eft-à-dire, qui acheté , qui troque ,
ou qui fait fabriquer des marchandifes, ioit pour
les vendre en boutique ouverte ou en magafin, foit
auffi pour les débiter dans les foires & marchés,
ou pour les envoyer pour fon compte dans les pays
étrangers. ,
Il y a des marchands qui ne vendent qu en gros*
d’autres qui ne vendent qu’en détail, & d autres
qui font tout enfemble 8c le gros 8c le detail. Les
uns ne font commerce que d’une forte de marchan-
dife, les autres de plufieurs fortes j il y en a qui
ne s’attachent qu’au négoce de mer, d’autres qui ne
font que celui de terre, & d’autres qui font conjointement
l’un & l’autre.
Four qu’un marchand foit réputé véritablement
habile homme , & capable d’entreprendre & de faire
toute forte de commerce foit de terre foit de mer,
il doit fçavoir plufieurs chofes.
i® . Ecrire proprement & correctement.^
2,0, Toutes les régies d’arithmétique qui ont du
rapport au commerce.
3°. Tenir les livres en parties doubles ou Amples,
journaux, grands livres & autres.
40, D relier des factures, des comptes r des fo-
ciétés , des chartes-parties , des lettres de' voiture ,
des contrats de groffe avanture & police.s d afîurance,
des lettres & billets de change ,• des lettres miffives,
des fentences arbitrales, des conventions , des marchés
, & généralement toutes les écritures qui (ont
en ufige parmi les marchands & négoeians.-
5°. L e rapport qu’il^ y a entre les monnoies ,
les poids & les meiures de toutes fortes de pays-.
6®. Les lieux où fé manufaèlurent les différentes
fortes de marchandifes , de quelle manière elles fe
fabriquent, quelles font les matières dont elles font
compofées & d’où elles viennent, l’apprêt que l’on
donne à ces matières avant que de les travailler,
& aux marchandifes après qu’elles font fabriquées. !
7°. Les longueurs & largeurs que les étoffes dé
ffoie , de laine & de poil , les toiles , les bafins ,
les futaines, &c; doivent avoir fuivant les divers
ftatuts & réglemens des lieux où elles fe manufacturent
, leurs differens prix fuivant les temps & les
faifons.
8°. Les teintures & ingrédiens qui entrent dedans
pour la formation des différentes couleurs.
’ 5°. Quelles font-les fortes de marchandifes qui
fe trouvent plus dans un pays que dans un autre ,
celles qui y font rares , leurs différentes efpèce6 8c
qualités , & lamanière dont il-s’y faut prendre.pour
les faire venir à bon marché , foit par terre, foit
par mer, ou par les rivières.
io°. Quelles font les marchandifes permifes &
celles qui font défendues , tant pour rentrée que
pour la fortie des royaumes & états.
11®* Le prix du change fuivaût le cours des différentes
places, & ce qui eft caufe qu'il, hauffe Si
qu’il baiffe.
12,0. Les droits qu’il faut payer tant pour 1 entrée
que pour là lortie- des marchandifes fuivant
l’ufage des lieux , les tarifs 8c les reglemens.
13 °. L a manière de bien empaqueter , emballer
& entonner lés marchandifes pour les bien conferver.
4 ,, . . .
r4o. A quel prix & à quelle condition on peut
fréter un vaiffeau marchand , & affùrer fur les marchandifes
que l’on porte d’un pays à un autre.
iço. L a bonté & la valeur de toutes' les choies-
néceffàires pour la conftruètion & radoube des vaif-
feaux, les diverfes manières de les conftruire , ce-
que peuvent coûter les bois, le fe r, les mats les
cordages , les ancres, les canons, les voiles 8c tout
ce qui peut convenir pour les equiper.
i6 °. Les gages que l’on donne ordinairement aux
capitaines, officiers & matelots, & la manière d.e
faire leur engagement.
170* Les langues étrangères qui petfye.it fe renfermer
à trois principales outre la naturelle du pays
ffoù l’on eft ; premièrement l’Efpagnole qui eft en
ufage dans prefque tout l’Orient, particulièrement
fur les cotes d’Afrique depuis les Canaries jufepaes
au Cap de bonne Éfpérance ; fecondement l’Italienne
, étant entendue dans toutes les côtes de la-
mer Méditerranée, & dans beaucoup d endroits du-
Levant , & troifiémement la Theutônique où Aile«'
.mande/qui s’entend dans prefque tous les pays du
Nord.-
180. L a jtfrifprudence confulaire, les loix , les
coutumes des chambres d’affurances & des confulats,
fuivant les differens pays , & généralement toutes
les ordonnances, réglemens 8C arrêts qui ont du:
rapport au commerce foit de terre , foit de mer.
It;®. Enfin , quoiqu’il rte foit pas néceffaire qu un
marchand foit bien fçavant, il eft cependant à propos
qu’il fçache un peu d’hiftoire , particulièrement
celle de fon- pays, la géographie , l’idrographie ou
[ là fciencè de la navigation, & qu’il ait connoif-
fance des découvertes des pays où le négoce s’eft
établi j dé quelle manière il s’y eft établi, des compagnies
qui fe font formées pour foutenir ces établi
ffe mens, des colonies qu’on y a envoyées , dont
il ne manque pas de’mémoires , prefque tous inférés
dans ce Di&iomiaire , & qu’il peut auffi apprendre
dès relations faites par les voyageurs. Toutes ce*
chofes font d’une très-grande utilité pour les en-
treprifés de commerce qu’il fera dans le delfeia de'
faire.- .
Les marchands greffiers, ou magajiniers , lonc
ceux qui vendent en gros dans les magafins.
Le3 marchands détailleurs fout"ceux qui achètent
des manufacturiers & groffiers, pour revendre en'
détail dans' les boutiques : à Lyon & en ‘d’autres endroits
, on les appelle auffi marchands boutiquiers.■
On appelle J ly le marchand ou f ly le mercanto-
rifle y la maniéré dont le j marchands s’expriment