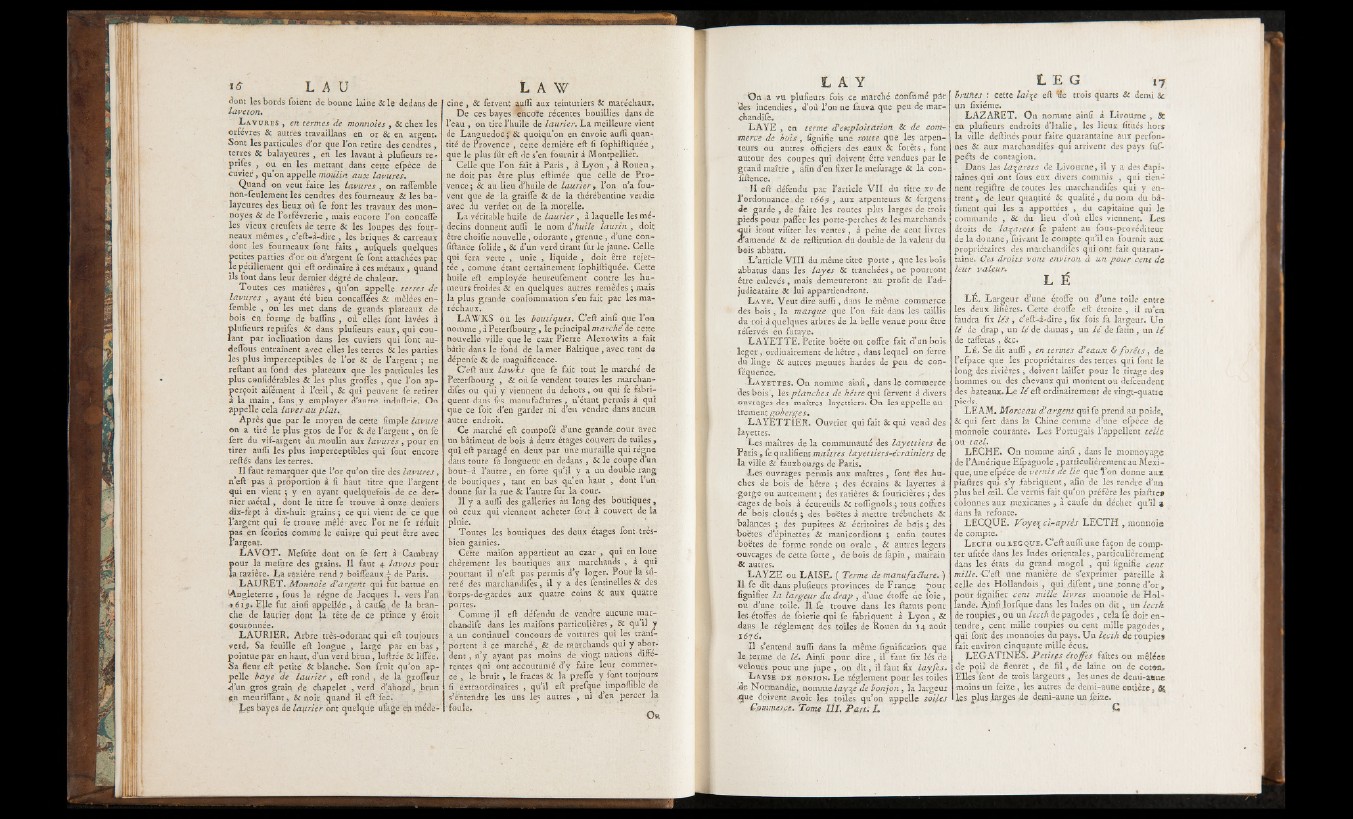
«<? L A U
dont les bords foient de bonne laine & le dedans de
lave ton,
L avures , en termes de monnoies , & chez les
orfèvres & autres travaillans en or & en argent.
Sont les particules d’or que l’on retire des cendres ,
terres & balayeures , en les lavant à plufîeurs re-
prifes , ou en les mettant dans cette efoèce de
cuvier, qu’on appelle moulin aux lavures.
Quand on veut faire les lavures , on raflèmble
non-feulement les cendres des fourneaux & les balayeures
des lieu* où fe font les travaux des înon-
noyes & de l’orfévrerje , mais encore l’on concaflè
les vieux ereufets de terre & les loupes des fourneaux
mêmes, c’eft«»â-dire , les briques & carreaux
dont les fourneaux font faits , aufquels quelques
petites parties .d’or ou d’argent fe font attachées par
le pétillement qui eft ordinaire à ces métaux , quand
ils font dans leur dernier degré de chaleur.
Toutes ces matières , qu’on appelle terres de
lavures , ayant été bien concaflees & mêlées en-
femble , on les met dans de grands plateaux de
bois en forn^e de badins , où elles font lavées à
plufîeurs reprifes & dans plufîeurs eaux, qui coulant
par inclination dans les cuviers qui font au-
deffous entraînent avec elles les terres & les parties
les plus imperceptibles dç l’or & de l’argent ; ne
reliant au fond des plateaux que les particules les
plus confîdérables & les plus groffes , que l’on ap-
perçoit aifément à l’oe il, & qui peuvent fe retirer
à la main , fans y employer d’autre induftrie. On
appelle cela laver au p la t .
Après que par le moyen de cètte fîmple lavure
on a tiré le plus gros de l’or & de l ’argent, on fe
fert du vif-argent du moulin aux la vu re s, pour en
tirer aud! les plus imperceptibles qui font encore
reliés dans les terres.
I l faut remarquer que l’or qu’on tire des lavu res,
n’eft pas à proportion à fi haut titre que l’argent
qui en vient ; y en ayant quelquefois de ce dernier
méçal, dont le titre fe trouve à onze deniers
dix-fept à dix-huit grains ; ce qui vient de ce que
l’argent qui fe trouve mêlé' avec l’or ne fe réduit
pas en fcories comme le cuivre qui peut être avec
l’argent.
L A V O T . Mefure dont on fe fert à Cambray
pour la mefere des grains. Il faut 4 lavots pour
la razière. L a razière rend 7 boiflfeaux 4 de Paris.
L A U R E T . Monnoie d’argeiït qui fut battue en
Angleterre, fous le régne de Jacques I.-vers l’an
* 6 1$ . Elle fut ainfî appeljée , à caufefde la branche
de laurier dont la tête 4e ce prince y étoic
Couronnée.
L A U R IE R . Arbre très-odorant qui eft toujours
verd. Sa feuille eft longue., large par en bas ,
pointue par en haut, d’un verd brun, luftrée & liftée.
Sa fleur çft petite & blanche. Son fruit qu’on appelle
baye de laurier , eft rond , d,e la grofteur
4 ’un gros grain 4e chapelet , verd d’abord,, brun
çn meu ridant > & noir quand il eft fec.
Jfes bayçs de laurier ont quelque ufage en rnéde-
L A ?
cine, & fervent aufli aux teinturiers & maréchaux.
De ces bayes ^encoTe récentes bouillies dans de
l’eau , on tire l’huile de laurier. L a meilleure vient
de Languedoc * & quoiqu’on en envoie aufli quantité
de Provence , cette dernière eft fi fophiftiquée ,
que le plus fur eft de s’en fournir à Montpellier.
Celle que l’on fait à Paris , à Lyon , à Rouen ,
ne doit pas être plus eftimée que celle de Provence
; & au lieu d’huile de laurier 9 l’on n’a fou-
vent que de la graifte & de la thérébentine verdie
avec du verdet ou de la morelle.
L a véritable huile de lau r ie r , à laquelle les médecins
donnent aufli le nom d'huile laurin , doit
être choifie nouvelle, odorante , grenue, d’une con-
fiftance folide , & d’un verd tirant fur le jaune. Celle
qui fera verte , unie , liquide , doit être rejet-
tée , comme étant certainement fophiftiquée. Cette
huile eft employée heureufement contre les humeurs
froides & en quelques autres remèdes ; mais
la plus grande confommation s’en fait par les maréchaux.
LAWKS ou les boutiques. C’eft ainfî que l’oa
nomme, à Peterfbourg, le principal marché de cette
nouvelle ville que le czar Pierre Alexowits a fait
bâtir dans le fond de la mer Baltique, avec tant de
dépenfe & de magnificence.
C’eft aux law k s que fe fait tout le marché de
Peterfbourg , & où fe vendent toutes les marchan-
difes ou qui y viennent du dehors, ou qui fe fabriquent
dans fes manufactures , n’étant permis à qui
que ce foit d’en garder ni d’en vendre dans aucun
.autre endroit.
Ce marché eft compofé d’une grande.cour avec
un bâtiment de bois à deux étages couvert de tuiles 9
qui eft partagé én deux par une muraille qui régne
dans toute fa longueur en dedans , & le coupe d’un
bout—à l’autre, en forte qu’jl y a un double rang
de boutiques, tant en bas qu’en haut , dont 1 unr
donne fur la rue & l’autre fur la cour.
Il y a aufli des galferies au lpng des boutiques,
! où ceux qui viennent acheter fout à couvert de là
pluie.
! Toutes les boutiques des deux étages font-très-
bien garnies.
Cette maifon appartient au czar , qui en loue
chèrement les boutiques aux marchands , a qui
pourtant il n’eft pas permis d’y loger. Pour la su—
reté des marchandifes, il y a des fentinelles & des
fcorps-de-gardes aux quatre coins Sç aux quatre
portes.
• Commè il eft défendu de vendre aucune mar-
| chandife dans les maifons particulières, & qu’il y
a un continuel concours dé voitures qui les transportent
à ce marché, & de marchands qui y abordent
, n’y ayant pas moins de vingt nations différentes
qni ont accoutumé d’y faire leur commerce
, le bruit , le fracas & la prefîe y font toujours
fi extraordinaires , qu’il eft p'refque ^impoflible de
s’ entendre les uns les autres , ni d’en percer la
foule*
Or
L A Y
On .a vu plufîeurs fois ce marché dônfumé pâr
«les incendies, d’où l’on ne fauva que peu de mar-
■ chandife.
L A Y E , en terme dl exploitation & de com~
merce de b o is , fignifîe une route que les arpenteurs
ou autres officiers des eaux & forêts, font
autour des coupes qui doivent être vendues par le
grand maître 0 afin d’en fixer le mefurage & la con-
fiftence.
Il eft défendu par l’article V II du titre xv de
l ’ordonnance. de 1669 , aux arpenteurs & fergens •
de garde , de faire les routes plus larges de trois
pieds pour paflèr les porte-perches & les marchands
ui iront vifiter les ventes , à peine de cent livres
’amendé & de reftitution du double de la valeur du
bois abbatu.
L ’article V II I du même titre porte , que les bois
abbatus dans les layes & tranchées, ne pourront
être enlevés, mais demeureront au profit de l’adjudicataire
& lui appartiendront.
L aye. Veut dire aufli, dans le même commerce
des bois , la marque que l ’on fait dans les taillis
du roi à quelques arbres de la belle venue pour être
réfervés en futaye.
L A Y E T T E . Petite bo'ëte ou coffre fait d’ un bois
leger, ordinairement de hêtre, dans lequel on ferre
du linge & autres menues hardes de peu de con-
léquence.
Layettes. On nomme ainfî, dans le commerce
des bois les planches de hêtre qui fervent à divers
ouvrages des maîtres layettiers. On les appelle autrement
goberges.
L A Y E T T IE R . Ouvrier qui fait & qui vend des
layettes.
Les maîtres de la communauté des layettiers de
Paris , fe qualifient maîtres layettiers-écrainiers de
la ville '& fauxbourgs de Paris.
Les ouvrages permis aux maîtres , font des huches
de bois de hêtre ; des écrains & layettes à
•gorge ou autrement ; des ratières & fouricières $ des
-cages de bois à écureuils & roflignols ; tous coffres
de bois cloués ; des boetes à mettre trébuchets &
balances $ des pupitres & ecritoires de bois $ des
-boetes d’épinettes & manicordions ; enfin toutes
bpëtes de forme ronde ou ovale , & autres légers
ouvrages de cette forte , de bois de lapin, mairain
& autres.
L A Y Z E ou LA ISE . ( Terme de manufacture. )
I l fe dit dans plufîeurs provinces de France pour
lignifier l a largeur du drap , d’une étoffe de loie,
ou d’une toile. Il fe trouve dans les ftatuts pour
les étoffes de foierie qui fe fabriquent à Lyon , &
•dans le réglement des toiles de Rouen du 14 août .1 6g 6,
•Il s’ entend aufli dans ia même lignification que
le terme de lé* Ainfl pour dire, il faut fix lés de
velours pour 'une jupe , on dît, il faut fix layfes,
Layse de bonjon. L e réglement pour les toiles
dp Normandie, nomme.lay^e de bonjon, la largeur
,^ue doivent avoir les toiles qu’on appelle toiles
Çpmwejfe, Tome ÏÜ . P a ru L
L E G 17
brUfies : cette lai\e eft d.e trois quarts & demi 3c
un fixiéme.
L A Z A R E T . On nomme ainfî à Livourne , 8c
en plufîeurs endroits d’Italie, les lieux fîtués hors
la ville deftinés pour faire quarantaine aux perfon-
nes & aux marchandifes qui arrivent des pays fuf*
peéls de contagion.
- Dans les lazarets de Livourne, il y a des Capitaines
qui ont fous eux divers commis , qui tiennent
regiftre de toutes les marchandifes qui y entrent
9 de leur quantité & qualité , du nom du bâtiment
qui les a apportées , du capitaine qui le
commande , & du lieu d’où elles viennent. Les
droits de lazarets fe paient au fous-provéditeur
de la douane, fuivant le compte qu’il en fournit aux.
propriétaires des marchandifes qui ont fait quarantaine
« Ces droits vont environ- à un pour cent de
leur valeur*
L Ë
L É . Largeur d’une étoffe ou d’une toile entre
les deux lifîères. Cette étoffe eft étroite , il m’ en
faudra fix l é s , c’eft-à-dire, fîx .fois ,fa largeur. Un
lé de drap , un .// de damas, un l é de fatin, un l é
de taffetas , &c.
L é , Se dit aufli , en termes d'eaux & fo r ê t s , de
l’efpace que les propriétaires des terres qui font le
i long des rivièrps , doivent laiflèr pour le tirage des
hommes ou des chevaux qui montent ou defcendenc
des bateaux. L e l é eft ordinairement de vingt-quatre
pieds.
L E AM. Morceau d’argent qui fe prend au poids,
& qui fert dans la Chine comme -d’une elpèce de
monnoie courante. Les Portugais l’appellent telle
ou tael.
LECH E . On nomme ainfî j dans le monnoyage
de l’Amérique Efpaguole, particulièrement au Mexique,
une efpéce de vernis de lie que l ’on donne aux
piaftres qui- s’y fabriquent, afin de les rendre d’un
plus bel ,oeil. Ce vernis fait qu’on préfère les piaftres
colonnes aux mexicanes , à caufe du déchet qu’il a
dans la refonte.
LECQUÈ, Voye\.ciraprès L E C TH , monnoie
de compte. '
L ecth ouxeg que, C’eft aufli une façon de compter
ufitée dans les Indes orientales, particulièrement
dans les états du grand mogol , qui fignifîe cent
mille. C ’eft une manière de s’ exprimer pareille a
.cefte des Hollandois , qui .difent, une .tonne d’or ,
pour fignifier cent mille livres monnoie de H o llande.
Ajinfî forfque dans les Indes on dit , un lecth
de roupies, ou un lecth de pagodes , cela fe doit entendre
, cent mille roupies ou cent mille pagodes,
qui .font des monnaies du pays. Un lecth de roupies
fait environ cinquante mille écus.
L E G A T IN ES. Petites étoffes faites ou mêlées
de poil de fleuret , de f i l , de laine ou de cotén.
Elles font de trois largeurs ., les unes de demi-atme
moins un feize, les autres de demi-aune entière,
les plus larges de d.emi-aune un feize.
G