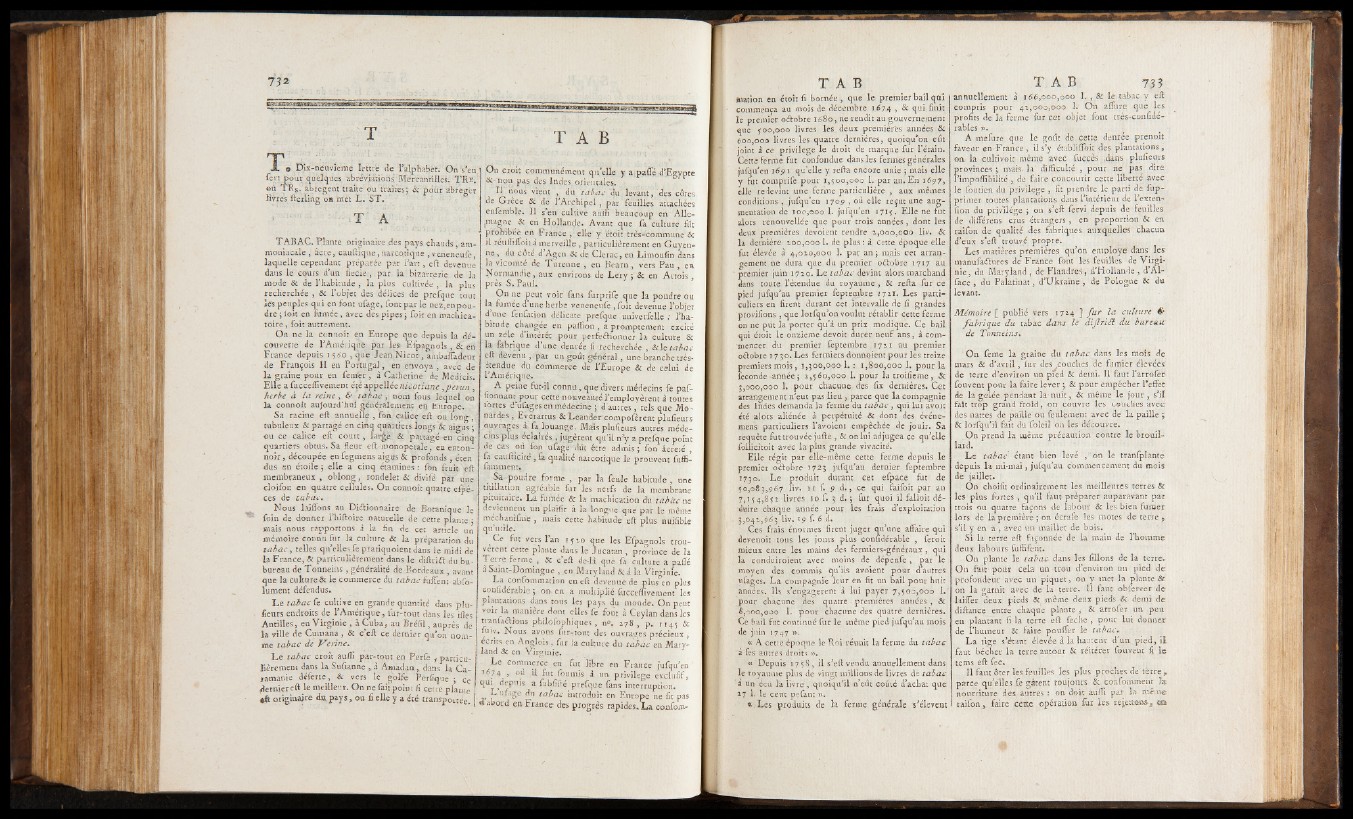
7 5 2
T
I '9 Dix-néüvieme fert pour quelques abrléevttiraet:i ondse. TMaélprchaanbtè'i’lfl.e sO. nT'sR*eh e.
loiüvr eTsR ft se-rAlibnrgè goenn tm terta ite ou traites} & pour Abj-èoér L . ST .
- T A
TA BA C . Plante originaire .des pays chauds, ammoniacale
, âcre, câuftique, narcotique , veneneufe
laquelle cependant préparée par l'ar t, eft devenue
dans le cours d’un ficelé, par la bizarrerie de la
mode & de l’habitude , la plus cultivée la plus
recherchée , & l’objet des délices de prefque tout
îê's peuples qui en font ufage, font par le nez,en poudre
; (oit en fumée, avec des pipes 3 fok en machica-
toire, foit autrement.
On ne la connoît en Europe que- depuis la découverte
de l’Amérique par les’ Espagnols ,& eti
France depuis 15 0 0 , que Jean Nicoè, ambafladeur
de François II en Portugal, en envoya , avec de
la graine pour en fertfèr , à Catherine de Medrcis.
Elle a fucccflivëment été appellée nicotiane ype tun,
herbe à la reine, & t à b a c y nom fous lequel on
la connoît aujourd’hui généralement en Europe.
Sa racine eft annuelle , fon calice eft ou long I
tubuleux & partagé en cinq quartiers longs & aigus :
ou ce calice eft court, large. & partagé en cinq
quartiers obtus. Sa fleur elLmonopetale, en entonnoir
, découpée en fegmens aigus & profonds , éten
dus en étoile ; elle a cinq étamines: fbn fruit eft
membraneux , oblong, rondelet &. divifé pâr une
cloifoc en quatre cellules. On connoît quatre efpè-
ces de tabac.
Nous lai {Tons au Dictionnaire de Botanique le
foin de donner l’hiftoire naturelle de cette plante •
mais nous rapportons à la fin tie cet article un
mémoire connu fur la culture & la préparation du
ta b a c , telles qu’elles fe pratiquaient dans le midi de
la France, & particulièrement dans le diftriét du bu-
bureau de Tonneins , généralité de Bordeaux , avant
que la culture & le commerce du tabac fulfent abfo-
lument défendus.
L e tabac fe cultive en grande quantité dans plusieurs
endroits de l’Amérique, lur-tout dans les ifles
Antilles, eu Virginie, à Cuba, au Bréfil, auprès de
la ville de Cumana , & c’eft ce dernier qu’on nomme
tabac de Verine.
L e tabac croît auffi par-tout en Perfe , particu- i
lièrement dans la Sufianne , à Âmadan, dans la Ca-
jamar.ie déferte, & vers le golfe Perfique • ce
dernier eft le meilleur. On ne fait point fi cecce plante
*ft ordinaire du. p ays, ou fi elle y a été transportée.
T A B
|On croit communément qu’elle y a paffé d’Egypte
:&- non pas des Indes, orientales.
Tl nous vient , du tabac du levant, des côtes
de Grece & dé l’Archipel, par feuilles attachées
enfemble. Il s en cultive autfi beaucoup en Allemagne
& en Hollande. Avant que fa culture fut
piobibéè en France , elle y étoit très-commune &
il reufliffoit a merveille , particulièrement en Guyenne
, du côte d’Agen & de Clerac, en Limoufîn dans
la vicomté de Turenne , en Béarn, vers Pau, en
Normandie, aux environs de Lery 5 & en Artois,
près S. Paul,
On ne peut voir fans furprife que la poudre ou
la fumée d une herbe veneneufe ,foit devenue l’objet
d une fenfation délicate prefque univerfelle : l’habitude
changée en paflion , a promptement excité
un zélé d intérêt pour perfectionner la culture &
la- fabrique d une denrée f i recherchée , 8 t\e tab ac
eft devenu , par un goût général, une branche très-
étendue du commerce de l’Europe & de celui de
l’Amérique.
A peine fut-il connu, que divers médecins fe paff
fionnanc pour cette nouveauté l’employèrent à toutes
iortes d’ufagès en médecine 3 d'autres , tels que Mo-
nafdes, Everartus & Leander compofèrent plufieurs
ouyrages a fa louange. Mais plufieurs autres médecins
plus écjairés , jugèrent qu’il n’ÿ a prefque point
de cas ou fon ufage ïlut être admis 3 fon âcreté ,
fa caufticice , fa qualité narcotique le prouvent fuifi-
famment.
- Sa-poudre forme , par la feule habitude , une
titillation agréable fur les nerfs de la membrane
pituitaire. La fumée & la machicatîon du tabac ne
deviennent un plarfir à ia longue que par le même
méchanifme , mais cette habitude eft plus nuifible
qu’utile.
vCe fut vers I an 15 10 que les Efpagnols trouvèrent
cette plante dans le Jucatan , province de la
Terre-ferme y & c eft dedà que fa culture a paffé
à Saint-Domingue , ,en Maryland & à la Virginie.
La confommatron en eft devenue de plus en plus
confidérable 3 on. en a multiplié firccefïüvement les
plantations dans toits les pays du monde. On peut
voir la manière dont elles fe fout à Çeylan dans les
tranfaétions philofophiques , n°. 1 7 8 , p . 114 5 &
fuiv. Nous avons fur-tout des ouvrages précieux ,
écrits en Anglois, fur la culture du tabac, en Maryland
& en virginie.
L e commerce en fut libre en France jufqu’en
Tf7 4 > ou il fut fournis à un privilège exclufif,
qui depuis a fubfîfté prefque fans interruption.
—* ufage du tabac introduit en Europe ne fit pas
« abord en France des progrès rapides. L a confom-
T A B
«ration en étoit fi bornée , que le premier bail qui
commença au mois de décembre 1674 , & qui finit
le premier oCtobre 1680, ne rendit au gouvernement
que 500,000 livres les deux premières années &
600,000 livres les quatre dernières, quoiqu’on eût
joint à ce privilège le droit de marque fur l ’étain.
Cette ferme fut confondue dans les fermes générales
jufqu’en 1 69 r qu’elle y refta encore unie ; mais elle
y fur comprife pour 1,500,000 1. par an. En 1697,
elle redevint une ferme particulière , aux mêmes
conditions ,_jufqu’en 1709 , ou elle reçut une augmentation
de 100,000 1. jufqu’en 17 15 . Elle ne fut
alors renouvellée que pour trois années, dont les
deux premières dévoient rendre 2,000,000 liv. &
la dernière zoo,.000 1. de plus : à cette époque elle
fut élevée à 4,0x0,000 1. par an$ mais cet arrangement
ne dura que du premier octobre 17 17 au.
premier juin 17 10 . Le tabac devint alors marchand
dans toute l’étendue du royaume , & refta fur ce
pied jufqu’au premier fepteçqbre 17 21. Les particuliers
en firent durant cet intervalle de fi grandes
provifions , que lorfqu’on voulut rétablir cette ferme
on ne prit la porter qu’à un prix modiqûë. Ce bail
qui étoit le onzième devoir durer neuf ans, à commencer
du premier feptembre 17 x 1 au premier
octobre 1730. Les fermiers donnpient pour les treize
premiers m ois, 1,300,000 1. : 1,800,000 1. pour la
fécondé minée 3 2,560,006 1. pour la troifieme, &
3.000. 000 1. pour chacune des fix dernières. Cet
arrangement n’eut pas lieu , parce que la compagnie
des Indes demanda la ferme du tabac , qui lui avoir
été alors aliénée à perpétuité & dont des événe-
mens particuliers l’avoient empêchée de jouir. Sa
requête fut trouvée jufte, & on lui adjugea ce qu’elle
follicitoit avec la plus grande vivacité.
Elle régit par elle-même cette ferme depuis le
premier oCtobre 1723 jufqu’au dernier feptembre
1730. L e produit durant, cet efpace fut de
50,083,96.7 liv. 1 1 f. 9 d ., ce qui faifoit par an
7,154,852 livres 10 f. 3 d. 3 fur quoi il falloit déduire
chaque année pour les frais d’exploitation
3,042,963 liv. 1 9 f. 6 d.
Ces frais énormes'firent juger qu’une affaire qui'
devenôit tous les jours plus confidérable , feroit
mieux entre les mains des fermiers-généraux, qui
la conduiroient avec moins de dépenfe , par le
moyen des commis qu’ils avoient pour d’autres
ufages. La. compagnie leur en fit un bail pour huit
années. Ils s’engagèrent à lui payer 7,500,900 1.'
pour chacune des quatre premières années , &
8.000. 000 1. pour chacune des quatre dernières-.
Ce bail fut continué fur le même pied jufqu’au mois
de juin [747 ».
« A cette époque le Roi réunit la ferme du tabac
à fes autres'droits ».
« Depuis i 7-5 8 , il s’ eft vendu annuellement dans
le royaume plus de vingt millions de livres de tabac
à un écu la livre , quoiqu’il n’eût coûté d’achat que
17 1. le cent pefant ».
« Les produits de la ferme générale s’élèvent
T A B 753
annuellement à 166,000,000 1. , & le tabac y eft
compris pour 42,000,000 1. On affùre que les
profits de la ferme fur cet objet font très-confidé-
rabies ».
A mefure que le goût de. cette denrée prenoit
faveur en France, il s’y établifloit des plantations,
on la eultivoie même avec fuccès .dans plufieurs
provinces 3 mais, la difficulté , pour ne pas dire
î’impoffibilité , de faire concourir cette liberté avec
le fogtien du privilège , fit prendre le parti de fup-
primer toutes plantations dans l’intérieur de l’exten-
fion du privilège 3 on s’eft fervi depuis de feuilles
de différens crus étrangers, en proportion & en
raifon de qualité des fabriques auxquelles chacun
d’eux s’eft trouvé propre.
Les matières premières qu’on employé dans les
manufactures de France font les feuilles de Virginie,
du Maryland , de Flandres , d’Hollande , d’Al-
face , du Paîadnat, d’Ukraine , de Pologne & du
levant.
Mémoire [ publié vers 1724 ] fu r la culture &
fa brique du tabac dans le diflrict du bureau
de Tonneins.
On feme la graine du tabac dans les mois de
mars & d’avril, lur des .couches de fumier élevéès'
de terre d’environ un pied & demi. Il faut l’arrofer
fouvent pour la faire lever 3 & pour empêcher l’effet
de la gelée pendant la nuit, & même le jour, s’il
fait trop grand froid, on couvre les couches avec
des nattes de paille ou feulement avec de la paille 5
& lorfqu’il fait du foleil on les découvre.
On prend la même précaution contre le brouillard.
L e tabac étant bien levé , on le tranfplante
depuis la mi-mai, jufqu’au commencement du mois
de juillet.
On choifit ordinairement les meilleures terres &
les plus fortes , qu’il faut préparer auparavant par
trois ou quatre façons de labour & les bien fumer
lors de la première 3 on écrafe Tés motes de terre 9
I s’il y en a , avec un maillet de bois.
1 Si 1a terre eft façonnée de la main de l’homme
deux labours fuffifent.
1 On plante le tabac dans les filions de la terre.
| On foit pour cela un trou d’environ un pied de
| profondeur avec un piquet, on y met la plante &
on la garnit avec dé la terre. Il faut obferver de-
laiffer deux pieds & même deux pieds & demi de
diftance entre chaque plante , & arrofer un peu
en plantant fi la terre eft feche , pour lui donner
de l’humeur & faire pouffer le tabac*
L a tige s’étant élevée à la hauteur d’un pied, il
faut bêcher la terre autour & réitérer fouveiit fi le
tems eft fec.
Il faut ôter les feuilles les plus proches dé terre ,
parce qu’elles fe gâtent toujours & ecmfomment la
. nourriture des autres : on doit aufîi par la. riîêiite
raifon , foire cette opération fur les rejettons-,
lll
!
T.