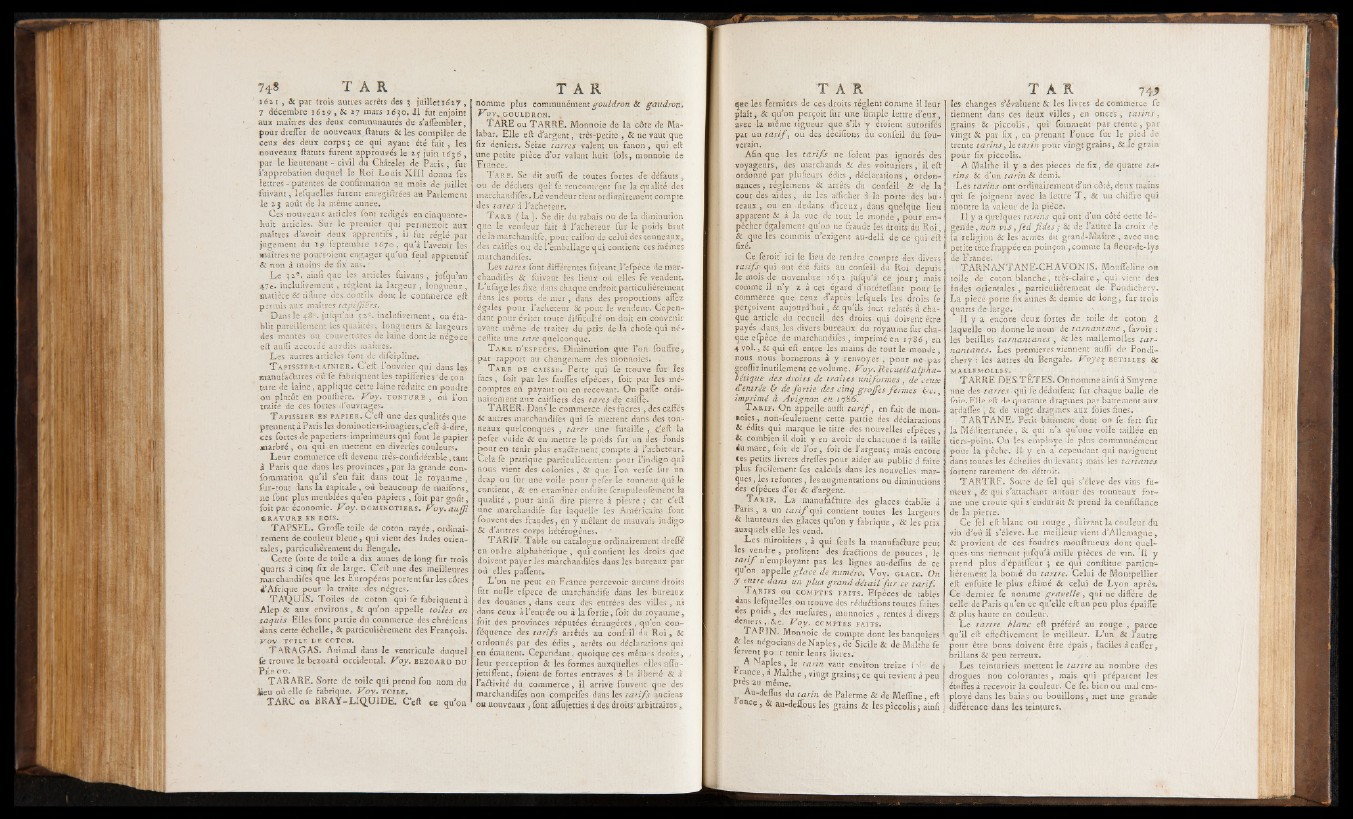
7 4* T A R
i 6z i , & par trois autres arrêts des 3 juillet 16 17 f
7 décembre i6zp , & 27 mars 1630. I l fut enjoint
aux maîtres des deux communautés de s’aflembler,
pour drefTer de nouveaux ftatuts & les compiler de
ceux des deux corps ; ce qui ayant été fait , les
nouveaux ftatuts furent approuvés le i f juin 1636 ,
par le lieutenant - civil du Châtelet de Pa ris, fur
l'approbation duquel le Roi Louis X I II donna fes
lettres - patentes de confirmation au mois de juillet
fuivant, lefquelles furent enregiftréeS au Parlement
le 1 3 août de la même année.
Ces-nouveaux articles font rédigés en cinquante-
huit articles. Sur le premier qui permettoit aux
maîtres d’avoir deux apprentifs., il fut réglé par
jugement du 19. feptembre 16 70 , qu’à l’avenir les
maîtres ne pourraient engager qu’un feul apprentif
8c non à moins de fix ans. -
L e 32e. ainfi que les articles fuivans , jufqu’au
47c. inclufivement , règlent la largeur , longueur ,
matière & tiilure des-coutils dont le commerce eft
permis aux maîtres tapijjiers. .
Dans le 48e. jufqu’au 52e. inclufivement, on établit
pareillement les qualités-, longueurs & largeurs
dés mantes ou couvertures de laine donc le négoce
eft auffi accordé auxdits maîcrés.
Lés autres articlesfont de difcipline.
TAPrssiÉR'LAiNrER. C’eft l’ouvrier qui dans les
manufaécures"c'îi"fe fabriquent les tapifTerie^ de ton
tare de laine, applique cette lame réduite en poudre
ou plutôt en poulfiere. Voy. tonturé , où l’on
traite de ces fortes d’ouvrages. ,
TAPïssiBR en p a p ie r . C’eft une des qualités que
prennent à Paris les dominociers-imagiers, c’eft-à-dire,
ces fortes de papetiers-imprimeurs qui font le papier
marbré, ou qui en mettent en diverfes couleurs.
Leur commerce eft devenu crès-confidérable, tant
a Paris que dans les provinces, par la grande con-
fommation qu’il s’en fait dans tout le royaume,
fur-tout dans la capitale, où beaucoup de maifons>
ne font plus meublées qu’en papiers , foie par goût,
foit par économie. Voy. d gm in o t ie r s . Voy. etufji
6 R A V U R E EN EO IS .
TA P SE L . Greffe toile de coton rayée., ordinairement
de couleur bleue, qui vient des Indes orientales,
particulièrement du Bengale.
Cette forte de toile a dix aunes de long fur trois
quarts à cinq fix de large. G’eft une des meilleures
marchandifes'que les Européens portent fur les côtes
d’Afrique pour la traite des négreS. :
TAQU IS. Toiles dé coton qui fe fabriquent à
Alep & aux environs, & qu’on appelle toiles en
taquis Elles font partie du commerce des chrétiens
dans cette échelle, <Sc particulièrement des François.
y o y - t o i l e d e c o t o n .
TA RAG A S . Animal dans le ventricule duquel
fe trouve le bezoard occidental. Voy. b e zo a rd ou
P é r o u .
TA RA R E . Sorte de toile qui prend fou nom du
lieu où elle fe fabrique. Voy. to il e .
TA RC ou B R A Y -LIQUIDE. C’eft ce qu’on •
T A R
nomme plus communément gouldron 8c gaudron
Æ'foy,,. GOULDRON. ,
T A R E ou TA RR E. Monnoie de la côte dé Malabar.
Elle eft dJ argent, très-petite , & ne vaut que
fix deniers. Seize tarres valent un fanon, qui, eft
une petite pièce d’or valant huit fols, monnoie de
France.
T a r e . Se dit auffi de toutes fortes de défauts,
ou de déchets qui-fe rencontrent fur la-qualité des
marchandifes. Le vendeur tient or dînai renient compte
des tares- à l’acheteur.
T a r e ( la ). Se dit du rabais ou de la diminution
que-- le vendeur fait à l’acheteur fur le poids brut
de la maichandife, pour raifon de celui des tonneaux,
des cailles 014 de l’emballage qui contient ces mêmes
marchandifes.
Les tares font différentes fuivantvl ’efpèce dé marchandifes
& fuivant les lieux où elles fe vendent.
L*ufagelesNfîxè dans chaque endroit particulièrement
dans les ports de mer , dans des proportions allez
égales pour l’acheteur & pour le vendeur. Cependant
pour éviter toute difficulté on doit en convenir
avant meme de traiter du prix delà cliofe qui né-»
ceffite une tare quelconque.-
T a r e d’ esp ece s . Diminution que l’on fouftre9
par rapport au changement des monnoies*
T are de c a is s e . Perte qui fe trouve fur■ les
facs, foit par les faillies efpèces, foit par les mécomptes
en payant;.ou en recevant. On- palfe ordinairement
aux caiffiers des tares dé caille.
T ARER. Dans le commerce dés lucres , des caffés
& autres marchandifes qui fe mettent dans des tonneaux
quelconques , tarer une futaille , c’eft la
pefer vuide &. en- mettre le poids fur un des fonds
pour en- tenir plus exactement compte à i’acheteur».
Cela fe pratique particulièrement pour l’indigo qui-
: nous vient des colonies ƒ & que/ l’on verfe fur un
' drap ou fur une voile pour pefer le tonneau qui le
contient, & en examiner- en-fuite fcrupuleufètnént la
qualité , pour ainfi dire pierre à pierre ; car c’eft
Une màrchandife fur laquelle les Américains font
fouvenr des fraudes-, én y mêlant de mauvais indigo
& d’autres -corps hétérogènes. '
TA R IF . Table ou catalogue ordinairement dreffe
en ordre alphabétique , qui contient les droits que
doivent payer les marchandifes dans les bureaux par
où elles paffentv
L ’on ne peut en France percevoir aucuns droits
fur nulle efpece de marchàndife dans les bureaux
des douanes, dans ceux des entrées des villes , ni
dans ceux à l’entréfc ou à la fortie, foie du royaume ,
foit des provinces réputées étrangères , qu’en con-
féquence des tarifs arrêtés au confeil du R o i, &
ordonnés par des édits , arrêts ou déclarations qui
en émanent. Cependant, quoique ces mêmes droits9
leur perception & les formes auxquelles elles affu-
jettiffent, foienfr de fortes entraves à- la liberté-& à
1 activité du commerce , il arrive fouvent que des
marchandifes non comprifes dans les tarifs anciens
ou nouveaux, font affujetties à des droits' arbitraires â
T A R
que le s fe rm ie rs de ces droits rè g len t Comme il leur
plaît, & qu’on perçoit for une fimple lettre d’eux,
avec la même rigueur que s’ils y étaient autorifés
p a r un tarifa ou des décifions du confeil du fou-
verain.
Afin que les tarifs ne foient pas ignorés des
voyageurs, des marchands & des -voituriers, il eft
ordonné par plufieurs édits, déclarations ) ordonnances
, réglemens & arrêts du confeil & de la
cour des aidés , de les afficher à la- porte des bu r
e a u x ou en-.dedans d’iceux j dans quelque lieu
apparent & à la vue de tout le monde, pour empêcher
également qu’ou ne fraude les droits du Roi,
& que les commis n’exigent au-delà de ce qui eft
fixé.'
Ce feroit ici le lieu de rendre compte des divers tarifs- qui ont été faits, au confeil du Roi depuis
le mois de novembre 1632 jüfqu’à ce jour j mais
comme il n’y ' a à cet égard d’intéreffant pour le
commerce que ceux d’après lefquels les droits fe .
perçoivent aujourd’hui, & qu’ils font relatés â chaque
article du recueil des droits qui.doivent être
payés dans^les divers bureaux du royaume fur chaque
elpèce de. marchandifes, imprimé en 1786 , en
.4 vol., & qui eft entre les mains de tout le monde,
nous nous bornerons à y renvoyer, pour ne pas
groffir inutilement ce volume. 'Voy. Recueil alpha-
bétique des droits de traites uniformes, de ceux
d'entrée & de fortie des cinq grojfes fermes &c.
imprimé à Avignon en ij%6 .
T a r i f . On appelle auffi tarifa en fait de mongoles
, non-feulement cette partie des déclarations
& édits qui marque le titre des nouvelles efpèces,
& combien il doit y en avoir de chacune à la taille
du marc, foit de l’o r , foit de l’argent j mais encore
ces petits livrets dreffés pour aider au public à faire
plus facilement fes calculs dans les nouvelles marques
, les refontes, les augmentations ou diminutions
des efpèces d’or & d’argent.
T a r i f . La manufacture des glaces établie à
Paris, a un ta rif qui contient toutes les largeurs
& hauteurs des glaces qu’on y fabrique, & les prix
auxquels elle les vend.
Les miroitiers , à qui feuls la manufacture peut
les vendre, profitent des fractions de pouces , le tarif n employant pas les lignes au-deffus de ce
qu on appelle glace de numéro. Voy. glace. On
y entre dans un plus grand détail fu r ce ta rif
T a r i f s ou comptes faits. Efpèces de tables
dans lefquelles on trouve des réductions toutes faites
des poids, des mefures , monnoies rentes à divers
deniers,.& c. Voy. comptes faits.
T A P îN. Monnoie de compte dont les banquiers
& les négocians de Naples, de Sicile & de Malthe fe
îervent po r tenir leurs livres/
A Naples, le tarin vaut environ treize fois) de
h rance, à Malthe , vingt grains : ce qui revient à peu
près au même.
Au-deflus du tarin de Palerme & de Meftine, eft
oace, & aa-deflous les grains & les piccolis j ainfi
T A R 74*
les changes s’évaluent & les livres de commerce fe
tiennent dans ces deux villes, en onces , ta r in s ,
■ grains & piccolis , qui fomment par trente , par
vingt & par fix , en prenant l ’once fur le pied de
| trente tarins, le tarin polir vingt grains, &.le grain
pour fix piccolis.
A Malthe il y a des pièces de fix, de quatre tarins
& d’un tarin & demi.
Les tarins ont ordinairement d’un côté, deux mains
qui fe joignent avec la lettre T , & un chiffre qui
montre la valeur'de la pièce.
Il y a quelques tarins qui ont d’un côté cette légende,
non v i s f e d fid e s ,• 8c de l ’autre la croix de
la religion & les armes du grand-Maîcre avec une
petite tête frappée en poinçon, comme la fleur-de-lys
de France^
T ARMANT ANE-CHAV ON IS. Mouffeline on
toile de coton, blanche, très-claire , qui vient des
Indes orientales', particulièrement de Pondichéry.
La piece porte fix aunes & demie de long, fur trois
quarts de large*
11 y a encore deux fortes de toile de coton à
laquelle on donne le nom de tarnantane , favoir :
les betilles tarnantaneS, & les mallemolles tar-
nantcines. Les premières viennent auffi de Pondichéry
: les autres du Bengale. Voye^ b e t il l e s &
MALLEMOLLES.
TA RR E DES T E T E S . On nomme ainfi à Smyrne
une des tarres - qui fe déduifent fur chaque balle de
foie. Elle eft de quarante dragmes par battement aux
ardaffes , & de vingt dragmes aux foies fines.
TA R T AN E . Petit bâtiment donc on fe fort for
la Méditerranée, & qui n’a qu’une voile taillée en
tiers-pbifit. On les employé'ùc plus communément
pour la pêche. Il- y en a cependant qui naviguent
dans toutes les échelles du levant 3 mais les tartanes
fortent rarement du détroit.
T A R T R E . Sorte de fel qui s’élève des vins fu»
nieux , & qui s’attachant autour des to-nneaux forme
une croûte qui s’endurcit & prend la confiftartce
de la pierre.
Ce fel eft blanc ou rouge , fuivant la couleur du
vin d’où il s’élève. Le meilleur vient d’Allemagne,
& provient de ces foudres monftnjeux dont quelques
uns tiennent jufqu’à mille pièces de vin. Il y
prend plus d’épaiffeur 3 ee qui conftitue particulièrement
la bonté du tartre. Celui de Montpellier
eft enfuite le plus eftimé & celui de Lyon après.
Ce dernier fe nomme g ra v e lle , qui ne diffère de
celle de Paris qu’en ce qu’elle eft un peu plus épaiflè
& plus haute en couleur.
- Le tartre blanc eft préféré au rouge , parce
qu’il eft effectivement le meilleur. L ’un & l’autre
pour être bons doivent être épais , faciles à cafter y
brillans & peu terreux.
Les teinturiers mettent le tartre au nombre des
drogues non colorantes, mais qui préparent 1er
étoffes à recevoir la cpuleur. Ce fei bien ou mal employé
dans les baias ou bouillons, met une grandie
différence dans les teintures.