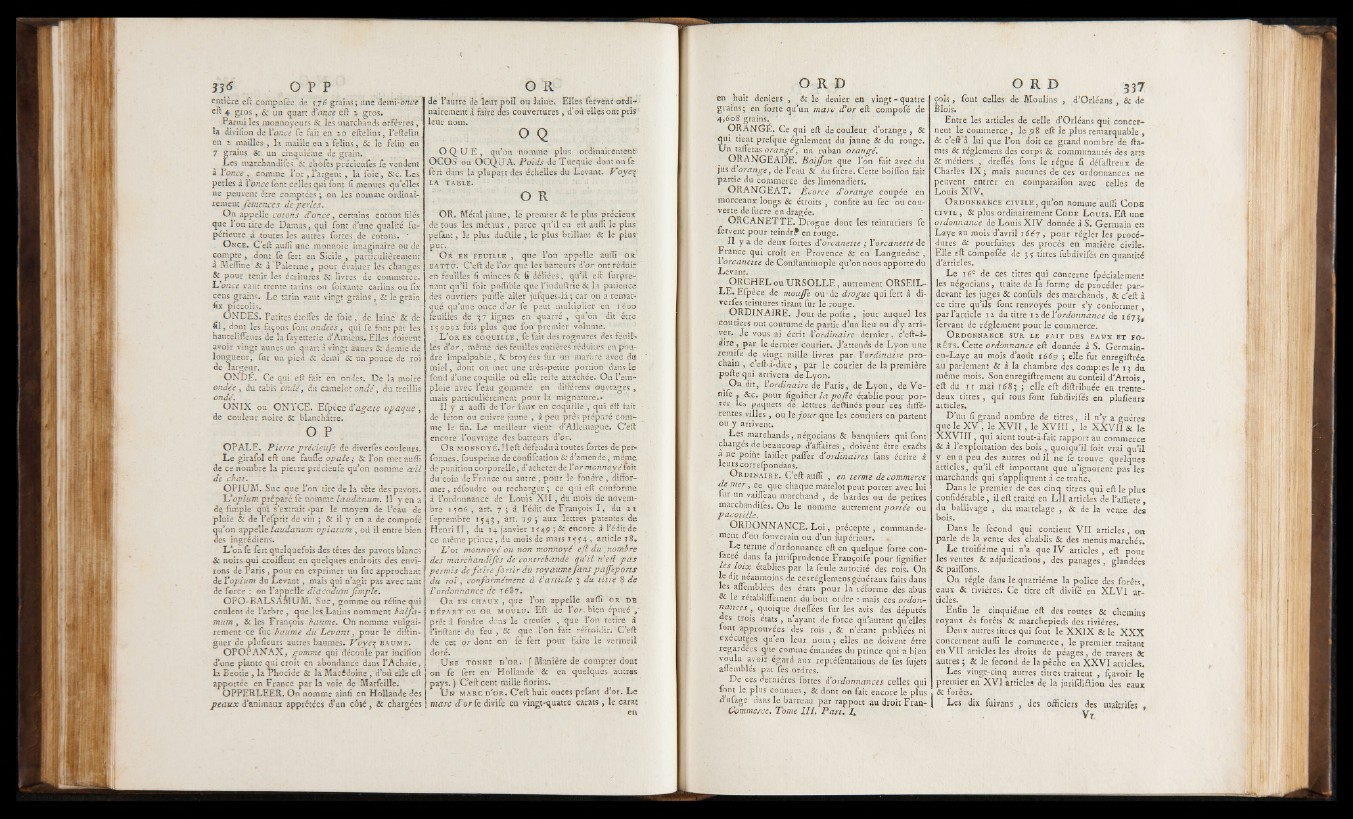
entière eft compoféc de 5.7 6 grains ; une demi-o/z££
cil 4 gros , & un quart d’oncs eft z gros.
Parmi les monnoyeurs & les marchands orfèvres, '
la divifion de Y once fe fait en 2-0 eftelins, l’eftelin
en z mailles , la maille en a félins, & le félin en
7 grains & un cinquième de grain.
Les marchandifes & choies précienfes fe vendent
à Y once , comme l’or , 1 argent , la foie, &ç. Les
perles a Yonce font celles qui font fi menues qu'elles
ne peuvent être comptées ; on les nomme ordinairement
femences de perles.
On appelle cotons et once, certains cotons filés
que lontire.de Damas, qui font d'une qualité fu-
peneure a toutes les autres fortes de cotons. *
O nce. C’eft aufli une monnoie imaginaire ou de
compte, dont fe fert en Sicile » particulièrement
a Meifiue & à Pâlerme , pour évaluer les changes
& pour tenir les écritures &. livres de commerce.
L once vaut trente tarins ou foixante carlins ou fix
cens grains. L e tarin vaut vingt grains , & le grain
fix piccoüs.
ONDES. Petites étoffes de foie, de laine & de
« 1 , dont les façons font ondées , qui fe font par les
hauteliffeurs de la fayetterie d'Amiens. Elles doivent !
avoir vingt aunes un quart à vingt aunes St demie de
longueur, fur un pied & demi & Un pouce de roi
de largeur.
ONDE. Ce qui eft fait en ondes. De la moire
ondée , du tabis onde, du camelot ondé, du-treillis
onde.
O N IX ou ONYCE. Efpèce $ agate opaque ,
de couleur noire & blanchâtre.
O P
OPA LE . Pie rre précieufe de diverfes couleurs.
L e girafol eft une faufle opale ; & l’on met aufli
de ce nombre la pierre précieufe qu’on nomme oe il
de chat.
OPIUM. Suc que Ton tire de la tête des pavots.
U opium préparé fe homme laudanum. Il y en ai
de. fimple qui s’extrait -par le moyen de l'eau de
pluie & de l'efprit de vin ; & il y en a de compofé
qu'on appelle laudanum opiatum , où il entre bien
des ingrédiens.
L'on fe fért quelquefois des têtes des pavots blancs
& noirs-qui croilfent en quelques endroits des environs
de Paris , pour en exprimer un fuc approchant
de Y opium du Levant , mais qui n'agit pas avec tant
de force : on l’appelle diacoauyn Jimple.
OPO-BALSAMUM. Suc, gomme ou réfine qui
coulent de l’arbre, que les Latins nomment b alfa -
mum, & les François baume. On nomme vulgairement
-ce fuc baume du L e va n t, pour le distinguer
de plufieurs autres baumes. Voyc3 b a um e .
O PO PANA X , gomme qui découle par incifîôn
d une plante qui croît en abondance dans l'Achaïe,
la Beotie , la Phocide & la Macédoine, d’où elle eft
apportée en France par la voie de Marfeille.
OPPERLEER. On nomme ainfi en Hollande des
p ta u x d’animaux apprêtées d’un côté 3 & chargées
de l’autre de leur poil ou laine. Elles ferveur ordinairement
a faire des couvertures , d’où elles otit pris
leur nom.
o Q
O Q U E , qu’on nomme plus ordinairement
OCOS ou OCQUA. Po ids de Turquie dont on fe
fert dans la plupart des échelles du Levant. P o y e£
LA TABLE.
O R
OR. Métal {aune, le premier & le plus précieux
de tous les. métaux , parce qu’il en eft aufli le plus
péfant, le plus duétiie , le plus brillant & le plus
pur.
OA en f e u il l e , que l’on appelle aufli or.
b a t t u . C'eft de l'or que les batteurs d’or ont réduit;
en feuilles fi minces & fi déliées, qu’il eft fur'prégnant
qu’il foit poflible que l’induftrie & la patience
des ouvriers puiflè aller jufques-là ; car qn a remarqué
qu’une once d’or fe peu.t multiplier en 1600
feuilles de 37 lignes eti quarré , qu’on dit être
ï^poçz fois plus que fon‘ premier volume.
L ’or en co q u il le, fe fait des rognures des fëuiL
les d’ô r , même des feuilles entières réduites en poudre
Impalpable, & broyées fur un marbre avec dit
miel, donc on met une très-petite portion dans le
fond d’une coquille où elle relie attachée. On l’emploie
avec l’eau gommée en différens ouvrages ,
mais particulièrement pour la mignattire.-
Il y a aufli deTor faux en coquille , qui eft fait
de léton ou cuivre jaune , à peu près préparé comme
le fin. Le meilleur vient d’Allemagne. C’eft
encore l’ouvrage des batteurs d’or.
O r m o n n o y é . Il eft défendu à toutes fortes de per-
fonnes, fous peine deconfifcation & d’amende, même
de punition corporelle ; d’acheter de l'or monnoyéfoit
du coin de France ou autre , pour le fondre y diffor-
mer, réfoudre ou recharger3 ce qui eft conforme
à l’ordonnance de Louis X I I , du mois de novembre
1 506 , art. 7 5 a. l’édit de François I , du z i
feptembre 15 4 3 , art. 15? ; aux lettres patentes de
Henri I I , du 14 janvier 1Ç49 ; & encore à l’ édit de
ce même prince , du mois de mars 1554 , article i8 .
L ’ or monnoyé ou non monnoyé efl d u , nombre
des marchandifes de contrebande qu’i l n’efl p a s
permis de fa ir e fo rtir du royaume fa n s pajfeports
du r o i , conformément à Varticle 3 du titre 8 de
Vordonnance de 1687.
O r en chaux , que l’on appelle aufli or d e
d é p a r t ou or m o u lu . Eft de l’or.bien épuré’,'
prêt à fondre dans“ le creufet , que l’on retire à
l’in fiant du feu , & que l’on fai: refroidir. C’eft
de cet or dont en fe fert pour faire le vermeil
doré.
U ne tonne d’o r . - ( Manière de compter donc
on fe fert en Hollande' & en quelques autres
pays. ) C’eft cent mille florins.
U n' m a r c d’o r . C’eft huit onces pefant d’or. L e
marc d'or fe divife en vingt-quatre carats, le carat
en
en huit deniers , & le denier en vingt - quatre
grains; en forte qu’un marc d’or eft compofé de
4,668 grains.
ORANGÉ. Ce qui eft de couleur d’orange , &
qui tient prefque également du jaune & du rouge.
Un taffetas orangé, un ruban orangé.
ORANGEADE. Boijfon que l’on fait avec du
jus d orange, de l’eau & du fucre. Cette boiffon fait'
partie du commerce des limonadiers.
O R AN G EA T . Écorce d’orange coupée en,
morceaux longs & étroits , confite au fec ou couverte
de fucre en dragée. '
ORCANETT E . Drogue dont lés' teinturiers fe
fervent pour teindr? en rouge.
Il y a de deux fortes à’orcanette ; Yorcanette de
France qui croît en Provence & en Languedoc ,
1 orcanette de Conftantinople qu’on nous apporte du
Levant,
ORGHEL ou U R SO L L E , autrement ORSEIL-
-LE. Elpece, de mouffe ou • dé drogue qui fert à diverfes
teintures tirant fur le rouge.
ORDINAIRE. Jour de pofte , jour auquel les
couriers ont coutume de partir d’un lieu ou d’y arri-
vçr. Je vous ai écrit Vordinaire dernier, c’eft-à-
dirq, par le dernier Courier. J ’attends de Lyon une
reniife de vingt'mille livres par Y ordinaire prochain
, c’eft-à-dire , par le Courier de la première
pofte qui arrivera de Lyon.
I dit, Y ordinaire de Paris, de Lyo n , de Ve-
nife , &c. pour fignifîer la p o jle établie pour por-
tér les paquets, de. lettres deftiné s pour ces différentes
villes , ou le jo u r que les couriers en partent
ou y arrivent.
Les^ marchands, négocians & banquiers qui font1
charges de beaucoup d’affaires,,- doivent être exaéls
a ne point laifler palier d’ordinaires fans écrire à
leurs.correfpondans.
O r d i n a i r e . C’eft aufli , en terme de commerce
de m<?r, .çe que chaque matelot peut porter avec lui
iur un vaifleau marchand , de hardes ou de petites
marchandifes. On le nomme autrement portée ou
pa.cotille.
ORDONNANCE. L o i , précepte, commandement
d un fouverain ou d’un fupérieur. *
L e ternie d’ordonnance eft en quelque forte con-
facre dans la juriiprudence Françoife pour fignifîer
les lo ix établies par la feule autorité des rois. On
le dit néanmoins de ces réglemens généraux faits dans
les a Semblées des états pour la réforme des abus
& le rétabliffement du bon ordre : mais ces ordondes
trois états, n’ayant de force qù’autant qu’elles
lont approuvées des rois,, & n’étant publiées ni
exécutées qu’en Leur nom ; elles ne doivent être
regardées que comme émanées du prince qui ‘a bien
voulu avoir égard aux repréfèntations de fes fujets
anemblés par fes ordres.
De ces dernieres fortes d’ordonnances celles qui
font le. plus connues, & dont on fait encore le plus
d’ufage dans le barreau par rapport au droit Fran-
Commerce. Tome I I L P a r t . I .
ç o î s , fo n t c e lle s de M o u lin s , d’O r lé an s , & de
B lo is .
Entre les articles de celle d’Orléans qui concernent
le commerce, le p8 eft le pius remarquable ,
& c’eft â lui que l’on doit ce grand nombre de fta-
tuts & réglemens des corps & communautés des arts
& métiers , drefles. fous le régne fi défaftreux de
Charlês IX ; mais aucunes de ces ordonnances ne
peuvent entrer en eomparaifon avec celles de
Louis XIV..
O rdonnance c iv i l e , qu’on nomme aufli G odæ
c iv il , & plus ordinairement C ode L o u is . Eft une
ordonnance de Louis X IV donnée à S. Germain en
Laye au mois d’avril 16 6 7 , pour régler les procédures
8c pourfuites des procès en matière civile.
Elle eft compofée de 3 5 titres fubdivifés en quantité
d’àrticlès.
L e 16e de ces titres qui concerne ipécialemenÉ
les négocians , traite de la forme de procéder par-
devant les juges & confuls des marchands, & c’eft à
ce titre qu’ils font renvoyés pour s’y conformer
par l’article iz du titre 1 2 de Yordonnance de 1673,
fervant de réglement pour le commerce.
O rdonnance su r le f a it des e a u x e t for
e t s . Cette ordonnance eft donnée à S. Germain-
en-Laye au mois d’aoùt 1 669 ; elle fut enregiftrée.
au parlement & à la chambre des comptes le 13 du.
même mois. Son enregiftrement au confeil d’Artois ,
eft du 1 1 mai 1683-; elle eft diftribuée en trente-
deux titres , qui tous font fubdivifés en plufieurs
articles.
D’un fi grand nombre de titres, il n’y a o-uères
que le X V , le X V I I , le X V III , le X X V I I& le
X X V I I I , qui aient tout-à-fait rapport au commerce
& à l’exploitation des bois , quoiqu’il foit vrai qu’il
V en a peu des autres où il ne fe trouve quelques
articles, qu’il eft important que n’ignorent pas les
marchands qui s’appliquent â ce trafîci
Dans le premier de ces cinq titres qui eft le plus
confîdérable, il eft traité en LII. articles de l’aflÀete ,
du ballivage , du martelage , & de la vente des
bois.
D an s le fécond q u i contient V I I a r t ic le s , o n
p a r le de la vente des chablis & des menus m a rch é s .
L e troifiéme qui n’a que IV articles , eft pour
les ventes & adjudications, des panages , glandées
& paiiïbns.
O n ré g ie dans le quatrièm e la p o lic e des fo rê t s ,
e au x & riv iè re s . C e titre eft d ivifé en X L V l a rticles.
Enfin le cinquième eft des routes & chemins
royaux ès forêts & marchepieds des rivières.
Deux autres titres qui font le X X I X & le X X X
concernent aufli le commerce, le premier traitant
eh V I I articles les droits de péages, de travers 8c
autres ; & le fécond de la pêche en X X V I articles.
L e s v in g t-c in q autres titres traitent , fç a vo ir le
p rem ie r en X V I artic le s de la ju r ifd i& io n des eaux
& forê ts.
Les dix fuivans , des officiers des maîtrifes ,
V ï,