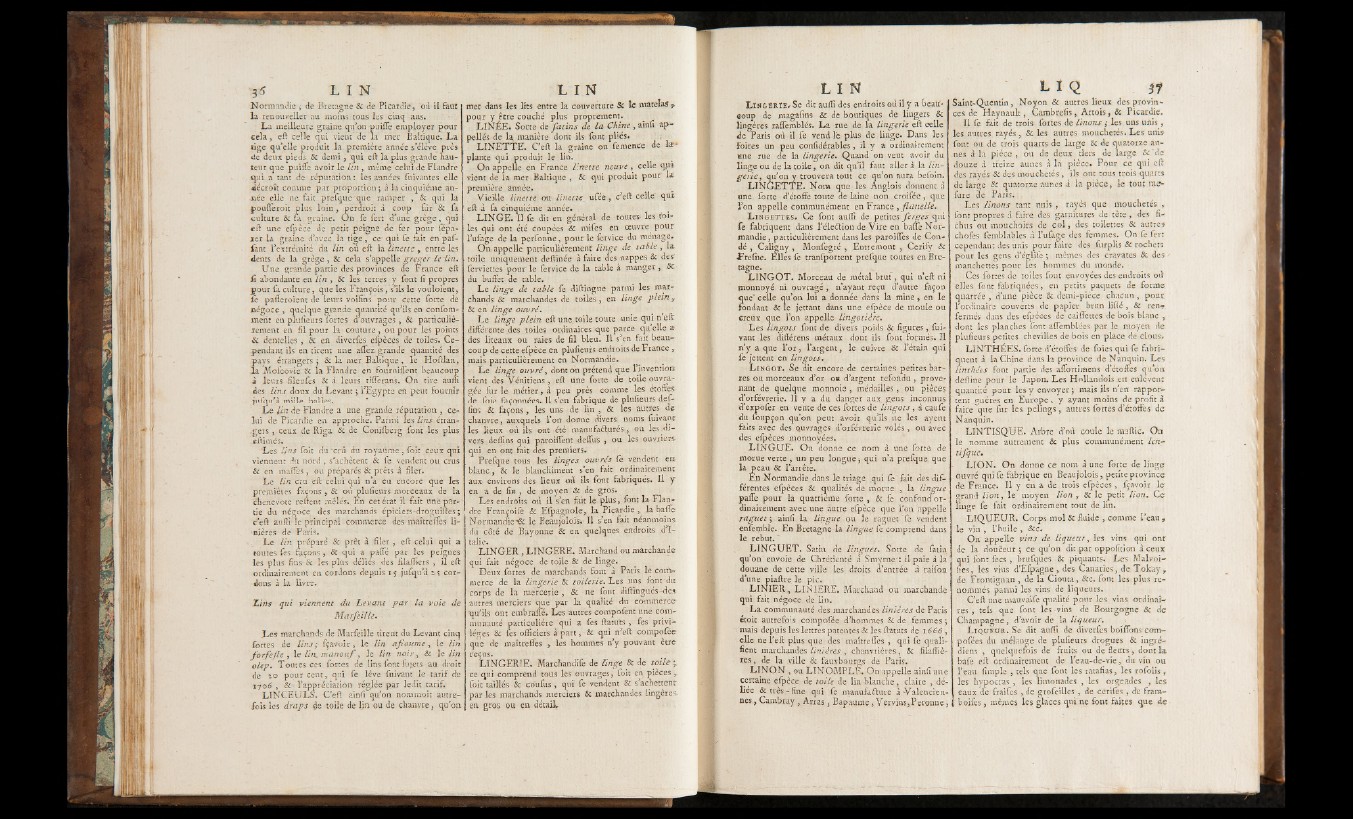
3 S L I N
Normandie 3 de Bretagne & de Picardie, où il faut
la renouveller au moins tous les cinq ans.
L a meilleure graine qu’on puiflfe employer pour
c e la , eft celle qui vient de la mer Baltique. La
lige qu’elle produit la. première année s’élève près-
de deux pieds & demi, qui eft la plus grande hauteur
que puifle avoir le lin , même celui de Flandre
qui. a tant de réputation. : les années fuivantes elle
décroît comme par proportion ; à la ciuquiéme année
elle ne fait prefque'que ramper , & qui la
poufièroit plus loin , perdroi: a coup fur & fa
culture & fa . graine. On r fe fert d’une grège, qui
eft une efpèce. de petit peigne de fer pour fépa-
xer la graine d’avec la tige, ce' qui fe fait en paf-
fant l’extrémité du lin où eft la tinette , entre les
dents de la grège, & cela s’appelle grever le-lin.
Une grande partie des provinces de France eft
fi abondante en tin , & les terres y font fî propres
pour fa culture, que les François, s’ils le youloient,
le pafferoient de leurs voifîhs pour cette forte de
négoce , quelque grande quantité qu’ils en confom-
merit en plufieurs fortes d ouvrages , & particulièrement
en fil pour la couture, ou pour les points
& dentelles , & en diverfes efpèces de toiles. Cependant
ils en tirent une aflez grande quantité des
pays étrangers j & la mer Baltique , le Hoftlan, 1
la Mofcovie' & la Flandre en fourniiTent beaucoup à leurs -fileufes & à leurs rifferans. On tire aufîi
des lins doux du Levant j l’Egypte en peut fournir
jufqu’à mille balles.
L e lin de Flandre a une grande réputation , celui
de Picardie en approche. Pafrni les tins étrangers
ceux de Riga & de Conifberg font les plus
eftimés.
Les Uns foit du -crû du royaume, foie ceux qui
viennent du nord , s’achètent & fe vendent pu crus
& en maiTes , - ou préparés & prêts à filer.
Le lin cru eft celui qui n’a eu encore que les
premières façons , & où plufieurs morceaux de la
cheneVote relient mêlés.. En cêtécat il fait unfe partie
du négocei dés marchands épiciers-droguiftes;
c’eft aufîi- le principal commerce des maîtreffes li-
«ières de Paris. 7
L e tin préparé & prêt à filer , eft celui qui a
toutes fes façons-, & qui a paffé par les pexgùes
les plus fins & les plus déliés des filaffiers , il eft
ordinairement en cordons depuis 15 jufqu’à 2.s cordons
à la livre.
JLiiis qui viennent du Levant p a r la voie de
Marfeille.
L e s marchands de Marfeilîe tirent du Levant cinq
fortes de lins ; fçav'oir, le lin afioume , le tin
fo rfe fte , le tin. m a n o u f, le lin no ir, & le lin
olep. Toutes ces fortes de lins font fujets au droit
de 20 pour cent, qui fe lève fnivant le tarif de
1706 , & l’appréciation réglée p.ar ledît_tarif.
L IN C EU L S . C’eft ainfi qu’on nommo.it autrefois
les draps de toile de lin ou de chanvre, qu’on
L I N
met dans les Ihs entre la couverture & le matelas ?
pour y être couché plus proprement.
L IN É E . Sorte de fa tin s de la Chine , ainfi ap-
pellés de la manière donc ils font pliés. -,
L IN E T T E . C’eft la graine ou femence de !* •
plante qui produit le lin.
On appelle en France tinette neuve , celle qj-i®
vient de la mer Baltique , & qui produit pour 1#
première année.
Vieille tinette ou tinette ufée, c?eft celle qui
eft à fa cinquième année»
L IN G E . Il fe dit en général de toutes- les toiles
qui ont été coupées & mifes en oeuvre^ pour
l’ufage de la perfonne, pour le fetvice du ménagé»
On appelle particulièrement Linge de table , la
toile uniquement deftinée à faire des nappes & des
ferviettes pour le fervice de la table à manger, .&
du buffet de table.
Le linge de table fe diftingue parmi les marchands
& marchandes de toiles, en linge p le in y
& en linge oicvré. . . ,
Le linge p le in eft une. toile toute unie qui n eft"
différente des toiles ordinaires que parce qu elle tt
des liteaux ou raies de fil bleu. Il s’en fait beau—
l coup de cette efpèce en plufieurs endroits de France ,-
mais particulièrement en Normandie.
L e linge ouvré ^ dont on prétend que l’invention
vient des vénitiens , eft une forte de toile ouvra-
1 gée fur le- métier, à peu près comme les étoffes
de foie façonnées. Il s’en fabrique de plufieurs def-
fins & façons , les uns de lin , & les autres de
chanvre, auxquels l’on donne divers noms fuivant
les lieux où ils ont été manufaélurés , ou les .divers,
deffins qui paroiflènt deffus , ou les ouvriers-
qui en ont fait des premiers»
Prefque tous les linges ouvres fe vendent en>
blanc., & le blanchiment s’en fait ordinairement
aux- environs des lieux où ils font fabriqués. Il g
en a de fi» , de moyen & de gros.
Les endroits où il s’en fait le plus, font la Flandre
Françoifé & Efpagnole, la Picardie , la baffe
Normandie-^ le Beaujoloisv II s’en fait néanmoins-
du côté dé Bayonne & eu quelques endroits d’I talie.
L IN G E R , L IN G ER E . Marchand ou marchande
qui fait négoce de toile & de linge.
Deux fortes de marchands font à Paris le coriv»
merce de la lingerie & toilerie. Les uns font du
corps de la mercerie , & ne font diftingùés-des
autres merciers que par la qualité du commerce
qu’ils ont embraffé. Les autres compofent une communauté
particulière qui a fes ftatuts , fes privilèges
& fes officiers a part, qui n’eft compofée
que de maîtreffes , les. hommes n’y pouvant être
reçus.
L IN G ER IE . Marchandîfe de linge & de toile \
ce qui comprend tous les ouvrages, foit en pièces ,,
foit taillés & coufus, qui fe vendent & s’achettent
par les marchands merciers & marchandes lingères
en gros ou en détail»
L I N
LiNGÈUïE* Se dit auflï des endroits où il y a beatt-
coup de magafins & de boutiques de lingers &
lingères raffemblés. L a rue de la lingerie eft celle
de Paris où il fe vend lie plus de linge. Dans les ;
foires un peu confidérables, il y a ordinairement
«ne rue de la lingerie. Quand on veut avoir du
linge ou de la toile, on dit qu’il faut aller à la lingerie
, qu’on y trouvera tout ce qu’on aura befoin.
L IN G E T T E . Nom que les Anglois donnent d
une forte d’étoffe toute de laine non croifée, que
l’on appelle communément en France, flanelle.
Lingettes. Ce font auffi de petites ferg es qui
fe fabriquent dans l’éleétion de Vire en baffe Nor- I
mandie, particulièrement dans les paroifïès de Con-
dé , Caligny , Monfegré , Entremont , Cerify &
-Freine. Elles fè tranfportent prefque toutes en Bretagne.
L IN G O T . Morceau de métal brut, qui n’eft ni
monnoyé ni ouvragé, n’ayant reçu d’autre façon
que” celle qu’on lui a donnée dans la mine, en le
fondant & le jettant dans une efpèce de moule ou
creux que l’on appelle lingotière.
Les lingots font de divers poids & figures , fuivant
les diftérens métaux dont ils font formés. Il
n’y a que l’o r , l’argent, le cuivre & l’étain qui
fe jettent en lingots.
Lingot, Se dit encore de certaines petites bar-
tes ou morceaux d’or oa d’argent refondu , provenant
de quelque monnoie , médailles, ou pièces
d’orfèvrerie. Il y a du danger aux. gens inconnus
d’expôfer en vente de ces fortes de lingots, à caufe
du foupçon qu’on peut avoir qu’ils ne les ayent
faits avec des Quvrages d’orfèvrerie volés , ou avec
des efpèces monnoyées.
L IN G U E . On donne ce nom à une forte de
morue verte , un peu longue 3 qui n’a prefque, que
la peau & l’arrête.
En Normandie dans le triage .qui fe'fait des différentes
efpèces & qualités de morue , la lingue
pafle pour la quatrième forte , & fe confond ordinairement
avec une autre efpèce que l’on appelle
raguet ; ainfi la lingue ou le raguet fc vendent
enfetpble. En Bretagne la lingue fe comprend dans
le rebut.'
L IN G U E T . Satin ne linguet. Sorte de latin
qu’on envoie de Chrétienté à Smyrne': il paie à la
douane de cette ville les droits d’entrée à raifon
d’une piaftre le pic.
L IN IE R , LIN 1ERE. Marchand ou marchande
qui fait négoce de lin.
L a communauté des marchandes tinières de Paris
étoit autrefois *cdmpofée d’hommes & de femmes }
mais depuis les lettres patentes & les ftatuts de 1 666,
elle ne l’eft plus que des maîtreffes , qui fe qualifient
marchandes tinières , chanvrières, & filaffiè-
xes, de la ville & fauxbourgs de Paris,
L IN O N , ou LINOMPLE. On appeile ainfi une
certaine efpèce de toile de lin blanche, claire /déliée
& très-fine qui fe manufa&ure à Valenciennes,
Cambray , A rras, Bapaume, Vervins,Peronne,
L Ï Q i l
Saint-Quentin, Noyon & autres lieux des provinces
de H a yn au lt, Cambrefis , A r to is , & Picardie.
Il fe fait de trois fortes de linons ; les uns unis ,
les autres rayés , & les autres mouchetés. Les unis
font ou de trois quarts de large & de quatorze aulnes
à la pièce , ou de deux tiers de large &~de‘
douze à treize aunes a la pièce» Pour ce qui eft
des rayés & des mouchetés, ils ont tous trois quarts
de large & quatorze .aunes à la pièce, le tout m o
fure de Paris..
Les linons tant unis , rayés que mouchetés ,
font propres a faire des garnitures de tête , des fi^
chus ou mouchoirs de c o l , des toilettes & autres
chofes femblables à l’ufàge des femmes. On fe fert
cependant des unis pour faire des furplis & rochers
pour les gens d’églife 5 mêmes des cravates & des -
manchettes pour les hommes du monde.
Ces fortes de toiles font envoyées des endroits où
elles font fabriquées, en petits paquets de forme
quarrée , d’une pièce & demi-pièce chacun , pour
l’ordinaire couverts de papier brun liffé, & renfermés
dans des efpèces de caiffettes de bois blanc ,
dont les planches font aflemble.es par le moyen de
plufieurs petites chevilles de bois en place dé clous.
L IN TH É E S . forte d’étoffes de foies qui fe fabriquent
à la Chine dans la province de Nanquin. Les
linthe'es font partie des afîortimens d’étoffes qu’on
deftine pour le Japon. Les Hollandois .en enlèvent
quantité pour les y envoyer j mais ils n’en rapportent
guères en Europe, y ayant moins de profit a
faire que fur les pelings, autres fortes d’étoffes de
Nanquin.
L INT ISQ U E . Arbre d’où coule le maftic. On
le nomme autrement & plus communément tin -
tifque» .
LIO N. On donne ce nom d une forte de linge
ouvré’ qui fe fabrique en Beau jolois, petite province
de France. Il y en a de trois efpèces , fçavoir le
grand lion , le moyen lion , & le petit lion. Ce
linge fe fait ordinairement tout de lin.
LIQ U EUR . Corps mol & fluide , comme l’eau y
le vin , l’huile , &c.
On appelle vins de liqueur, les vins qui onr
de la douceur j ce qu’on dit par oppofition a ceux
qui font fecs , brufques & piquants. Les Malvoi-
fies, les vins d’Efpagne , des Canaries, de T o k a y,
de Frontignan , de la Ciouta, &c. font les plus renommés
parmi les vins de liqueurs.
C’eft une mauvaife qualité pour les vins ordinaires
, tels que font les vins de Bourgogne & de
Champagne, d’avoir de la liqueur.
Liqueur. Se dit aufîi de diverfes boïffons com-
pofées du mélange de plufieurs drogues & ingré-
diens , quelquefois de fruits ou de flectrs, dont la.
bafe eft ordinairement de 1 eau-de-vie, du vin ou
l’eau fimple , tels que font les ratafias, les rofolis ,
les hypocras , les limonades , les orgeades , les eaux de fraifes ,de grofeilles , de cerifés , de frarn-
boifes, mêmes les glaces qui ne font faites que de