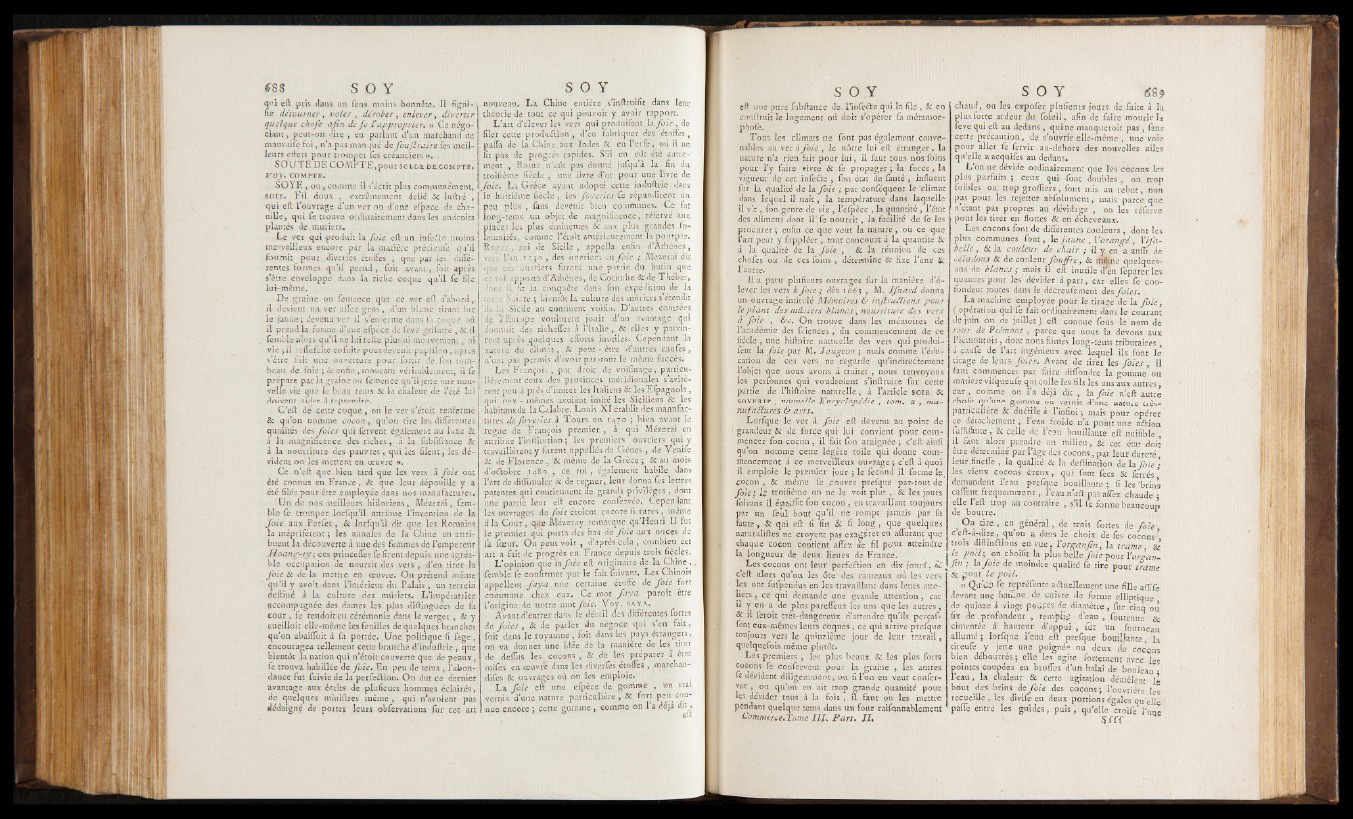
"■> e.ft p lis dans un fens moins honnête. Il -fignî-
e détourner, voler., dérober , enlever, divertir
quelque chofe afin de j e Vapproprier. « Ce négociant
, peut-on dire , en parlant d*un marchand de
mauvaife foi, n’a pas manqué de foujlraire fes meilleurs
effets pour tromper fes créanciers ».
SO U T E DE COM P T E ,pour solde dé com pté.
voy. COM PTE .
SO Y E , ou, comme il s’écrit plus communément,
■so ie . F il doux , extrêmement délié & luftré ,
qui eft l’ouvrage d’un ver ou d’une efpece de chenille,
qui fe trouve ordinairement dans les endroits
plantés de mûriers.
Le ver qui produit la Jo ie eft un.infeéle moins
merveilleux encore par 4a matière précieufe qu’il
fournit pour diveifes étoffes , que par les différentes
formes qu’il prend, foit avant, foit après
s’être enveloppé dans la riche coque qu’il fe file
lui-même.
De graine ou femeoce que ce ver eft d’abord,
il devient un ver allez gros, d’un blanc tirant fur
le jaune ; devenu ver il s’enferme dans la coque ou
il prend la forme d’une elpcce de fève grifàtre ,& il
femble alors qu’il ne lui relie plus ni mouvement, ni
vie ;i l reffiifcite enfuite pour devenir papillon , après
s’être fait une ouverture pour fortir de fon tombeau
de foie ; & enfin, mourant véritablement, il fe
prépare par la graine ou femence qu’il jette une nouvelle
vie que le beau tems. & la chaleur de l’été lui
doivent aider à reprendre.
C’eft de cette coque , où le ver s’étoit renfermé
& qu’on nomme cocon, qu’on tire les différentes,
qualités des Jo ie s qui fervent également au luxe &
à la magnificence des riches, à la fubfiftance &
à la nourriture des pauvres, qui les filent, les dévident
ou les mettent en oeuvre ».
Ce n’eft que bien tard que les vers à fo ie ont
été connus en France, & que leur dépouille y a
été filée pour être employée dans nos manufactures.
Un de nos meilleurs hiftoriens, Mézerai, femble
fe tromper lorfqu’il attribue l’invention de la
jo ie aux Perfes , _& lorfqu’il dit que les Romains
la méprifèrent ; les annales de la Chine en attribuent
la découverte à une des femmes de l’empereur
Hoang-ty ; ces princeffes fe firent depuis une agréable
occupation de nourrir des vers , d’en tirer la
Jo ie & de la mettre en oeuvre. On prétend même
qu’il y avo<t-dans l’intérieur du Palais , un terrein
deftiné à la culture -des mûriers. L ’impcratrice
accompagnée des dames les plus diftinguées de fa
cour , fe rendoit en cérémonie dans le verger , & y
eueilloit elle^même les feuilles de quelques branches
qu’on abaiffoit à fa portée. Une politique fi fage,
encouragea tellement cette branche d’induftrie , que
bientôt la nation qui n’étoit couverte que de peaux,
fe trouva habillée de Jo ie . En peu de tems, l’abondance
fut fuivie de la perfection. On dut ce dernier
avantage aux écrits de plufieurs hommes éclairés,
de quelques miniftres même , qui n’avoient pas
dédaigné de porter leurs pbfervations fur cet art
nouveau. L a Chine entière s’inftruifit dans leur
théorie de tout ce qui pouvoit y avoir rapport.
L ’art d’éléver les vers qui produifent la Jo ie , de
filer cette production , d’en fabriquer des étoffes,
paffa de la Chine aux Indes & en Perfe, où il ne
fit pas de progrès rapides. S’il en eût été autrement
, Rome , n’eût pas donné jufqu’à la fin du
troifième fiècle , une livre d’or ppur une livre de
Jo ie . L a Grèce ayant adopté cette induftrie dans
le huitième fiècle , les Joyeries fe répandirent un
peu plus , fans devenir bien communes. Ce fut
long-tems un objet de magnificence, réfervé aux
places les plus éminentes & aux plus grandes foie
mnités, comme l’étoit antérieurement la pourpre.
Roo-ér , roi de Sicile , appclla enfin d’Athènes,
vers l’an 1 13 0 , des ouvriers en fo ie ; Mezerai dit
que cés ouvriers furent une pu:ie du butin que
ce roi apporta d’Athènes, de Corinthe & de Thèbes,
dont il ht la conquête dans fon expédition de la
terre Scie te ; bientôt la culture des mûriers s’étendit
de la Sicile au continent voifin. D’autres contrées
de l ’Europe voulurent jouir d’un .avantage qui
donnoit des richeffes à l’ Italie , & elles y parvinrent
après quelques efforts, inutiles. Cependant la
nature du climat, & peut - être d’autres eau fes ,
n’ont pas permis d’avoir par-tout le même lue ce s.
Les François , par droit de voifin âgé, particulièrement
ceux -des provinces méridionales s’avisèrent
peu à près d’imiter les Italiens & les Efpagnols,
qui eux - mêmes, avoient imité les Siciliens & les
habitansde la Calabre. Louis X I établit des manufactures
dé Joyeries à Tours en 1470 ; bien avant le
reo-ne de, François premier , à qui Mézerai en
attribue l’inflitution ; les premiers ouvriers qui y
travaillèrent y furent appellés de Gènes ., de Venife
& de Florence , & même de la Grèce ; & au mois
d’o&obre 14.80 , ce ro i, également habile dans
l’art de diffimuler & de regner, leur donna fes lettres
patentes qui contiennent de grands privilèges , dont
une' partie leur eft encore confervée. Cependant
les ouvrages de fo ie étoient encore fi rares, même
à la Cour , que Mézeray remarque qu'Henri II fut
le premier qui porta des bas de fo ie aux noces de
fa foeur. On peut voir , d’après cela , combien cet
art a fait de progrès en France depuis trois fiècles.
L ’opinion que-la fo ie eft originaire de la Chine,
femble fe confirmer par le faitfuiyant, Les Chinois
appellent f a y a u n t certaine étoffe de fo ie fort
commune chez eux. Ce mot fa-ya paroit etre
l’origine de notre mot fo ie . Voy. sa y a.
Avant d’entrer dans le détail des differentes fortes
de fo ies y & de parler du négoce qui s’en fait,
foit dans le royaume , foit dans les pays étrangers,
on va donner une idée de la manière de les^ tirer
de deffus les cocons , & de les préparer a être
mifes en oeuvre dans les diverfes étoffes , marcha«-
difes & ouvrages ou on les emploie.
L a fo ie eft une efpèce de gomme , tin vrai
vernis d’une nature particulière, & fort peu connue
encore ; çette gomme, comme ou l’a déjà dit.
eft une pure fiibftan.ee de. i’infe&e qui la file, & en
confirait le logement où doit s’opérer fa métamor-
phofè.
Tous les climats ne font pas également convenables
au ver à fo ie , le nôtre lui eft étranger, la
nature n’a rien fait pour lui, il faut tous nos foins
pour l’y faire vivre & fe propager ; la force , la
vigueur de cet infeéle ,. fon état de fanté , influent
fur la qualité de la fo ie ; par conféquent le ’climat
dans lequel il naît, la température dans laquelle
il v it, fon genre de vie , l’efpèce , la quantité, l’état
des alimens dont i l 1 fs nourrit, la facilité de fe les
procurer ; enfin ce que veut la nature, ou ce que
l’art peut y fuppléer , tout concourt à la quantité &
à la qualité de la fo ie , & la réunion de ces
chofes ou de ees foins , détermine & fixe l’une &
l ’autre.
Il a paru plufieurs ouvrages fur la manière d’élever
les vers à fo ie ; dès 1665 , M. ïfn a rd donna
un ouvrage intitulé Mémoires & inflruclions pour
le plant des mû riers blancs y nourriture des vers
à fo ie -, &c. On trouve dans les mémoires de
l’académie des fciences , du commencement de ce
fiècle , une hiftoire naturelle des vers qui produifent
la fo ie par M. Jaugeon ; mais comme l’éducation
de ces vers ne regarde qu’indireélément
lobjet que nous avons à traiter , nous' renvoyons
les perfonnes qui voudroient s’infiruire fur cette
partie de l’hiftoire naturelle, à l ’article soie &
S O Y E R IE , nouvelle Encyclopédie , tom. 2 , manufactures
& arts.
Lorfque le ver à fo ie eft devenu au point de
grandeur & de force qui lui convient pour commencer
fon cocon , il fait fon araignée 5 c’eft ainfi
qu’on nomme cette légère toile qui donne commencement
à ce merveilleux ouvrage ; c’eft à quoi
il emploie le premier jour ; le fécond il forme le
^ocon , & même fe f ouvre prefque par-tout de
fo ïè ; 6v troifième on ne le voit plus-, & les jours
fuivans il éüafifit fon cocon, en travaillant toujours
par un feul bout qu’il ne rompt jamais par fa
faute, & qui eft fi fin & fi long , que quelque*
naturaliftes ne croyent pas en affurant que
chaque cocon contient affez de fil pour atteindre
la longueur de deux lieues de France.
Les cocons ont leur perfection en dix jour£, £ ,
c,eft alors qu’on les ôte des rameaux où les vers
les ont fufpendus en les travaillant dans leurs atteints
; ce qui demande une grande attention, car
il y en a de plus pareftèux les uns que les autres,
& il feroit très-dangereux d’attendre qu’ils perçaf-
fent eux-mêmes leurs coques , ce qui arrive prefque
toujours vers le quinzième jour de leur travail,
quelquefois même plutôt.
Les premiers , les plus beaux & les plus forts
cocons fe çorifervent pour la ; graine , les autres
fe dévident diligemment, ou fi l’on en veut confer-
ver , ou qu’on en ait trop grande quantité pour
les devider tous à la fois , il faut ou les mettre
pendant quelque tems dans un four raifonnablement tomme rce,Tcme III. Part. XX,
chaud, ou les expofer plufieurs jours de fuite à la
plus forte ardeur du foleii, afin de faire mourir la
feve qui eft au dedans , qui ne manqueroit pas , fans
cette précaution, de s’ouvrir elle-même § une voie
pour aller le fervir au-dehors des nouvelles ailes
qu’elle a acquifes au dedans.
L ’on ne dévide ordinairement que les cocons les
plus parfaits ; ceux qui font doubles , oû. trop
foibles ou trop groflîers, font mis au rebut, non
pas pour les rejetter abfolument, mais parce que
n’étant pas propres au dévidage , on les réferve
pour les tirer en flottes & en écheveàux.
Les cocons font de differentes couleurs , dont les
plus communes font, le jaune , Y orangé y Yifa-
b e lle , & la couleur de chair ; il y en a aufli de
céladons & de couleur fo u jfre , & même quelques-
uns de blancs ,• mais il eft inutile d’en leparer les
nuances pour les dévider à part, car elles fe confondent
toutes dans le décreufement des fo ies. ,
L a machine employée pour le tirage de la fo i e ,
(opération qui fe fait ordinairement dans le courant
de juin ou de juillet ) eft connue fous le nom de
tour de Piémont , parce que nous la devons aux
Pieniontois , dont nous fumes long-tems tributaires ,
à caufe de l’art ingénieux avec lequel ils font le
tirage de leurs fo ies. Avant de tirer les fo i e s , il
faut: commencer par faire difioudre la gomme on
matière vifqueufe qui colle les fils les uns aux autres,
car , comme on l a déjà dît , la fo ie n’eft autre
choie qu une gomme ou vernis d’une nature très-
particuliere & duéfile a 1 infini ; mais pour opérer
ce détachement ; l ’eaa froide n’a point une âébion
fuffifonte, & celle de l’eau bouillante eft nuifible ,
il faut alors prendre un milieu, & cet état doit
être déterminé par l’âge des cocons, par leur dureté
leur fineiïe , la qualité & la deftination de la fo ie ;
les vieux cocons creux, qui font fecs & ferrés *
demandent l’eau prefque bouillante; fi les'brins
caftent fréquemment, l ’eau n’eft pas affez chaude •
elle l’eft trop au contraire , s’il fe forme beaucoup
de bourre. *
^ On tire , en général, de trois fortes de fo ie
c’eft-à.dire, qu’on a dans le choix de fes cocons ’
trois diftinftions en vne, Vorganfin, la trame, 8c
le p o i l ; qn choifit la plus belle fo ie pour Vorgan-
f in ;. h. fo ie de moindre qualité fe tire pour trame
Sc pour le p o il.
« Qil’uJ? fe reprëfenre aétuellement une fille affilé
devant une banque de cuivre de forme elliptique
de quinze à vingt poüfes de diamètre , fur cinq ou
fix de profondeur , rempli^ d’eau , foutenue &
cimentée à hauteur d’appui , uir un fourneau
allumé ; lorfque l’eau eft prefque bouillante, la
tireufe y jette une poignée ou deux dé cocons
bien débourrés ; elle les agite fortement avec les
pointes coupées en broffes d’un balai de bouleau -
l’eau, la chaleur & cette agitation démêlent le
bout des brins _ de fo ie des cocons; l’ouvrière les
recueille , les divife- en deux portions égales qu’elle
paftè entre les guides, puis, qu’elle croife lune