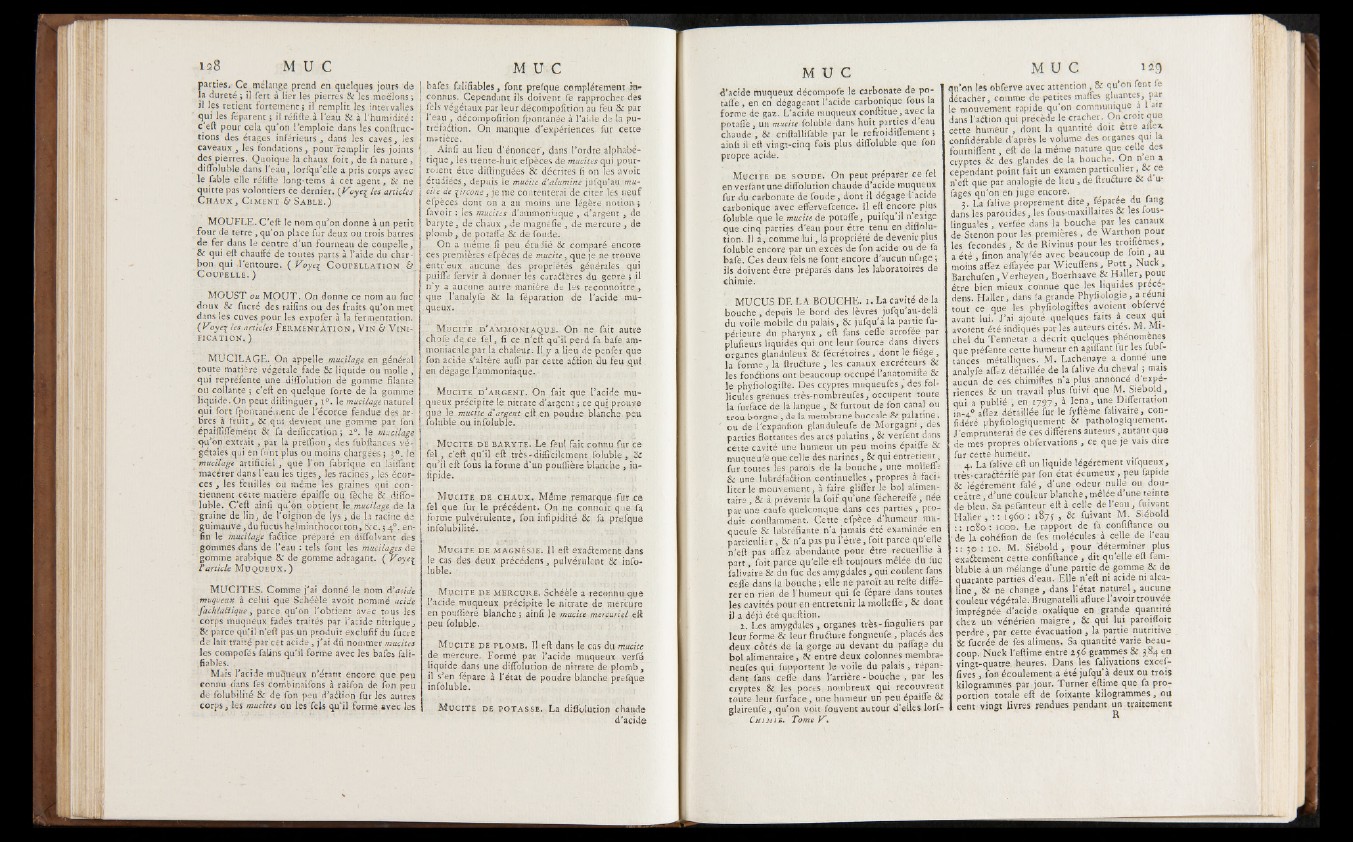
parties. Ce mélange prend en quelques jours de
la dureté ; il fert à lier les pierres & les moëlons ;
il les retient fortement > il remplit les intervalles
qui les féparent 5 il réfifte.à l ’eau & à l ’humidité:
c’eft pour cela qu’on l ’emploie dans les conftruc-
tions des étages inférieurs, dans les caves, les
caveaux, les fondations, pour remplir les joints
des pierres. Quoique la chaux fo it, de fa nature ,
diflfoluble dans l’eau, lorfqu’elle a pris corps avec
le fable elle réfifte long-tems à cet agent, & ne
quitte pas volontiers ce dernier. (Voye£ les articles
C h a u x , C im e n t & S a b l e . )
MOUFLE. C ’eft le nom qu’on donne à un petit
four de terre, qu’on place fur deux ou trois barres
de fer dans le centre d’un fourneau de coupelle,
& qui eft chauffé de toutes parts à l’aide du charbon
qui l ’entoure. ( Voye£ C o u p e l l a t i o n &
C o u p e l l e . )
MOUST ou MOUT. On donne ce nom au fuc
doux & fucré des raifîns ou des fruits qu’on met
dans les cuves pour les expofer à la fermentation.
(Voyeç les articles FERMENTATION , VlN & VINIFICATION.
)
MUCILAGE* On appelle mucilage en général;
toute matière végétale fade & liquide ou molle ,*
qui repréfente une diffolution de gomme filante:
ou collante ; c’eft en quelque forte de la gomme
liquide. On peut diftinguer, i°. le mucilage naturel
qui fort fpontanément de l ’écorce fendue des arbres
à fruit, & qui devient une gomme par fon:
épaifllflëment & fa deificcation ; i°. le mucilage
qu’on extrait, par la preffion, des fubftances végétales
qui en font plus ou moins chargées; 30. le'
mucilage artificiel, que l’on fabrique en laiffant
macérer dans l’eau les tiges, les racines, les écorces
, les feuilles ou même les graines qui contiennent
cette raatière: épaiffe ou fèche & diffo-
luble. C ’eft ainfi qu’on obtient \e.mucilage de la
graine de lin , de l’oignon de lys ; de la racine de
guimauve, du fucus helminthocorton, &rc. ; 40. enfin
le mucilage faétice préparé en diffolvant des
gommes dans de l’eau : tels font les mucilages de
gomme arabique 8c de gomme adragant. ( Voye%
T article M U Q U EU X . )
MUCITES. Comme j’ai donné le nom diacide
muqueux à celui que Schéèle avoir nomme acide
fachlaftique, parce qu’on l’obtient avec tous les
corps muqueux fades traités par l’acide nitrique,
& parce qufiï n’eft pas un produit exclufif du fucre
de lait traité par cet acide, j’ai dû nommer mucites
les compofés falins qu’il forme avec les bafes fali-
.fiables. ,
Mais l’acide muqueux n’étant encore que peu
connu dans fes combinaifons à raifon de fon peu
de folubiliré & de fon peu d’aétion fur les autres
corps, les mucites ou les Tels qu’il forme avec les
| bafes falifiables, font prefque complètement i«v
] connus. Cependant ils doivent fe rapprocher des
. fels végétaux par leur décotopoirtion au feu & par
l’eau , décompofition fpontanée à l’aide de la putréfaction.
On manque d’expériences fur cette
matière.
. Ainfi au lieu d’énoncer, dans l’ordre alphabétique,
les trente-huit efpèces de mucites qui pourvoient
être diftinguées & décrites fi on les a voit
étudiées, depuis le mucite d'alumine jufqu’aü mu-
cite de ^ircone , je me contenterai de citer les neuf
efpèces dont on a au moins utle légère notion ;
favoir : les mucites d’ammoniaque, d’argent, de
baryte, de chaux, de magnéfîe, 'de mercure, de
plomb, de potaffe & de fonde.
- On a même fi peu étudié & comparé encore
ces premières efpèces de mucite, que je ne trouve
. entr’eux aucune des propriétés générales qui
puiffe fervir à donner les caraêtè'res du genre ; il
n’y a aucune autre manière de les reconnoître,
que l’analyfe & la réparation de l ’acide muqueux.
M u c i t e d ’ a m m o n i a q u e . On ne fait autre
chofe de ce fe,l, fi ce n’eft qu’il perd fa bafe ammoniacale
par la chaleur. Il y a lieu de penfer que
fon acide s’altère aufîi par cette aCtion du feu .qui.
en dégage l’ammoniaque.
M u c i t e d ’ a r g e n t . Ô n f a i t q u e l ’ a c id e m u q
u e u x p r é c ip i t e le n i t ra t e d’ a r g e n t ; c e q u i p r o u v e
q u e le mucite d'argent e.ft e n p o u d r e b la n ch e p e u
fo lu b le o u in fo lu b le .
M u c i t e d e b a r y t e . Le feul fait connu fur c e
fel , c’eft qu’il eft très-difficilement foluble, 8c
qu’il eft fous la forme d’un pouffière blanche, in-
fipide.
M u c i t e d e c h a u x . Même remarque fur c e
fel que fur le précédent. On np connoît que fa
forme pulvérulente, fon infipidité &; fa prefque
infol ubilité.
M u c i t e d e m a g n é s j e . Il e ft exactement dans
le cas des deux précédens, pulvérulent & infoluble.
M u c i t e d e m e r c u r e . Schéèle a reconnu que
Taeide muqueux précipite le nitrate de mercure
en pouffière blanche ; ainfi le mucite mercuriel eft
peu foluble.
M u c i t e d e p l o m b . Il eft dans le cas du mucite
de mercure. Formé par l’acide muqueux verfé
liquide dans une diflolution de nitrate de plomb,
il s’en fépare à l’état de poudre blanche prefque
infoluble.
M u c i t e d e p o t a s s e . La diflolution chaude
d’acide
d’acide muqueux décompofe le carbonate de potaffe
, en en dégageant l’acide carbonique fous la
forme de gaz. L’acide muqueux conftitue, avec la
potaffe, un mucite foluble dans huit parties d eau
chaude, & criftallifable par le refroidiffement ;
ainfi il eft vingt-cinq fois plus diflfoluble que fon
propre acide. .
M u c i t e d e s o u d e . On peut préparer ce fel
en verfant une diflolution chaude d’acide muqueux
fur du carbonate de foude, dont il dégage Taeide
carbonique avec effervefcence. 11 eft encore plus
foluble que le mucite de potaffe, puifqu’il n’exige
que cinq parties d’eau pour être tenu en diflolution.
Il a, comme lui, la propriété de devenir plus
foluble encore par un excès de fon acide ou de fa
bafe. Ces deux fels ne font encore d’aucun ufage ;
ils doivent être préparés dans les laboratoires de
chimie.
MUCUS DE LA BOUCHE. 1. La cavité de la
bouche, depuis le bord des lèvres jufqu au-dela
du voile mobile du palais, 8c jufqu’a la partie fu-
périeure du pharynx , eft fans ceffe arrofée par «
plufieurs liquides qui ont leur fource dans divers
organes glanduleux 8c fécrétoires, dont le fiége,
la formeË la ftruCture , les canaux excréteurs &
les fonctions ont beaucoup occupé l’anatomifte 8c
le phyfiologifte. Des cryptes muqueufes, des follicules
grenues très-nombreufes, occupent toute
la furface de la langue, 8c furtout de fon canal ou
trou borgne, de la membrane buccale 8c palatine, 1 ou de i’expanfion glanduleufe de Morgagni, des
parties flottantes des arcs palatins , & verfent dans
cette cavité une humeur un peu moins épaiffe &
muqueufe que celle des narines, & qui entretient,
ftir toutes les parois de la bouche, une molieffe
& une lubréfaCtion continuelles, propres à facT
liter ie mouvement , à faire güflTer le bol alimentaire,
8c à prévenir la foif qu’une féchereffe, née
par une caufe quelconque dans ces parties , produit
conftamment. Cette efpèce d’humeur muqueufe
& lubréfiante. n’a jamais été examinée en
particulier, 8c n’a pas pu l’être, foit parce qu’elle
n’eft pas allez abondante pour être recueillie à
part, foit,parce qu’elle eft toujours mêlée du fuc
falivaire & du fuc des amygdales, qui coulent fans
ceffe dans la bouche; elle ne paroît au refte différer
en rien de l’humeur qui fe fépare dans toutes
les cavités pour en entretenir la molieffe, 8c dont
jj a déjà été queftion.
2. Les amygdales, organes très-finguliers par
leur forme & leur ftruCture fongueufe, placés des
deux côtés de la gorge au devant du paffage du
bol alimentaire, 8c entre deux colonnes membrane
u (es qui fupportent le voile du palais, répandent
fans ceffe dans l’arrière - bouche , par les
cryptes & les pores nombreux qui recouvrent
toute leur furface, une humeur un peu épaiffe &
glaireufe, qu’on voit louvent autour d’elles lorf-
Cttutïs. Tome VI
qu’on les obferve avec attention, 8c qu’on fent le
détacher, comme de petites maffes gluantes, par
le mouvement rapide qu’on communique à 1 air
dans l’aCtion qui précède le cracher. On croit que
cette humeur , dont la quantité doit être a fiez
confidérable d’après le volume des organes qui la
fourniffent, eft de la même nature que celle des
cryptes & des glandes de la bouche. On n en a
cependant point fait un examen particulier ce
n’eft que par analogie de lieu, de ftruCture ccdu-
fages qu’on en juge encore. _ , c
3. La falive proprement dite, feparée du lang
dans les parotides, les fous-maxillaires & les fous-
linguales , verfée dans la bouche par les canaux
de Stenon pour les premières. de Warthon pour
les fécondés, & de Rivinus pour les troifiemes,
a été , linon analyfée avec beaucoup de foin , au
moins affez effay’ée par Wieuffens, Pott, Nuck,
Barchufen,Verheyen, Boerhaave & Haller, pour
être bien mieux connue que les liquides préce-
dens. Haller, dans la grande Phyfiologie, areum
tout ce que les phyfiologiftes avoient obfervé
avant lui. J’ai ajouté quelques faits à ceux qui
avoient été indiqués par les auteurs cités. M. Michel
du Tennetar a décrit quelques phénomènes
que préfente cette humeur en agilfant fur les fubftances
métalliques. M. Lachenaye a donne une
analyfe allez détaillée de la falive du cheval ; mais
aucun de ces chimiftes n'a plus annèncé d'expériences
8t un travail plus fuivi que M. Siébold,
qui a publié , en 1737 , à Iena, une Differtation
in-40 allez détaillée fur le fyftème falivaire, con-
fidéré phyfiologiquement & pathologiquement.
J'emprunterai de ces différens auteurs, autant que
de mes propres obfervations, ce que je vais dire
fur cette humeur.
4. La falive eft un liquide légèrement vifqueux,
t-rès-caraétérifé par fon état écumeux, peu Capide
& légèrement falé, d'une odeur nulle ou douceâtre
, d'une couleur blanche, mêlée d'une teinte
de bleu. Sa pefanteur eft à celle de l'eau, fuivant
Haller, :: i960; iByf , & fuivant M. Siébold
: : 1080;: 1000. Le rapport de fa conf.tlsnoe ou
de la cohéfion de fes molécules à celle de l'eau
30 ; 10. M. Siébold, pour 'déterminer plus
exactement cette conliftance, dit qu elle eft fem-
blable.à un mélange d'une partie de gomme & de
quarante parties d'eau. Elle n eft ni acide ni alcaline,
& ne change, dans l'état naturel, aucune
couleur végétale. Brugnatelli affûte 1 avoir trouvée
imprégnée d'acide oxalique en grande quantité
chez un. vénérien maigre, & qui lui paroiffoit
perdre, par cette évacuation , la partie nutritive
& fucrée de fes alimens. Sa quantité varie beaucoup.
Nuck l'eftime entre 256 grammes & 384 en
vingt-quatre heures. Dans les faüvations excef-
fives, fon écoulement a été jufqu'à deux ou trois
kilogrammes par jour. Turner eftime que fa proportion
totale eft de foixante kilogrammes, ou
cent vingt livres rendues pendant un traitement