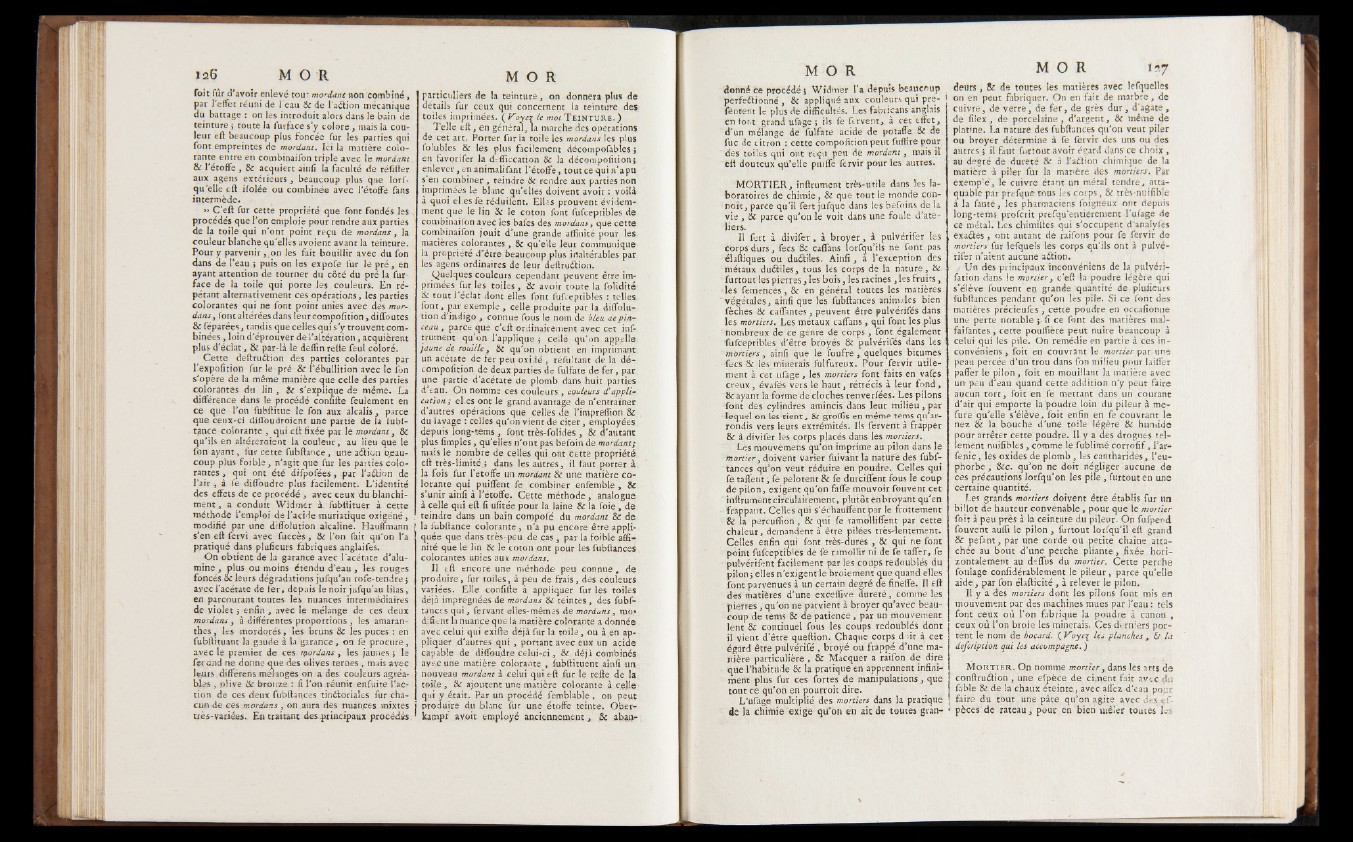
foit fûr d'avoir enlevé tour mordant non combiné,
par l'effet réuni de 1 eau & de l'avion mécanique
du battage : on les introduit alors dans le bain de
teinture > toute la furface s'y colore, mais la couleur
eft beaucoup plus foncée fur les parties qui
font empreintes de mordant. Ici la matière colorante
entre en combinaifon triple avec le mordant
& l'étoffe , & acquiert ainfi la faculté de réfifter
aux agens extérieurs , beaucoup plus que lorf-
qu'elle eft ifolée ou combinée avec l'étoffe fans
intermède. -
m C ’eft fur cette propriété que font fondés les
procédés que l'on emploie pour rendre aux parties
de la toile qui n'ont point reçu de mordans 3 la
couleur blanche qu'elles avoient avant la teinture.
Pour y parvenir,on les fait bouillir avec du fon
dans de l'eau } puis on les expofe fur le pré, en
ayant attention de tourner du côté du pré la fur
face de la toile qui porte les couleurs. En répétant
alternativement ces opérations, les parties
colorantes qui ne font point unies avec des mor-
dàns, font altérées dans leur compofition,diffoutes
& féparées, tandis que celles qui s'y trouvent combinées
, loin d'éprouver de l'altération, acquièrent
plus d'éclat, & par-là le deffin relte feul coloré.
Cette deftruétion des parties colorantes par
l ’expofition fur le pré & l'ébullition avec le fbn
s'opère de la même manière que celle des parties
colorantes du lin, & s'explique de même. La
différence dans le procédé conüfte feulement en
ce que l'on fubftitue le fon aux alcalis, parce
que ceux-ci diffoudroient une partie de la fubftance
colorante , qui eft fixée par le mordant, &
qu'ils en alcéreroient la couleur, au lieu que le
fon ayant, fur cette fubftance, une aélion beaucoup
plus foible, n'agit que fur les parties colorantes
, qui ont été difpofées, par l'aétion de
l’air , à fe diffoudre plus facilement. L'identité
des effets de ce procédé , avec ceux du blanchiment
, a conduit Widmer à. fubttituer à cette
méthode l’emploi de l'acide muriatique oxigéné,
modifié par une diffolution alcaline. Hauffmann
s'en eft fervi avec fuccès, & l'on fait qu'on l'a
pratiqué dans plufieurs fabriques anglaifes.
On obtient de la garance avec l ’acétate d'alumine
, plus ou moins étendu d'eau, les rouges
foncés & leurs dégradations jufqu'au rofe-tendre j
avec l’acétate de fer, depuis le noir jufqu’au lilas,
en parcourant toutes les nuances intermédiaires
de violet j enfin , avec le mélange de ces deux
mordans , à différentes proportions, les amaran-
thes, les mordorés, les bruns & les puces : en
fubftituant la gaude à la garance, on fe procure,
avec le premier de ces rpordans, les jaunes j le
fécond ne donne que des olives ternes , mais avec
leurs différens mélanges on a des couleurs agréables
, olive & bronze : fi l’on réunit enfuite l'action
de ces deux fubftances tinctoriales fur chacun
de ces mordans , on aura des nuan.ces mixtes
très-variées. En traitant des principaux procédés
p a r t ic u lie r s de la t e in t u r e , o n donnera plus de
d é ta ils fu r c e u x q u i c o n c e rn e n t la t e in tu r e de$
to i le s im p r im é e s . ( Voyez le mot T e i n t u r e . )
Telle eft, en général, la marche des opérations
de cet art. Porter fur la toile les mordans les plus
folubles & les plus facilement décompofables ;
en favorifer la drflkcation & la décompofitionj
enlever,en animalifant l’étoffe, tout ce quin'apu
s'en combiner, teindre & rendre aux parties non
imprimées le blanc qu'elles doivent avoir : voilà
à quoi efes fe réduifent. Elles prouvent évidemment
que le lin & le coton font fufceptibles de
combinaifon avec les bafes des mordans, que cette
combinaifon jouit d'une grande affinité pour les
matières colorantes, & qu'elle leur communique
la propriété d'être beaucoup plus inaltérables par
les agens ordinaires de leur deftruétion.
Quelques couleurs cependant peuvent être imprimées
fur les toiles , & avoir toute la folidité
& tout l ’éclat donc elles font fufceptibles telles
font, par exemple, celle produite par la diffolution
d'indigo , connue fous le nom de bleu, de pinceau
, parce que c'tft ordinairement avec cet instrument
qu'on l’applique j celle qu'on appelle
jaune de rouille, & qu’on obtient en imprimant
un acétate de fer peu oxidé, réfuîtant de la dé-
compofition de deux parties de fulfate de fer, par
une partie d'acétate de plomb dans huit parties
d eau. On nomme ces couleurs,, couleurs d‘application
; elles ont le grand avantage de n'entraîner
d’autres opérations que celles de i'impreffion &
du lavage : celles qu'on vient de citer, employées
depuis long-tems , font très-folides , & d'autant
plus fimples, qu’elles n'ont pas befoin de mordant;
mais le nombre de celles qui ont cette propriété
eft très-limit.é.î dans les autres, il faut porter à
la fois fur l’étoffe un mordant & une matière colorante
qui puiffeot fe combiner enfemble, &
s’unir ainfi à l'étoffe. Cette méthode, analogue
à celle qui eft fi ufitée pour la laine & la foie, de
teindre dans un bain compofé du mordant & de
la fubftance colorante , n'a pu encore être appliquée
que dans très-peu de cas, par la foible affinité
que le lin & le coton ont pour les fubftances
colorantes unies aux mordans.
Il eft encore une méthode peu connue, de
produire, fur toiles, à peu de frais, des couleurs
variées. Elle confifte à appliquer fur les toiles
déjà imprégnées de mordans & teintes, des fubf-
tanccs qui, £ervant elles-mêmes de mordans, mo*
défient la nuance que la matière colorante a donnée
avec celui qui exifte déjà fur la toile, ou à.en appliquer
d'autres q u i, portant avec eux un acide
capable de diffoudre celui-ci, & déjà combinés
avec une matière colorante , fubftituent ainfi un
nouveau mordant à celui qui eft fur le refte de la
toile, & ajoutent une matière colorante à celle
qui y était. Par un procédé femblable, on pevit
produire du blanc fur une étoffe teinte. Ober-
kampf ayoit employé anciennement, & abai)-
donné ce procédés Widmer l’a depuis beaucoup
perfe&ionné, & appliqué aux couleurs qui pré-
fentent le plus de difficultés. Les fabricans anglais
en font grand ufage s ils fe ftrvent, à cet effet,
d’un mélange de fulfate acide de potaffe & de
fuc de titron : cette compofition peut fuffire pour
des toiles qui ont reçu peu de mordant, mais il
eft douteux qu’ elle puiffe fervir pour les autres.
MORTIER, infiniment très-utile dans les laboratoires
de chimie, & que tout le monde con-
noît, parce qu'il fert jufque dans les befoins de la
vie , éc parce qu'on le voit dans une foule d'ateliers.
Il fert à divifer, à broyer, à pulvérifer les
corps durs, fecs & caftans lorfqu’ils ne font pas
élaftiques ou ductiles. Ainfi, à l’exception des
métaux duétiles, tous les corps de la nature, &
furtout les pierres,les bois , les racines, les fruits,
les femences, & en général toutes les matières-
végétales, ainfi que les fubftances animales bien
fèches & caftantes, peuvent être pulvérifés dans
les mortiers. Les métaux caftans, qui font les plus
nombreux de ce genre de corps, font également
fufceptibles d'être broyés & pulvérifés dans les
mortiers, ainfi que le foufre , quelques bitumes
fecs & les minerais fülfureux. Pour fervir utilement
à cet ufage, les mortiers font faits en vafes
creux, évafés vers le haut, rétrécis à leur fond,
& ayant la forme de cloches ren verfées. Les pilons
font des cylindres amincis dans leur milieu, par
•lequel on les tient, & groffis en même tems qu'arrondis
vers leurs extrémités. Us fervent à frapper
& à divifer les corps placés dans les mortiers.
Les mouvemens qu’on imprime au pilon dans le
mortier, doivent varier fuivant la natufé des fübf-
tances qu'on veut réduire en poudre. Celles qui
fe taflent; fe pelotent & fe durciflent fous le coup
de pilon, exigent qu’on fafle mouvoir fouvent cet
inft ruinent circulairement, plutôt en broyant qu'en
frappant. Celles qui s’échauffent par le frottement
& la pereuffion , & qui fe ramolliffent par cette
chaleur, demandent à être pilées très-lentement.
Celles enfin qui font très-dures , & qui ne font
point fufceptibles de fe ramollir ni de fe tafler, fe
pulvérifenr facilement par les coups redoublés du
pilon 5 elles n'exigentie broiement que quand elles
font parvenues à un certain degré de finefie. U eft
des matières d’une exceffive dureté, comme les
pierres, qu’on ne parvient à broyer qu'avec beaucoup
de tems & de patience, par un mouvement
lent & continuel fous les coups redoublés dont
il vient d’être queftion. Chaque corps d oit à cet
égard être pulvérifé , broyé ou frappé d’une manière
particulière, & Macquer a raifon de dire
que l'habitude & la pratique en apprennent infiniment
plus fur ces fortes de manipulations, que
tout ce qu'on en pourroit dire.
L'ufage multiplié des mortiers dans la pratique
de la chimie exige qu'on en ait de toutes grandeùrs,
& de toutes les matières avec lefquelles
l on en peut fabriquer. On en fait de marbre, de
cuivre, de verre, de fer, de grès dur, d'agate,
de fiiex, de porcelaine, d’argent, & même de
platine. La nature des fubftances qu’on veut piler
ou broyer détermine à fe fervir des uns ou des
autres > il faut furtout avoir égard dans ce choix ,
au degré de dureté & à l'aétion chimique de la
matière *à piler fur la matière des mortiers. Par
exempt, le cuivre étant un métal tendre, attaquable
par prefque tous les corps, & très-nuifible
à la fanté, les pharmaciens foigneux ont depuis
long-tems proferit prefqu'entiérement l ’ufage de
ce métal. Les chimiites qui s'occupent d'analyfes
exactes, ont autant de raifons pour fe fervir de
mortiers fur lefquels les corps qu’ils ont à pulvérifer
n'aient aucune aétion.
/ Un des principaux inconvéniens de la puîvéri-
fation dans le mortier, c’eft la poudre légère qui
s’élève fouvent eii grande quantité de. plufieurs
fubftances pendant qu'on les pile. Si ce font des
matières précieufes, cette poudre en occafionne
une perte notable j-fi ce font des matières malfai
fantes, cette pouffière peut nuire beaucoup à
celui qui les pile. On remédie en partie à ces inconvéniens
, foit en couvrant le mortier par une
peau percée d’un trou dans fon milieu pour laifler
paffer le pilon, foit en mouillant la matière avec
un peu d eau quand cette addition n'y peut faire
aucun tort, foit en fe mettant dans un courant
d’air qui emporte la poudre loin du pileur à me-
fure qu'elle s’élève, foit enfin en fe couvrant le
nez & la bouche d’une toile légère & humide
pour arrêter cette poudre. Il y a des drogues tellement
nuifibles, comme le fublimé corrofif, l'ar-
fenic, les oxides de plomb, les cantharides, l’euphorbe
, &c. qu'on ne doit négliger aucune de
ces précautions lorfqu'on les pile, furtout en une
certaine quantité.
Les grands mortiers doivent être établis fur un
billot de hauteur convenable, pour que le mortier
foit à peu près à la ceinture du pileur. On fufpend
fouvent auffi le pilon , furtout lorfqu'il eft grand
& pefant, par une corde ou petite chaîne attachée
au bout d’une perche pliante, fixée horizontalement
au deflus du mortier. Cette perche
foulage confidérablement le pileur, parce qu’elle
aide, par fon élafticité, à relever le pilon.
Il y a des mortiers dont les pilons font mis en
mouvement par des machines mues par l'eau : tels
font ceux où l'on fabrique la poudre à canon ,
ceux où l’on broie les minerais. Ces derniers portent
le nom de bocard. ( Voye[ les planches , & la
description qui les accompagne, j
Mor tier. On nomme mortier, dans les arts de
conftruélion , une efpèce de ciment fait avec du
fable & de la chaux éteinte,, avec affez d'eau pour
faire du tout une pâte qu'on agite avec des ef-
* pèces de rateau, pour en bien mêler toutes les