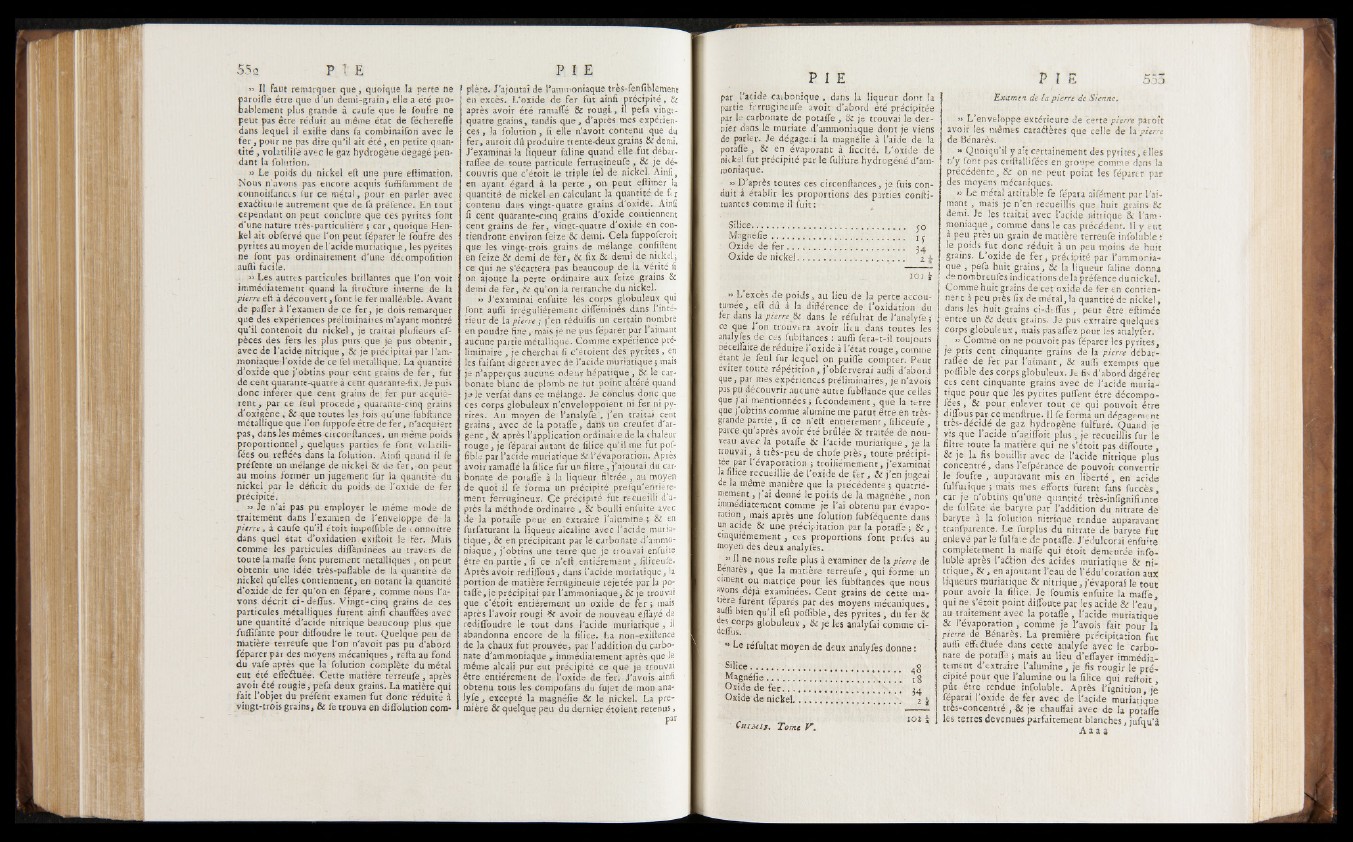
5 5 <2 P 1 ' E
» Il faut remarquer que , quoique la perte ne
aroifle être que d'un demi-grain, elle a été proablement
plus grande à caufe que le foufre ne
peut pas être réduit au même état de fécherefle
dans lequel il exifte dans fa combinaifon avec le
fer , pour ne pas dire qu'il ait é té , en petite quantité
, volatiîifé avec le gaz hydrogène dégagé pendant
la folution.
*» Le poids du nickel eft une pure eftimation.
Nous n'avons pas encore acquis fuffifamment de
connoiiïanccs (ur ce métal, pour en parler avec
exactitude autrement que de fa préfence. En tout
cependant on peut conclure que ces pyrites font
d'une nature très-particulière } car, quoique Hen-
kel ait obfervé que l'on peut féparer le foufre des
pyrites au moyen de l’acide muriatique, les pyrites
ne font pas ordinairement d’une détompoficion
aufli facile.
.. *> Les autres particules brillantes que Ton voit
immédiatement quand la ftiuèture interne de la
pierre eft à découvert, font le fer malléable. Avant
de pafler à l'examen de ce fer, je dois remarquer
que des expériences préliminaires m’ayant montré
qu'il contenoit du nickel, je traitai plufieurs ef-
pèces des fers les plus purs que je pus obtenir,
avec de l’acide nitrique, & je précipitai par l ’ammoniaque
l’oxide de ce fel métallique. La quantité
d'oxide que j’obtins poup cent grains de fer, fut
de cent quarante-quatre à cent quarante-ftx. Je puis
donc inférer que cent grains de fer pur acquièrent,
par ce leul procédé, quarante-cinq grains
d'oxigène, & que toutes les fois qu'une fubftance
métallique que l'on fuppofe être de fer, n'acquiert
pas, dans les mêmes circonftances, un même poids
proportionnel, quelques parties fe font volatili-
fées ou reftées dans la folution. Ainlï quand il fe
préfente un mélange de nickel & de fer, on peut
au moins former un jugement fur la quantité du
nickel par le déficit du poids de l’oxide de fer
précipité.
» Je n'ai pas pu employer le même mode de
traitement dans l’examen de l'enveloppe de la
pierre, à caufe qu’il e-toit impoflible de connoïtre
dans quel état d'oxidation exiftoit le fer. Mais
comme les particules difféminëes au travers de
toute la mafle font purement métalliques, on peut
obtenir une idée très-paflable de la quantité de
nickel qu'elles contiennent, en notant la quantité
d’oxide de fer qu’on en fépare, comme nous l'avons
décrit ci-delfus. Vingt-cinq grains de ces
particules métalliques furent ainfi chauffées avec
une quantité d’acide nitrique beaucoup plus que
fuffifance pour diffoudre le tout. Quelque peu de
matière terreufe que l'on n'avoit pas pu a’abord
féparer par des moyens mécaniques, refta au fond
du vafe après que la folution complète du métal
eut été effectuée. Cette matière terreufe, après
avoir été rougie, pefa deux grains. La matière qui
fait l’objet du préfent examen fut donc réduite à
viugt-trois grains, & fe trouva en difiolution com-
P I E
pièce. J'ajoutai de l’ammoniaque très-fenfiblement
en excès. L'oxide de fer fut ainfi précipité, &
après avoir été ramafle & rougi, il pefa vingt-
quatre grains, tandis que, d’après mes expériences
, la folution, fi elle n’avoit contenu que du
fer, auroit dû produire trente-deux grains & demi.
J'examinai la liqueur faline quand elle fut débar-
| raflée de toute particule ferrugineufe, & je dé-
1 couvris que c'étoit le triple fel de nickel. Ainfi,
en ayant égard à la perte , on peut eftimer la
quantité de nickel en calculant la quantité de fi r
contenu dans vingt-quatre grains d’oxide. Ainfi
fi cent quarante-cinq grains d'oxide contiennent
cent grains de fer, vingt-quatre d'oxide en contiendront
environ feize & demi. Cela fuppoferoit
que les vingt-trois grains de mélange confident
en feize & demi de fer, & fix & demi de nickel}
ce qui ne s’écartera pas beaucoup de la vérité fi
on ajoute la perte ordinaire aux feize grains &
demi de fer, & qu'on la retranche du nickel.
» J’examinai enfuite les corps globuleux qui
font aufli irrégulièrement difleminés dans l’intérieur
de la pierre ; j'en réduïfis un certain nombre
en poudre fine, mais je ne pus féparer par l'aimant
aucune partie métallique. Comme expérience préliminaire
, je cherchai fi c’étoient des pyrites, en
les faifant digérer avec de l'acide muriatique j mais
je n'apperçus aucune odeur hépatique , & le carbonate
blanc de plomb ne fut point altéré quand
je le verfai dans ce mélange. Je conclus donc que
ces corps globuleux n’enveloppoient ni fer ni py-
rires. Au moyen de l'analyfe , j’en traitai cent
grains , avec de la potafle, dans un creufet d'argent,
& après l'application ordinaire dé jà chaleur
rouge, je féparai autant de filice qu’il me fut pof-
fibîe par l’acide muriatique & l'évaporation. Après
avoir ramaflé la filice fur un filtre, j'ajoutai du carbonate
de potafle à la liqueur filtrée, au moyen
de quoi il fe forma un précipité prefqu'eritiére-
ment ferrugineux. Ce précipité fut recueilli d’après
la méthode ordinaire , & boulli enfuite avec
de la potafle pour en extraire l'alumine ; & en
furfaturant la liqueur alcaline avec l'acide muriatique,
& en précipitant parle carbonate d’ammoniaque
, j'obtins une terre que je trouvai enfuite
être en partie, fi ce n'elt entièrement, filiceufe.
Après avoir rediflous, dans l’acide muriatique, la
portion de matière ferrugineufe rejetée par la potafle,
je précipitai par l’ammoniaque, & je trouvai
que c'étoit entièrement un oxide de fer j mais
après l’avoir rougi avoir de nouveau eflàyé de
redifloudre le tout dans l'acide muriatique, il
abandonna encore de la filice. La non-exiftence
de la chaux fut prouvée, par l’addition du carbonate
d'ammoniaque r immédiatementaprès que le
même alcali pur eut précipité ce que je trouvai
être entièrement de l'oxide de feri J’avois ainfi
obtenu tous les compofans du fujet de mon analyse,
excepté la magnéfie & le nickel. La première
& quelque peu du dernier étoient retenus,
‘ par
P I E
'Examen de par l'acide canonique , dans la liqueur dont la la pierre de Sienne.
partie ferrugineufe avoir d'abord été précipitée
par le carbonate de potafle, & je trouvai le dernier
dans le muriate d'ammoniaque dont je viens
de parler. Je dégageai la magnéfie à l’aide de la
potafle, & en évaporant à ficcité. L'oxide de
nickel fut précipité par le fulfure hydrogéné d'ammoniaque.
» D’après toutes ces circonftances, je fuis conduit
à érablir les proportions des parties confti-
tuantes comme il fuit :
Silice............................................................ y o
Magnéfie................................... . . . .......... j <-
Oxide de fe r .......................| .................... ^
Oxide de nickel......................................... z i
IOI J
» L’excès de poids, au lieu de la perte accoutumée,
eft dû à la différence de l’oxidation du
fer dans la pierreJk dans le réfultat de l'analyfe j
ce que i'on trouvera avoir lieu dans toutes les
analyfes de ces fubftances : aufli fera-t-il toujours
néceflaire de réduire i’oxide à l'état rouge, comme
étant le feul fur lequel on puifle compter. Pour
éviter toute répétition, j’obferverai aufli d'abord
que, par mes expériences préliminaires, je n'avois
pas pu découvrir aucune autre fubftance que celles
que j’ai mentionnées j fecondement, que la terre
que j obtins comme alumine me parut être eh très-
grande partie, fi ce n'eft entièrement, filiceufe ,
parce qu’après avoir été brûlée & traitée de nouveau
avec la potafle & l’acide muriatique, je la
trouvai, à très-peu de choie près, toute précipitée
par l'évaporation } troiiiémement, j’examinai
la filice recueillie de l’oxide de fer, & j’en jugeai
de la même manière que la précédente j quatrièmement
, j’ai donné le poids de la magnéfie, non
immédiatement comme je l'ai obtenu par évaporation,
mais après une folution fubféquente dans
un acide & une précipitation par la potafle} & ,
cinquièmement, ces proportions font pnfes au
moyen des deux analyfes.
»11 ne nous refte plus à examiner de la pierre de
Benarès, que la matière terreufe, qui forme un
ciment ou matrice pour les fubftances que nous
avons déjà examinées. Cent grains de cette ma-
ue£e furent féparés par des moyens mécaniques,
aufli bien qu'il eft poflible, des pyrites, du fer &
deffC° r*>S 8^0^u^eux * ^ ie *es anaîyfai comme ci-
- Le réfuliat moyen de deux analyfes donne :
Silice.........................
Magnéfie.....................
Oxide de fer.............................
. . . . . . . . 34
Oxide de nickel........... ..
CaiMii. Tome V.
to i i
» L’enveloppe extérieure de cette pierre paroît
avoir les mêmes caractères que celle de la pierre
de Benarès.
f " Quoiqu’il y ait certainement des pyrites, elles
n jt font pas criffalüfées en groupe comme dans la
précédente, & on ne peut point les féparer par
des moyens mécaniques.
» Le métal artirable fe fépara aifément par l ’ai,
mant, mais je n’en recueillis que huit grains Sc
demi. Je les traitai avec l'acide nittique & l’ammoniaque
, comme dans le cas précédent. 11 y eut
à peu près un grain de matière terreufe infoluble !'
le poids fut donc réduit à un peu m.oins de huit
grains. L’oxide de fer, précipité par l'ammoniaque
, pefa huit grains, & la liqueur faline donna
denombreufes indications delà préfence du nickel.
Comme huit grains de cet oxide de fer en contiennent
à peu près fax de métal, la quantité de nickel,
dans les huit grains ci-deflus, peut être eilimée
entre un & deux grains. Je pus exrraire quelques
corps globuleux, mais pas affez pour les analyfer.
” Comme on ne pouvoit pas féparer les pyrites,
je pris cent cinquante grains de la pierre débar-
raifée de fer par 1 aimant, & aufli exempts que
poflible des corps globuleux. Jt fis d’abord digérer
ces cent cinquante grains avec de l’acide muriatique
pour que les pyrites puffent être décompo-
fees, & pour enlever tout ce qui pouvoit être
diflous par ce menitrue. 11 fe forma un dégagement
très-décidé de gaz hydrogène fulfuré. Quand je
vis que l’acide n’agiffoft plus, je recueillis fur le
filtre toute la matière qui ne s’étoit pas diffoute ,
& je la fis bouillir avec de l’acide nitrique plus
concentré, dans l'efpérance de pouvoir convertir
le foufre , auparavant mis en liberté , en acide
fulfuiique; mais mes efforts furent fans fuccès,
car je n’obiins qu’une quantité très-infîgnifùnte
de fulfate de baryte par l'addition du nitrate de
baryte à la folution nitrique rendue auparavant
tranfparente. Le furplus du nitrate de baryte fut
enlevé par le fulfate de potafle. J’édulcorai enfume
complètement la maffe qui étoit demeurée infoluble
après l’aflion des acides muriatique & nitrique,
& , en ajoutant l’eau de l'édulcoration aux
liqueurs muriatique & nitrique, j’évaporai le tout
pour avoir la filice. Je fournis enfuite la maffe,
qui ne s’étoit point diffoute par les acide & l’eau’
au traitement avec la potafle , l'acide muriatique
& l'évaporation , comme je l’avois fait pour la
pierre de Bénarès. La première précipitation fut
aufli efftâuée dans cette anatyfe avec le carbonate
de potafle; mais au lieu d’effayer immédiatement
d’extraire l'alumine, je fis rougir le précipité
pour que l’alumine ou la filice qui reftoit
pût être rendue infoluble. Après l’ignicion, je
féparai l’oxide de fer avec de l’acide muriatique
très-concentré , & je chauffai avec de la potafle
les terres devenues parfaitement blanches, jufqu’à
Aa a a