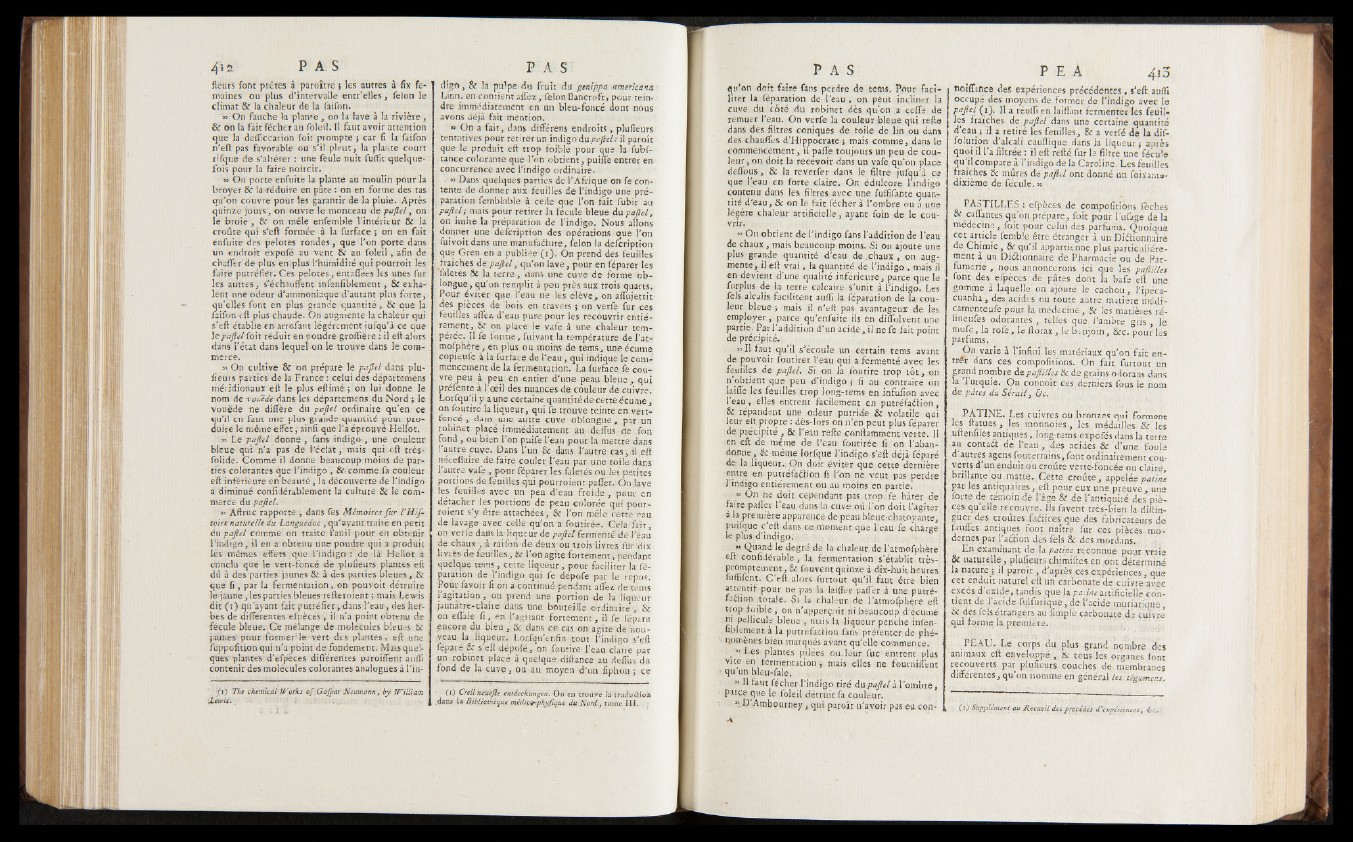
fleurs font prêtes à paroître ; les autres à fix fe-
maines ou plus d'intervalle entr'elles , félon le
climat & la chaleur de la faifon.
» On fauche la plante, on la lave à la rivière ,
& on la fait fécher au foleil. Il faut avoir attention
que la defliccation foit prompte 5 car fi la faifon
n’eft pas favorable ou s'il pleut, la plante court
rifque de s’altérer : une feule nuit fuffit quelquefois
pour la faire noircir,
» On porte enfuite la plante au moulin pour la
broyer & la-réduire en pâte : on en forme des tas
qu’on couvre pour les garantir de la pluie. Après
quinze jours, on ouvre le monceau cle pafiel, on
le broie, & on mêle enfemble l'intérieur & la
croûte qui s’eft formée à la furface ; on en fait
enfuite des pelotes rondes, que l’on porte dans
un endroit expofé au vent 8c au foleil, afin de
chaflfer de plus en plus l'humidité qui pourroit les
faire putréfier. Ces pelotes, entaffees les unes fur
les autres, s'échauffent infenfiblement, & exhalent
une odeur d’ammoniaque d’autant plus forte,
qu’elles font en plus grande quantité, 8e que la
faifon eff plus chaude. On augmente la chaleur qui
s’eft établie en arrofant légèrement jufqu’à ce que
le pafiel foit réduit en poudre groflière : il eft alors
dans l’état dans lequel on le trouve dans le commerce.
H On cultive & on prépare le pafiel dans plufieurs
parties de la France : celui des départemens
méridionaux eft le plus eflimé ; on lui donne le
nom de vouède dans les départemens du Nord j le
vouede ne diffère du pafiel ordinaire qu’en ce
qu’il en faut une plus grande quantité pour produire
le même effet, ainfi que l’a éprouvé Heliot.
» Le pafiel donne , fans indigo , une couleur
bleue qui n’a pas de l'éclat, mais qui eft très-
folide. Comme il donne beaucoup moins de parties
colorantes que l’indigo, &• comme fa couleur
eft inférieure en beauté, la découverte de l’indigo
a diminué conîîdérablement la culture & le commerce
du pafiel.
*> Aftruc rapporte, dans fes Mémoires fur l ’Hif-
toire naturelle du Languedoc, qu’ayant traité en petit
du pafiel comme’ on traite l’anil pour en obtenir
l ’indigo, il en a obtenu tine poudre qui a produit
les mêmes effets que l'indigo : de là Heliot a
conclu que le vert-foncé de :plufieurs plantes eft
dû à des parties: jaunes 8c à des parties bleues, &
que f i , par la fermentation, on pouyoit détruire
le>jaune, les parties bleues refteroient ; mais Lewis
dit (1) qu'ayant fait putréfier, dans l’eau, des herbes
de différentes, efpèces, il n’a point obtenu de
fécule bleue. Ce mélange de molécules bleues &
jaunes'pour former’le vert-des plantes , eft ufce ;
fuppofition qui n’a point de fondement. Mais quelques
plantes d'efpèces différentes paroiffent auffi
contenir des molécules colorantes analogues à l'in-
!(ï) The chemical Works o f Cajpar Neumann , by William
iLewis.
digo, & la pulpe du fruir du gettippa americana
Linn. en contient allez, félon Bancroft, pour teindre
immédiatement en un bleu-foncé aont nous
avons déjà fait mention.
» On a fait, dans différens endroits, plufieurs
tentatives pour retirer un indigo du pafiel: il paroît
que le produit eft trop foible pour que la fubf-
tance colorante que l’on obtient, puiffe entrer en
concurrence avec l’indigo ordinaire.
» Dans quelques parties de l’Afrique on fe contente
de donner aux feuilles de l’indigo une préparation
femblable à ceile que l’on fait fubir au
pafiel; mais pour retirer la fécule bleue du pafiel,
on imite la préparation de l’indigo. Nous allons
donner une description des opérations que l’on
fui voit dans une manufacture, félon la defcription
que Gren en a publiée (1). On prend des feuilles
^fraîches de pafiel, qu’on lave , pour en féparer les
faletés 8c la terre, dans une cuve de forme ob-
Iongue, qu'on remplit à peu près aux trois quarts.
Pour éviter que l’eau ne les élève, on afliijettit
des pièces de bois en travers ; on verfe fur ces
feuilles affez d'eau pure pour les recouvrir entièrement,
& on place le vafe à une chaleur tempérée.
Il fe forme, fuiyant la température de l’at-
mofphère , en plus ou moins de teins, une écume
copieufe à la furface de l’eau , qui indique le commencement
de la fermentation. La furface fe couvre
peu à peu en entier d’une peau bleue ,. qui
préfente à l'oeil des nuances de couleur de cuivre.
Lorfqu’il y a une certaine quantité de cette écume,
on foutire la liqueur, qui fe trouve teinte en vert-
foncé, dans une autre cuve oblongue , par un
robinet placé immédiatement au deffus de fon
fond, ou bien l'on puife l’eau pour la mettre dans
l'autre cuve. Dans l'un & dans l'autre cas, il eft
nécefiàire de faire couler l’eau par une toile dans
1 autre vafe , pour féparer les faletés ou les petites
portions de feuilles qui pourroienc paffer. On lave
les feuilles avec un peu d’eau froide, pour en
détacher les portions de peau colorée qui pourvoient
s’y être attachées, & l’on mêle cette eau
de lavage avec celle qu'on a foutirée. Gela fait,
on verfe dans-la-liqueur de pafiel fermenté de l'eau
de chaux yà raifon de deux ou trois livres ûir dix
livrés de feuilles j 8c l'on agite fortement, pendant
quelque tems, cette liqueur, pour faciliter la réparation
de l'indigo qui fe dépofe par le repos.
Pour favoir fi on a continué pendant affez de tems
1 agitation, on prend une portion de la liqueur
jaunâtre;-claire dans une bouteille ordinaire , &
on effaie f i , en l'agitant fortement, il fe fépare
encore dp bleu, & dans ce cas on agite de 'nouveau
la liqueur. Lorfqu'enfin tout l'indigo s'eft
féparé 8ç s'eft dépofé., on foutire l’eau claire par
un robinet placé à quelque diftance au deffus du
fond de la cuve, ou au moyen d'un fiphon j ce
' • ■ (*) Crellneuefie entdeckungen'. On en trouve là traduction
.dans la Bibliothèque médiço-phyfique du Kord., tome III.
qu’on doit faire fans perdre de tems. Pour faciliter
la réparation de l'eau, on peut incliner la
cuve du côté du robinet dès qu'on a ceffé de
remuer l'eau. On verfe la couleur bleue qui refte
dans des filtres coniques de toile de lin ou dans
des chauffes d'Hippocrate ; mais comme, dans le
commencement, il paffe toujours un peu de couleur
, on doit la recevoir dans un vafe qu'on place
deffous, & la reverfer dans le filtre jufqu’à ce
que l'eau en forte claire. On édulcore l'indigo
contenu dans les filtres avec une fuffifante quantité
d'eau, & on le fait fécher à l’ombre ou à une
légère chaleur artificielle, ayant foin de le couvrir.
g On obtient de l'indigo fans l’addition de l'eau
de chaux, mais beaucoup moins. Si on ajoute une
plus grande quantité d'eau de .chaux, on augmente,
il eft vrai, la quantité de l’indigo, mais il
en devient d’une qualité inférieure, parce que le
furplus de la terre calcaire s'unit à i'indigo. Les
fels alcalis facilitent auffi la féparation de la couleur
bleue j mais il n'eft pas avantageux de ies
employer, parce qu'enfui te ils en diffolvent une
partie. Par l'addition d'un acide, il ne fe fait point
de précipité.
» Il faut qu'il s’écoule un certain tems avant
de pouvoir foutirer l’eau qui a fermenté.avec les
feuilles de pafiel. Si on la foutire trop tô t, on
n obtient que peu d’indigo j fi au contraire on
laiffe les feuilles trop iong-tems en infufion avec
l’eau , elles entrent facilement en putréfa&ion,
& répandent une odeur putride & volatile qui
leur eft propre : dès-lors on n'en peut plus féparer
de précipité , & l’eau refte conftamment verte. Il
en eft de même de l’eau foutirée fi on l'abandonne,
& même lorfque i’indigo s’eft déjà féparé
de la liqueur. On doit éviter que cette dernière
entre en putréfaction fi l'on ne veut pas perdre 1
1 indigo entièrement ou au moins en partie.
* On ne doit cependant pas trop fe hâter de
faire paffer l'eau dans la cuve où l ’on doit l'agiter
à la première apparence de peau bleue-chato.yante,
puifque c’eft dans ce moment que l’eau fe charge 1
le plus d’indigo.
•» Quand le degré de la chaleur de l’atmofphère !
eft confidérable, la, fermentation s'établit très-
promptement, & fouvent quinze à dix-huit heures
fuffifent. C'eft alors furtout qu'il faut être bien
attentif pour ne pas la laiffer paffer à une putréfaction
totale. Si la chaleur de l'atmofphère eft ■
trop foible j on n'apperçnit ni beaucoup d'écume ,
ni pellicule bleue , mais la liqueur penche inlèn- j
ublement à la putréfaction fans préfenter de phénomènes
bien marqués avant qu'elle commence. 1
^ Les plantes pilées ou.leur fuc entrent plus
vite en fermentation, mais elles ne fournirent
qu un bleu-fale.
« Il faut fécher l’indigo tiré du pafiel à l’ombre,
parce que le foleil détruit fa couleur.
” .D Ambourney, qui paroît n'avoir pas eu connoiflhnce
des expériences précédentes, s’eft auffi
occupé des moyens de former de l'indigo avec le
pafiel (1). Il a réuffi en laiffant fermenter les feuiU
les fraîches de pafiel dans une certaine quantité
d’eau j il a retiré les feuilles, & a verfé de la dif-
folution d’alcali cauflique dans la liqueur ] après
quoi il l’a filtrée : il eft refté fur le filtre une fécule
qu'il compare à l'indigo de la Caroline. Les feuilles
fraîches & mûres de pafiel ont donné un foixanca-
dixième de fécule. »
PASTILLES : efpèces de compofîtions fèches
& caftantes qu’on prépare, foit pour I'ufage de la
médecine, foit pour celui des parfums. Quoique
cet article fembte être étranger à un Di&ionnaire
de Chimie, & qu'il appartienne plus particuliérement
a un Dictionnaire de Pharmacie ou de Parfumerie
, nous annoncerons ici que les paftilles
font des efpèces de pâtes dont la bafe eft une
gomme à laquelle on ajoute le cachou, l’ipéca-
cuanha, des acides ou toute autre matière médi-
camenteufe pour la médecine, les matières ré-
fineufes odorantes, telles que l'-ambre gris, le
mufe, la rofe, le ftorax, le benjoin, &c. pour les
parfums.
On varie à l’infini les matériaux qu’on fait entrer
dans ces compofîtions. On fait furtout un
grand nombre depaflilles 8c de grains odorans dans
la Tuvquie. On connoît ces derniers fous le nom
de pâtes du Sérail, Ùc.
PATINE. Les cuivres ou bronzes qui forment
les ftatues, les. monnoies, les médailles & les
uftenfiles antiques, long-tems expofés dans la terre
au contaét de l’eau, des acides & d’une foule
d'autres agens fouterrains, font ordinairement couverts
d'un enduit ou croûte verte-foncée ou claire,
brillante ou matte. Cette croûte, appelée patine
par les antiquaires, eft pour eux une preuve, une
forte de témoin de Iage & de l'antiquité des pièces
quelle recouvre. Ils favent très-bien la diftin-
guer des croûtes faéîices que des fabricateurs de
fauffes antiques font naître fur ces pièces modernes
par 1 aêhon des Tels & des mordans.
En examinant de la patine reconnue pour vraie
& naturelle, plufieurs chimiftes en ont déterminé
la nature.}' il paroît, d'après ces expériences, que
cet enduit naturel eft un carbonate de cuivre avec
excès d oxide, tandis que la panne artificielle contient
de l’acide fuîfurique, de l'acide muriatique,
8c des fels étrangers au (impie carbonate de cuivre
^qui forme la première.
PEAU. Le corps du plus grand nombre des
animaux eft enveloppe , & tous les organes font
recouverts par plufieurs couches de membranes
différentes, qu’on nomme en général les tégumens.
( 0 Supplément au Recueil des procédés d’expériences, &c.