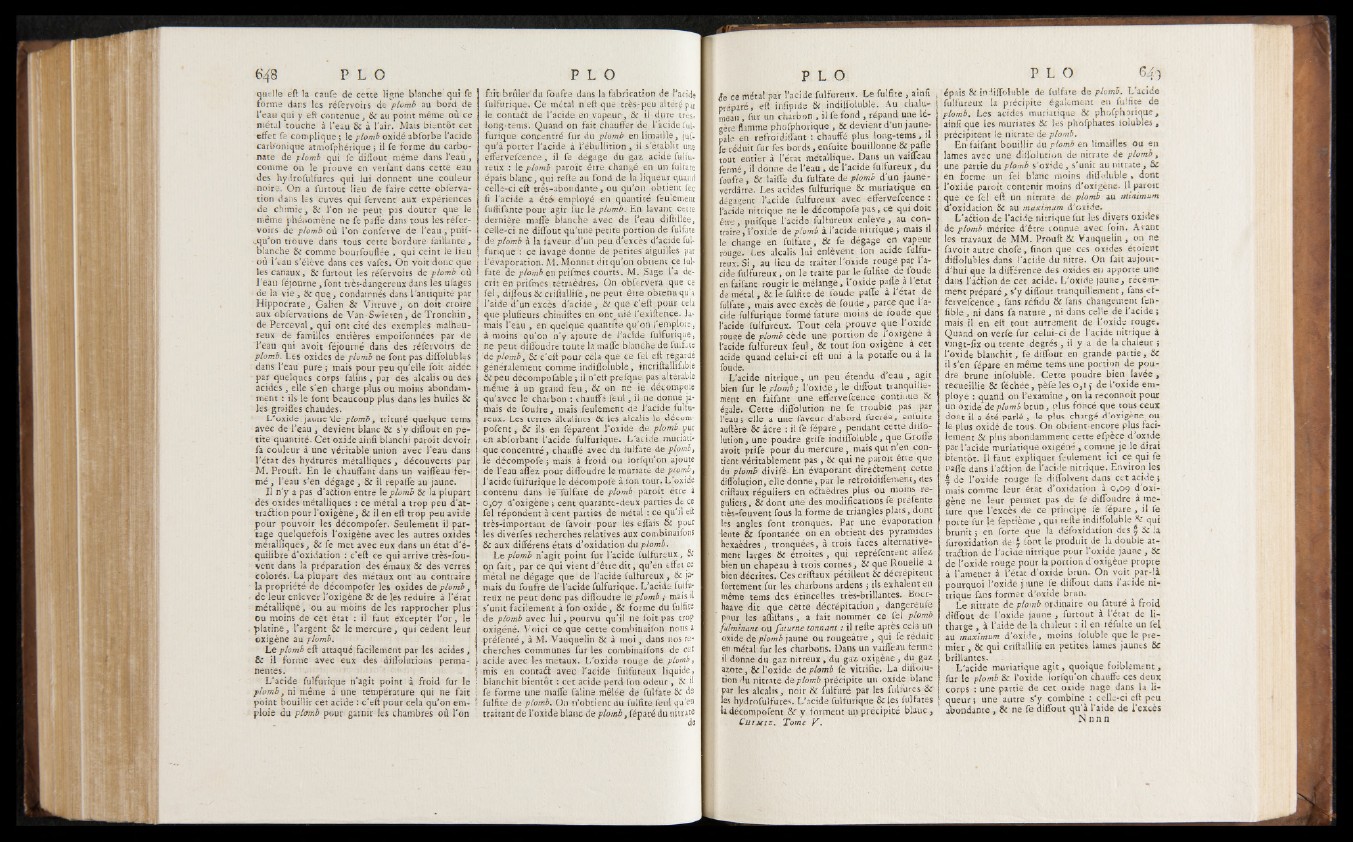
quelle eft la caufe de cette ligne blanche qui fe
forme dans les réfervoirs de plomb au bord de
l’eau qui y eft contenue & au point même où ce
métal touche à l’eau & à l’air. Mais bientôt cet
effet fe complique ; le plomb oxidé abforbe l’acide
carbonique atmofphérique > il fe forme du carbonate
de plomb qui fe diffout même dans l’eau,
comme on le prouve en verfant dans cette eau
des hydrofulfures qui lui donnent une couleur
noire. On a furtout lieu de faire cette obferva-
tion dans les cuves qui fervent aux expériences
de chimie, & l’on ne peut pas douter que le
même phénomène ne fe paffe dans tous les réfervoirs
de plomb où l’on conferve de l’eau , puif-
v.qu’on trouve dans tous cette bordure faillante,
blanche & comme bourfouflée , qui ceint le lieu
où l’eau s’élève dans ces vafes. On voit donc que
les canaux, 8c furtout les réfervoirs de plomb où
l ’eau féjourne, font très-dangereux dans les ufages
de la vie j & que, condamnés dans l ’antiquité par
Hippocrate j Galien & Vitruve, on doit croire
aux obfervations de Van-Swieten, de Tronchin ,
de Perceval, qui ont cité des exemples malheureux
de familles entières empoifonnées par de
l’eau qui avoit féjourné dans des réfervoirs de
plomb. Les oxides de plomb ne font pas diffolubles
dans l’eau pure j mais pour peu qu’elle foit aidée
par quelques corps falins, par des alcalis ou des
acides s elle s’en charge plus ou moins abondamment
: ils le font beaucoup plus dans les huiles 8c
les graiffes chaudes.
L ’oxide jaune *de plomb, trituré quelque tems
avec de l’eau , devient blanc & s’y diffout en petite
quantité. Cet oxide ainfi blanchi paroît devoir
fa couleur à une véritable union avec l’eau dans
J’état des hydrures métalliques , découverts par
M. Prouft. En le chauffant dans un vaiffeau fermé
3 l’eau s’en dégage 3 & il repaffe au jaune.
Il n’y a pas d’a&ion entre le plomb 8c la plupart
des oxides métalliques : ce métal a trop peu d’at-
traCtion pour l’oxigène, & il en eil trop peu avide
pour pouvoir les décompofer. Seulement il partage
quelquefois l’oxigène avec les autres oxides
métalliques 3 8c fe met avec eux dans un état d’équilibre
d’oxidation : c’eft ce qui arrive très-foü-
vent dans la préparation des émaux & des verres
colorés. La plupart des métaux ont au contraire
la propriété de décompofer les oxides de plomb ,
de leur enlever l’oxigène & de les réduire à l’état
métallique, ou au moins de les rapprocher plus
ou moins de cet état : il faut excepter l’o r, le
platine, l’argent & le mercure, qui cèdent leur
oxigène au plomb.
Le plomb eft attaqué facilement par les acides,
& il forme avec eux des diffolutions permanentes.
L’acide fulfurique n’agit point à froid fur le
plomb 3 ni même à une température qui ne fait
point bouillir cet acide : c’eft pour cela qu’on emploie
du phmb pour garnir les chambres où l'on
fait brûler'du foufre dans la fabrication de l’acide
fulfurique. Ce métal n eft que très-peu altéré par
le conta# de l’acide en vapeur, & il dure très.-
long-tems. Quand on fait chauffer de l’acide fui.
furique concentré fur du plomb en limaille, juf.
qu’à porter l’acide à l’ébullition, il s'établit une
effervefcence, il fe dégage du gaz acide fuifureux
: le plomb paroît être changé en un fullate
épais blanc, qui refte au fond de la liqueur quand
celle-ci eft très-abondante, ou qu’on obtient lec
fi l ’acide a été employé en quantité feulement
fuffifante pour agir fur le plomb. En lavant cette
dernière maffe blanche avec de l’eau diftillée,
celle-ci ne diffout qu’une petite portion de fulfate
de plomb à la faveur d’un peu d’excès d’acide fui-
furique : ce lavage donne de petites aiguilles par
l’évaporation. M. Monnet dit qu’on obtient ce lul-
fate de plombe n prifmes courts. M. Sage l’a décrit
en prifmes. tétraèdres, On obfervera que ce
fel, dijfous 8c criftallifé, ne peut être obtenu qua
l ’aide d’un excès d’acide, & que c’eft.pour cela
que plufieurs chimiftes en ont nié l’exiftence. Jamais
l’eau , en quelque quantité qu’on l’emploie}
à moins qu’on n’y ajoute de l’adde fulfurique,
ne peut dilïoudre toute la maffe blanche de fulfate
de plombs & c’eft pour cela que ce fel eft regardé
généralement comme indiffoluble, incriftallifable
& peu décompofable ; il n’ elt prefque pas altérable
même à un grand feu, & on ne le décompose
qu’avec le charbon : chauffé feul, il-ne donne jamais
de foufre * mais feulement de l’acide fulfu-
reux. Les terres alcalines 8c les alcalis le décom-
pofent, & ils en féparent l’oxide de plomb.put
en abforbant l’acide fulfurique. L’acide muriatique
concentré, chauffé avec du fulfate de plomb,
le décompofe j mais à froid ou lorfqu’on ajoute
de l’eau affez pour diffoudre le muriate de plomb,
l ’acide fulfurique le. décompofe à ton tour. L’oxide
contenu dans le"Tïilfate de plomb paroît être à
0,07 d’oxigènei cent quarante-deux parties de ce
fel répondent à cent parties de métal : ce qu’il eft
très-important de lavoir pour les effais 8c pour
les diverfes recherches relatives aux combinaifons
& aux différens états d’oxidation du plomb.
Le plomb n’agit point fur l'acide fuifureux, &
on fait, par ce qui vient d’être dit, qu’en effet ce
métal ne dégage que de l’acide fuifureux, & jamais
du foufre de l’acide fulfurique. L’acide fuifu-
reüx ne peut donc pas diffoudre 1t plomb 3 mais il
s’unit facilement à fon oxide, & forme du fulnce
de plomb avec lui, pourvu qu’il ne foit pas trop
oxigéné. Voici ce que cette combinaiion nous a
préfenté, à M. Vauquelin & à moi, dans nos recherches
communes fur les combinaifons de cet
acide avec les métaux. L'oxide rouge de plomb,
mis en conta# avec l’ acide fuifureux liquide;
blanchit bientôt : cet acide perd fon odeur, & ü
fe forme une maffe faline mêlée de fulfate 8c de
fulfite de plomb. On n’obtient du fuifite feul qu'en
traitant de l’oxide blanc de plomb, féparéd.u nitratf
dfe ce métal par l’acide fuifureux. Le fulfite , ainfi
préparé, eft infipide 8c indiffoluble. Au chalumeau
, fur un charbon , il fe fond , répand une légère
flamme phofphorique, 8c devient d’un jaune-
| pâle en refroidiffant : chauffé plus long-tems, il
I fe réduit fur fes bords, enfuite bouillonne & paffe
tout entier à l'état métallique. Dans un vaiff’eau
I fermé, il donne de l’eau, de l’acide fuifureux, du
foufre, & laiffe du fulfate de plomb d’ un jaune-
verdâtre. Les acides fulfurique 8c muriatique en
dégagent l’acide fuifureux avec effervefcence :
l’acide nitrique ne le décompofe pas, ce qui doit
être, puifque l'acide fuifureux enlève , au con-
I traire, l’oxide de plomb à l’acide nitrique, mais il
le change en fulfate, & fe dégage en vapeur
rouge. Les alcalis lui enlèvent fon acide fulfü-
I reux. S i, au lieu de traiter l ’oxide rouge par 1 a-
cide fuifureux, on le traite par le fulfite de foude
en fai fan t rougir le mélange, l’oxide paffe à 1 état
de métal, & le fuLfite de foude paffe à 1 état de
[ fulfate , mais avec excès de foude, parce que 1 a-
[ eide fulfurique formé fature moins de foude que
I 1-acide fuifureux. Tout cela prouve que 1 oxide
rouge de plomb cède une portion de i oxigène à
i l'acide fuifureux feul, 8c tout fon oxigène à cet
; acide quand celui-ci eft uni à la potaiîe ou à la
foude.
L’acide nitrique, un peu étendu d eau , agit
bien fur 1 ç plomb ; l'oxide, le diffout tranquiiie-
I ment en faifant une effervefcence continue 8c
égale. Cette diffolution ne fe trouble pas par
| l’eau j elle a une faveur d’abord fucrés, enluite
I auftère & âcre : il fe fépare, pendant cette dilio-
1 lution, une poudre grife indiffoluble, que Groffe
f avoit prife pour du mercure, mais qui n en con-
i tient véritablement pas , 8c qui ne paroit être que
du plomb divifé. En évaporant dire#ement cette
‘ diffolution, elle donne, par le relroidiffemenc, des
i criftaux réguliers en o#aèdres plus ou moins ré-
1 guliers, 8c dont une des modifications fe préfente
j très-feuvent fous la forme de triangles plats, dont
j les angles font tronqués. Par une évaporation
I dente & fpontanée on en obtient des pyramides
, hexaèdres, tronquées, à trois faces alcernative-
| ment larges 8c étroites, qui repréfentent allez
bien un chapeau à trois cornes, 8c que Rouelle a
bien décrites. Ces criftaux pétillent Sc déçrépitent
fortement fur les charbons ardens j ils exhalent en
même tems des étincelles très-brillantes. Boer-
haave dit que cette décrépitation, dangereule
j pour les affiftans, a fait nommer ce fel plomb
I fulminant ou faiurne tonnant : il refte après cela un 3 oxide de plomb jaune ou rougeâtre, qui fe réduit
| en métal fur les charbons. Dans un vaiffeau ferme
il donne du gaz nitreux, du gaz oxigène, du gaz
i azote, & l’oxide de plomb fe vitrifie. La diffolution
du nitrate de plomb précipite un oxide blanc
j par les alcalis, noir 8c lulfuré par les fulfures &
' les hydrofulfures. L’acide fulfurique & les fulfates
la décomposent 8r y forment un précipité blanc ,
Chimie. Tome V’.
épais 8c indiffoluble de fulfate de plomb. L’acide
fuifureux la précipite également en fuifite de
plomb. Les acides muriatique & phofphorique,
ainfi que les muriates & les phofphates folubles ,
précipitent le nitrate de plomb.
En faifant bouillir du plomb en limailles ou en
lames avec une diffolution de nitrate de plomb,
une partie du plomb s’oxide, s’unit au nitrate, 8c
en forme un fel blanc moins diffoluble > dont
l’oxide paroît contenir moins d’oxigène. Il paroît
que ce fel eft un nitrate de plomb au minimum.
d’oxidation & au maximum d'oxide.
L'aélion de l’acide nitrique fur les divers oxides
de plomb mérite d’être connue avec foin. Avant
les travaux de MM. Prouft 8c Vauquelin, on ne
favoic autre chofe, finon que ces oxides écoîent
diffolubles dans l’acide du nitre. On fait aujourd’hui
que la différence des oxides en apporte une
dans l’a#îon de cet acide. L’oxide jaune, récemment
préparé , s’ y diffout tranquillement, fans effet
vefcence , fans réfidu 8c fans changement fen-
fible, ni dans fa nature , ni dans celle de l’acide ;
mais il en eft tout autrement de l’oxide rouge.
Quand on verfe fur celui-ci de l'acide nitrique à
vingt-fix ou trente degrés , il y a de la chaleur ;
l’oxide blanchit, fe diffout en grande partie, &
il s’en fépare en même tems une portion de poudre
brune infolubîe. Cette poudre bien lavée ,
recueillie & féchée, pèfe les 0,1 f de l’oxide employé
: quand on l’examine , on la reconnoît pour
un oxide de plomb brun, plus foncé que tous ceux
dont il a été parlé , le plus chargé d'oxigène ou
le plus oxidé de tous. On obiient-encore plus facilement
& plus abondamment cette efpèce d’oxide
par l’acide muriatique oxigéné , comme je le dirai
bientôt. Il faut expliquer feulement ici ce qui fe
naffe dans l ’aélion de l’acide nitrique. Environ les
| de l’oxide rouge fe diffolvent dans cet acide ;
mais comme leur état d’ oxidation à 0,09 d’oxi-
gène ne leur permet pas de fe diffoudre a ine-
Cure que l'excès de ce principe fe fépare, il fe
porte fur le feptième , qui refte indiffoluble 8c qui
brunit j en forte que la defoxidation des -7- 8c la
furoxidation de } font le produire la double attraction
de l’aciue nitrique pour l’oxide jaune , &
de l’oxide rouge pour la portion d’oxigène propre
à l’amener à l’état d’oxide brun. On voit par-là
pourquoi l’oxide j .une fe diffout dans l’acide nitrique
fans former d’oxide brun.
Le nitrate de plomb ordinaire ou faturé à froid
diffout de l’oxide jaune , furtout à l’état de li-
tharge , à l’aide de la chaleur : il en réfulte un fel
au maximum d'oxide, moins l'oluble que le premier
, 8c qui criftallifé en petites lames jaunes &
brillantes.
L’acide muriatique agit, quoique foiblement,
fur le plomb 8c l’oxide lorfqu’on chauffe ces deux
corps : une partie de cet oxide nage dans la liqueur
*, une autre s*y combine : celle-ci eft peu
abondante, & ne fe diffout qu’à l’aide de l’excès
N nnn