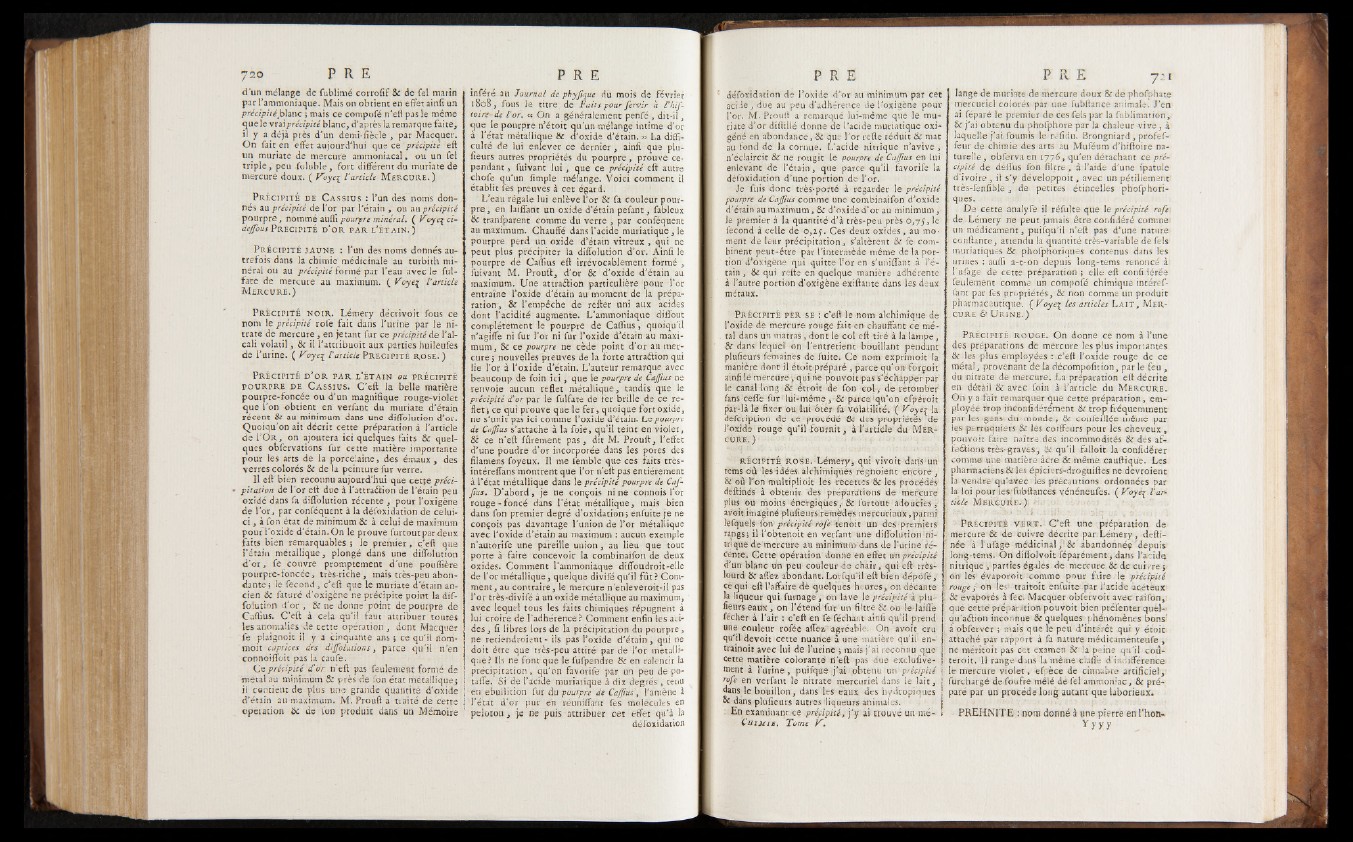
d'un mélange de fublimé corrofif & de Tel marin
par l’ammoniaque. Mais on obtient en effet ainfi un
p r é c ip i t é tblanc j mais ce compofé n’eft pas le même
^uele p r é c ip it é blanc, d’après la remarque faite,
il y a déjà près d’un demi-fiècle , par Macquer.
On fait en effet aujourd’hui que ce p r é c ip it é eft
un muriate de mercure ammoniacal, ou un fel
triple, peu -foluble, fort différent du muriate de
mercure doux. ( V a r t i c le Mercure.)
Précipité de C assius : l’un des noms donnés
au p r é c ip it é de l’or par l ’étain , pu au p r é c ip it é
pourpre, nommé aiiflî p o u r p r e m in é r a l. ( V o y e^ c i -
d e jfo u s Précipité d’or par l’étain. )
Précipité jaune : l’un des noms donnés autrefois
dans la chimie médicinale au turbith minéral
ou au p r é c ip it é formé par l’eau avec le ful-
fate de mercure au maximum. ( V o y e^ /’ a r t i c le
Mercure.)
Précipité noir. Lémery décrivoit fous ce
nom le p r é c ip it é rôle fait dans l’urine par le nitrate
de mercure, en jetant fur ce p r é c ip it é de l’alcali
volatil, & il l’attribuoit aux parties huileufes
de l’ urine. ( V o y e% l 'a r t i c l e Précipité rose. )
Précipité d’ or par l’étain ou précipité
pourpre de C assius. C ’eft la belle matière
pourpre-foncée ou d’un magnifique rouge-viôlet
que l’on obtient en verfant du muriate d’étain
récent & au minimum dans une diffolution d’or.
Quoiqu’on ait décrit cette préparation à l’article
de I’Or , on ajoutera ici quelques faits & quelques
obfervations fur cette matière importante
pour les arts de la porcelaine , des émaux , des
verres colorés & de la peinture fur verre.
Il eft bien reconnu aujourd’hui que cetpe p r é c i p
i t a t i o n de l'or eft due à l’attraâion de l'étain peu
oxidé dans fa diffolution récehte , pour l’oxigène
de l’or, par conféquent à la défoxidation de celui-
c i , à fon état de minimum & à celui de maximum
pour l’oxide d’étain. On le prouve furtout par deux
faits bien remarquables j le premier, c^eft que
l’étain métallique, plongé dans une diffolution
d’or, fe couvre promptement d’une poufïîère
pourpre-foncée, très-riche, mais très-peu abondante}
le fécond, c’eft que le muriate d’étain ancien
& faturé d’oxigène ne précipite point la dif-
folùtion d’o r , 8c ne donne point de pourpre de
Caflïus. C ’eft à cela qu’ il faut attriouer toutes
les anomalies de cette opération , dont Macquer
fe plaignoit il y a cinquante ans î ce qu’il notxi-
moit c a p r ic e s d e s d i f f o lu t io n s , parce qu’il n'en
connoiffoit pas la caufe.
Ce p r é c ip i t é d 'o r n’eft pas feulement formé de
métal au minimum & près de Ton état métallique }
il contient de plus une grande quantité d’oxide j
d’étain au maximum. M. Prouft a traité de cette j
operation 8c de Ion produit dans un Mémoire f
inféré au J o u r n a l d e p h y f iq u e du mois de février
1808, fous le titre de F a i t s p o u r f e r v i r à l 'h i f -
toire> d e l 'o r . « On a généralement penfé, dit-il,
que le pourpre n’étoit qu’un mélange intime d’or
à l’état métallique & d’oxide d’étain. » La difficulté
de lui enlever ce dernier, ainfi que plu-
fieurs autres propriétés du pourpre, prouve cependant
, fuivant lu i, que ce p r é c ip it é eft autre
chofe qu’un fimple mélange. Voici comment il
établit fes preuves à cet égard.
L’eau régale lui enlève l’or & fa couleur pourpre,
en laiffant un oxide d’étain pefant, fableux
& tranfparent comme du verre , par conféquent
au maximum. Chauffé dans l’acide muriatique, le
pourpre perd un oxide d’étain vitreux , qui ne
peut plus précipiter la diffolution d’or. Ainfi lé
pourpre de Caftais eft irrévocablement formé ,
fuivant M. Prouft, d’ or & d’oxide d’étain au
maximum. Une attra&ion particulière pour l’or
entraîne l’oxide d’étain au moment de la préparation,
& l’empêche de refter uni aux acides
dont l’acidité augmente. L’ammoniaque diffout
complètement le pourpre de Caffius, quoiqu’il
n’agiffe ni fur l’or ni fur l’oxide d’étain au maximum,
8 c ce p o u r p r e ne cède point d’or au mercure
; nouvelles preuves de la forte attraction qui
lie l'or à l’oxide d’étain. L’auteur remarque avec
beaucoup de foin ic i, que le p o u r p r e d e C affiu s ne
renvoie aucun reflet métallique, tandis que le
p r é c ip it é d'or, par le fulfate de fer brille de ce reflet}
ce qui prouve que le fer, quoique fort oxidé,
ne s’unit pas ici comme l’oxide d’étain. Le p ou rp re
d e Caffiu s s’attache à la foie, qu’il teint en violet,
8 c c e n’eft fûrement pas, dit M. Prouft, l’effet
d’une poudre d’or incorporée dans les pores des
filamens foyeux. Il me femble que ces faits très-
intéreffans montrent que i’or n’eft pas entièrement
à l’état métallique dans le p r é c ip it é p o u r p r e de C a f f
iu s . D’abord, je ne conçois ni ne connois l’or
rouge-foncé dans l’état métallique, mais Lien
dans fon premier degré d’oxidation} enfuite je ne
conçois pas davantage l’union de l’or métallique
avec l’oxide d’étain au maximum : aucun exemple
n’autorife une pareille union, au lieu que tout
porte à faire concevoir la coipbinaifon de deux
oxides. Comment l’ammoniaque diffoudroit-elle
de l’or métallique, quelque divifé qu’il fût ? Comment,
au contraire, le mercure n’enleveroit-il pas
l’or très-divifé à un oxide métallique au maximum,
avec lequel tous les faits chimiques répugnent à
lui croire de l'adhérence? Comment enfin les acides,
fi libres lors de la précipitation du pourpre,
ne retiendroient- ils pas l’oxide d’étain, qui ne
doit être que très-peu attiré par de l’or métallique?
Ils ne font que le fufpendre 8 c en ralencir la
précipitation, qu’on favorife par un peu de po-
taffe. Si de l’acide muriatique à dix degrés , tenu
j en ébullition fur du p ou rp re d e Cajfiùs',, l’amène à
i Pétat d’ or pur en réunifiant fes molécules en
peloton, je ne puis attribuer cet effet qu’à la
défoxidation
défoxidation de l’oxide d’or au mihimum par cet
aci-ie, due au peu d’adhérence de l’oxigène pour
l'or. M. Prouft a remarqué lui-même que le muriate
d’or diftillé donne de l'acide muriatique oxi-
géné en abondance, 8c que l’or refte réduit 8 c mat
au fond de la cornue. L’acide nitrique n’avive,
n’éclaircit 8 c ne rougit le p ou rp re d e C affiu s en lui
enlevant de l’étain, que parce qu’il favorife la
défoxidation d’une portion de l’or.
Je fuis donc très-porté à regarder 1 e p r é c ip it é
pourpre d e C a ffiu s comme une combinaifon d’oxide
d'érain au maximum, & d’oxide d’ or au minimum,
le premier à la quantité d’à très-peu près 0,75, le
fécond à celle de ©,zf. Ces deux oxides, au moment
de leur précipitation, s’altèrent 8c fe combinent
peut-être par l’intermède même de la portion
d’oxigène qui quitte Pór en s’unifiant à l’étain
, & qui refte en quelque manière adhérente
à l’autre portion d’oxigène exiftante dans les deux
métaux.
Précipité per se : c’éft le nom alchimique de
l’oxide dè mercure rouge fait en chauffant ce métal
dans un matras, dont le Col eft tiré à la lampe,
8c dans lequel on l ’entretient bouillant pendant
plufieurs fernainés de fuite-. Ce nom èxprimoit la
manière dont il étoifrpréparé, parce qu’on1 forçoit
ainfi le mercure y qui-ne pou voie pas s’échapper parle
canal long 8 c étroit de fon col , de retomber
fans ceffe fur lui-même , & parce qu’on efpéroit
par-là le fixer ou lui otèr fa volatilités h( J^ôyèç h
defeription de ce procédé & des propriétés de
Poxide rouge qu’ il fournit, à l’article du Mercure.)
'
réoipité Rose. Lémery, qui vivoit dans un
teins où les idées, klchirhiqüés régnoient ericbre,
& où Pon multiplibit les recettes & les procédés
deftiriés à obtenir des préparations de merturé
plus ou moins énergiqùes-, & fùrtout adoucies
avoit,imaginé p1ufiëur£remèdës mercuriatix ,parmi
lefquels fon p r é c ip it é r ô f d - t e n ù h un des premiers
rangs} il l’obtenoit en verfant une diffolution/nitrique
de mercure au minirrium'dans de l’urine récente.
Cette opération donne en effet un p r é c ip it é
d’ün blanc un peu couleur de chair, qui eft très-
lourd 8c affez abondant. Lorfqu’il eft bien dépôféy
cêqui eft ^affaire dè quelques heures, on décante
la liqueur qui-fumage , ©:n lave le p r é c i p i t é plusieurs
eaux, on l’étend fur un‘filtre & on ledaiffe
fécher à l’air : c’eft en fe féchant ainfi qu’il prend
une couleur rofée affez agréable. On avoit cru
qu’il devoit cette nuance à une matière qu’il en-
trainoit avec lui de l’urine 5 mais j’ai reconnu que
cette matière colorante ri eft pas due èxclufive-
ment à l’urine, puifque j ’aiobtenu un p r é c ip it é
rofe en verfant le nitrate mercuriel dans le lait,
dans le bouillon, dans les eaux des hydropiques
& dans plufieurs autres liqueurs animales.
En examinant ce p r é c ip i t é s j’y ai trouvé un mé-
Chimie. T o m e V .
lange de muriate de mercure doux 8c de phofphate
mercuriel colorés par une fubftance animale. J’en
ai féparé le premier deces fels par la fublimation,
& j’ai obtenu du phofphore par la chaleur vive, à
laquelle j’ai fournis le réfidu. Brongniard, profef-
feur de chimie des arts au Muféum d’hiftoire naturelle,
obferva en 1 7 7 6 , qu’en détachant ce p r é c
ip i t é de deffus fon filçre, à l’aide d’une fpatule
d’ivoire , il s’y développoit, avec un pétillement
très-fenfible, de petites étincelles phofphori-
ques.
De cette analyfe il réfulte que le p r é c ip it é r o fe
de Lémery ne peut jamais être cor.fidéré comme
un médicament, puisqu’il n’eft pas d’une nature
confiante, attendu la quantité très-variable de fels
muriatiques 8 c ph.ofphoriq.iles contenus dans les
urines : auffi a-t-on depuis long-tems renoncé à
l ufage de cette préparation } elle eft confi.iéree
feulement comme un compofé chimique intéref-
fant par fes propriétés, 8c non comme un produit
pharmaceutique. ( V o y e ç l e s a r t i c le s La it , Mercure
& U rine.)
Précipité rouge. On donne ce nom à l’une
des préparations de mercure les plus importantes
8 c les plus employées : c’eft l’oxide rouge de ce
métal, provenant delà décompofition, par le feu ,
du nitrate de mercure. La préparation eft décrite
en détail & avec foin àTarticle du Mercure.
On y a fait remarquer que cette préparation, employée
trop inconfidérement 8c trop fréquemment
par les gens du monde, & confeiliée même par
les perruquiers 8 c les coiffeurs pour les cheveux ,
pouvoit faire naître, des incommodités 8c des af-
I ferions très-graves, & qu’il falloit la confidërer
comme une matière âcre & même, cauftique. Les
pharmaciens & les épiciers-droguiftes ne devroient
: la vendre qu’avec les précautions ordonnées par
la loi pour les; flibftances vénéneufes. ( V o y è ç 2'art
i c l e Merèui$ev); ܧ
Précipité ver,t . ; C’eft une préparation de
mercure & de cuivre décrite par:Lémery, defti-
née à l’ufàgê .médicinal abandonné^'depuis
long-tems. On diffol voit féparément , dans l’acide
nitrique y parties égales de mercure & de cuivre}
6m les évaporoit comme pour faire -le p r é c ip i t é
rou ge f on les5-' trairoit enfuite par l’acide acétëux
8c évaporés à fiée Macquer obfervoit avec rai fon,:
què 'cetté préparation pouvoit bien prëfenter quel-
qu’aéliôn inconnue & quelques-: phénomènes bons
à obferver } mais que le peu d’intérêt qui y étoit
attaché par rapport à fa nature médicamenteufe ,
ne méiitoit pas cet examen & la peine qu’il coû-
teroit. 11 range dans la même cialie d'indifférence
le mercure violet, efpèce de cinnabre artificiel,
furchargé defoufre mêlé de-fel ammoniac, & préparé
par un procédé long autant que laborieux.
PREHNITE : nom donné à une pierre en l’hon*
Y y y y