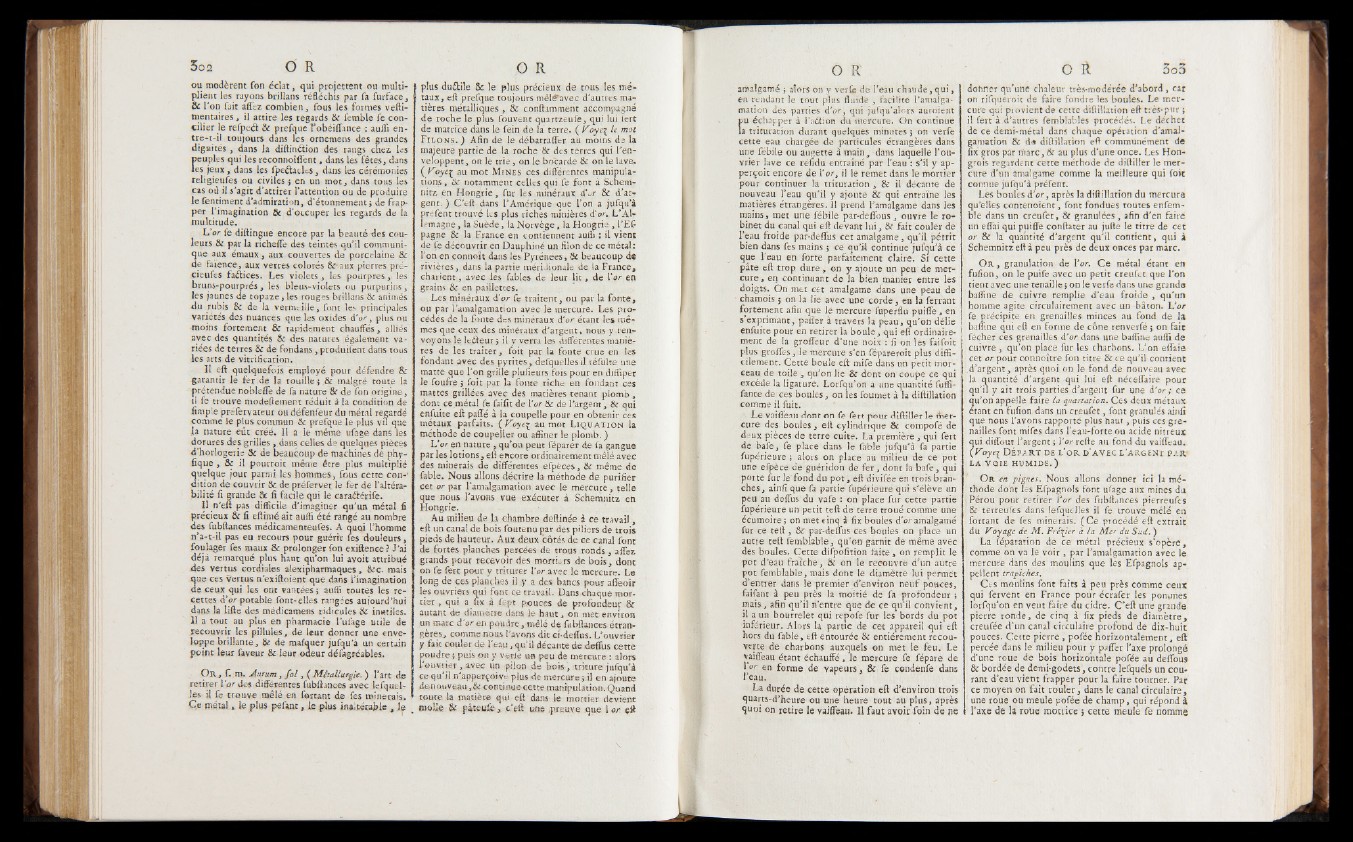
ou modèrent fon éclat , qui projettent ou multiplient
les rayons brillans réfléchis par fa furface,
& Ton fait affez combien, fous les formes vefti-
tnentaires, il attire les regards & femble fe concilier
le refpeét & prefque l’obéiffance : aulïi en-
tre-c-il toujours dans les ornemens des grandes
dignités , dans la diftinétion des rangs chez les
peuples qui les reconnolffent * dans les fêtes, dans
les jeux, dans les fpe&aclcs :g dans les cérémonies
religieuses ou civiles ; en un mot, dans tous les
cas oû il s’agit d’attirer l’attention ou de produiré
le fentiment d’admiration, d’étonnement; de frapper
l’imagination & d’occuper les regards de la
multitude.
L’or fe diftingue encore par la beauté des couleurs
& par la richeffe des teintes qu’il communique
aux émaux, aux couvertes de porcelaine &
de faïence, aux verres colorés &• aux pierres pré-
çieufes fa&ices. Les violets, les pourpres, les
bruns-pourprés , les bleus-violets ou purpurins,
les jaunes de topaze, les rouges brillans & animés
du rubis & de la vermeille, font les principales
variétés des nuances que les oxides d’or, plus ou
moins fortement & rapidement chauffés, alliés
avec des quantités & des natures également variées
de terres & de fondans , produifènt dans tous
les arts de vitrification.
Il eft quelquefois employé pour défendre &
garantir le fer.de la rouille; & malgré toute la
prétendue nobleffe de fa nature & de fon origine,
il fe trouve modeflement réduit à la condition de
fïmple préfervateur ou défenfeur du métal regardé
comme le plus commun & prefque le plus vil que
.la nature eût créé. Il a le même ufage dans les
dorures des grilles, dans celles ds quelques pièces
d’horlogerie & de beaucoup de machines de phy-
fique, & il pourroit même être plus multiplié
quelque jour parmi les hommes, fous cette con-*
cition de couvrir & de préfer ver le fer de l’altérabilité
fi grande & fi facile qui le cara&érife.
Il n’eft pas difficile d’imaginer qu’ un métal fi
précieux & fi eftimé ait aufli été rangé au nombre
des fubftances médicamenteufes. A quoi l’homme
n’a-t-il pas eu recours pour guérir fes douleurs,
foulager fes maux & prolonger fon exiftence ? J’ai
déjà remarqué plus haut qu’on lui avoit attribué
des vertus cordiales alexipharmaques, &c. mais
que ces Vertus n'exiftoient que dans l'imagination
de ceux qui les ont vantées ; aufli toutes les recettes
d’or potable font-elles rangées aujourd’hui
dans la lifte des médicamens ridicules & inutiles.
Il a tout au plus en pharmacie l'ufage utile de
recouvrir les pillules, de leur donner une enveloppe
brillante, & de mafauer jufqu'à un certain
point leur faveur & leur odeur défagréables.
Or , C. m. Aurum , f o l , ( Métallurgie. ) l’art dfi
retirer lor de« différentes fubftances avec lefquel-
les il fe trouve mêlé en fartant de fes minerais.
Çe métal * le plus pefant, le plus inaltérable , je
plus duébile & le plus précieux de tous les métaux,
eft prefque toujours mêlé*avec d’autres matières
métalliques, & conftamment accompagné
de roche le plus fouvent quartzeufe, qui lui lert
de matrice dans le fein de la terre. ( Voye% le mot
F i l o n s . ) Afin de le débarraffer au moins de U
majeure partie de la roche & des terres qui l’enveloppent,
on le trie, on le bocarde & on le lave.
( Voyeç au mot Mines ces différentes manipulations
, 6c notamment celles qui fe font à Schem-
nitz en Hongrie, fur les minéraux d’or & d’argent.
) C’eft dans l’Amérique que l’on a jufqu’à
prefent trouvé les plus riches minières d’o/* L’Ah
lemagne, la Suède, la Norvège, la Hongrie , l’E f
pagne & la France en contiennent aulïi : il vient
de fe découvrir en Dauphiné un filon de ce métal:
l’on en connoît dans les Pyrénées, & beaucoup de
rivières, dans la partie méridionale de la France,
charient, avec les fables de leur l i t , de Yor en
grains & en paillettes.
Les minéraux d’or fe traitent, ou par la fonte,
ou par l’amalgamation avec le mercure. Les procédés
de la fonte des minéraux d’or étant te* mêmes
que ceux des minéraux d’argent» nous y renvoyons
le lèéïeur ; il y verra les différentes manières
de les traiter, foit par la fonte crue en les
fondant avec des pyrites, defquellesil réfulte une
matte que l’on grille plufieurs fois pour en difliper
le foufre ; foit par la fonte riche en fondant ces
mattes grillées avec des matières tenant plomb ,
dont ce métal fe faifit de l’or & de l’argent, & qui
enfuite eft paffé à la coupelle pour en obtenir ces
métaux parfaits. (Voye% au mot L i q u a t i o n la
méthode de coupelier ou affiner le plomb. )
L’or en nature, qu’on peut féparer de fa gangue
par les lotions, eft encore ordinairement mêlé avec
des minerais de différentes efpèces, & même de
fable. Nous allons décrire la méthode de purifier
cet or par l'amalgamation avec le mercure, telle
que nous l’avons vue exécuter à Schemnitz en
Hongrie.
Au milieu de la chambre deftinée à ce travail,
eft un canal de bois foutenu par des piliers de trois
pieds de hauteur. Aux deux côtés de ee canal font
de fortes planches percées de trous ronds , affez
grands pour recevoir des mortiers de bois, dont
on fe fert pour y triturer l’or avec le mercure. Le
long de ces planches il y a des bancs pour affeoir
les ouvriers qui font ce travail. Dans chaque mortier
, qui a fix à fept pouces de profondeur &
autant de diamètre dans le haut, on mec environ
un marc d'or en poudre, mêlé de fubftances étrangères,
comme nous l’avons dit chdeffus. L’ ouvrier
y fait couler de l’eau, qu'il décante de deffus cette
poudre ; puis on y ve#fe un peu de mercure : alors
l’ouvrier, avec un pilon de bois, triture jufqu’à
ce qu’il n’apperçoi ve plus de mercure ; il en ajoute
denauveau, & contïnue cette.manipulation. Quand
toute la matière qui eft dans le mortier devient
ïuoUe & pâteiiüe , c’eft une preuve que 1 or eft
amalgamé ; alors on y verfie de l’eau chaude, qui,
en rendant le tout plus fluide, facilité l’amalgamation
des parties d'or, qui jufqu’alors auroient
pu échapper à i’a&ion du mercure. On continue
la trituration durant quelques minutes ; on verfe
cette eau chargée de particules étrangères dans
une fébile ou augette à main ■ dans laquelle l’ouvrier
lave ce réfidu entraîné par l’eau : s’il y ap-
perçoit encore de l’or, il le remet dans le mortier
pour continuer la trituration, & il décante de
nouveau l’eau qu’il y ajoute & qui entraîne les
matières étrangères. Il prend l’amalgame dans les
mains, met une fébile par-deffous, ouvre le robinet
du canal qui eft devant lui, &r fait couler de
l’eau froide par-deffus cet amalgame, qu’il pétrit
bien dans fes mains ; ce qu’il continue jufqu’à ce
que l’eau en forte parfaitement claire. Si cette
pâte eft trop dure, on y ajoute un peu de mercure,
en continuant de la bien manier entre les
doigts. On met cet amalgame dans une peau de
chamois ; on la lie avec une corde , en la ferrant
fortement afin que le mercure fuperflu puiffe, en
s’exprimant, paffer à travers la peau, qu’on délie
enfuite pour en retirer la boule, qui eft ordinairement
de la grolfeur d’une noix : fi on les faifoit
plus greffes, le mercure s’en fépareroit plus difficilement.
Cette boule eft mife dans un petit morceau
de toile , qu’on lie & dont on coupe ce qui
excède la ligature. Lorfqu’on a une quantité fuffi-
fante de ces boules, on les foumet à la diftillation
comme il fuit.
Le vailfeau dont on fe fert pour diftiller le ther-
cure des boules, eft cylindrique & compofé de
deux pièces de terre cuite. La première, qui fert
de bafe, fe place dans le fable jufqu’à fa partie
fiipérieure j alors on place au milieu de ce pot
une efpèce de guéridon de fer, dont la bafe, qui
porte fur le fond du pot, eft divifée en trois branches,
ainfi que fa partie' fupérieure qui s’élève un
peu au deffus du vafe : on place fur cette partie
fupérieure un petit teft de terre troué comme une
écumoire j on met cinq à fix boules d’or amalgamé
fur ce teft, 6c par-deffus ces boules on place un
autre teft femblable, qu’on garnit de même avec
des boules. Cette difpofition faite, on remplit le
pot d'eau fraîche, & on le recouvre d’un autre
pot femblable, mais dont le diamètre lui permet
d’entrer dans le premier d’environ neuf pouces,
faifant à peu près la moitié de fa profondeur ;
mais, afin qu’il ri’entre que de ce qu’il convient,
il a un bourrelet qui repofe fur les bords du pot
inférieur. Alors la partie de cet appareil qui eft
hors du fable, eft entourée 6c entièrement recouverte
de charbons auxquels on met le feu. Le
vaiffeau étant échauffé, le mercure fe fépare de
IV en forme de vapeurs , & fe condenfe dans
l’eau.
La durée de cette opération eft d’environ trois
quarts-d’heure ou une heure tout au plus, après
quoi on retire le vaiffeau. Il faut avoir foin de ne
donner qu’une chaleur très-modérée d’abord , car
on rifqueroit de faire fondre les boules. Le mercure
qui provient de cette diftillation eft très-pur ;
il fert à.d’autres femblables procédés. Le déchet
de ce demi-métal dans chaque opération d’amalgamation
& d<* diftillation eft communément de
fix gros par marc, & au plus d’une once. Les Hongrois
regardent cette méthode de diftiller le mercure
d’un amalgame comme la meilleure qui fort
connue jufqu’à préfent.
Les boules d’or, après la diftillation du mercure
qu’elles contenoient, font fondues toutes enfem-
ble dans un creufet, & granulées, afin d’en faire
un effai qui puiffe conftater au jufte le titre de cet
or & la quantité d’argent qu’il contient, qui à
Schemnitz eft à peu près de deux onces par marc.
Or , granulation de l’or. Ce métal étant en
fufion, on le puife avec un petit creufet que l’on
tient avec une tenaille ; on le verfe dans une grande
baffine de cuivre remplie d’eau froide , qu’un
homme agite circulairement avec un bâton. L’or
fe précipite en grenailles minces au fond de la
1 bafline qui eft en forme de cône renverfé ; on fait
I fécher ces grenailles d’or dans une bafline aufli de
cuivre, qu’on place fur les charbons. L’on effaie
cet or pour connoître fon titre & ce qu’il contient
d’argent, après quoi on le fond de nouveau avec
la quantité d’argent qui lui eft néceffaire pour
qu’il y ait trois parties d’argent fur une d’or; ce
qu’on appelle faire la quartation. Ces deux métaux
étant en fufion dans un creufet, font granulés ainfi
que nous l’avons rapporté plus haut, puis ces grenailles
font mifes dans l'eau-forte ou acide nitreux
qui diffout l’argent ; l’or refte au fond du vaiffeau.
(Voyei D é p a r t d e l ’ o r d ’a v e c l ’a r g e n t p a r l
a VOIE HUMIDE. )
Or en pignes. Nous allons donner ici la méthode
dont les Efpagnols font ufage aux mines du
Pérou pour retirer l’or des fubftances pierreufes
& terreufes dans lesquelles il fe trouve mêlé en
fortant de fes minerais. (Ce procédé eft extrait
du Voyage de M. Freezer a la Mer du Sud. )
La féparation de ce métal précieux s’opère,
comme on va le voir, par l’amalgamation arec le
mercure dans des moulins que les Efpagnols appellent
trapiches.
Ces moulins font faits à peu près comme ceux
qui fervent en France pour écrafer les pommes
lorfqu’on en veut faire du cidre. C ’eft une grande
pierre ronde, de cinq à fix pieds de diamètre,
creufée d’un canal circulaire profond de dix-huit
poutes. Cette pierre, pofée horizontalement, eft
percée dans le milieu pour y paffer l’axe prolongé
d’une roue de bois horizontale pofée au deffous
& bordée de demi-godets, contre lefquéls un courant
d’eau vient frapper pour la faire tourner. Par
ce moyen on fait rouler, dans le canal circulaire,
une roue ou meule pofée de champ, qui répond à
l’axe de la rôtie motrice ; cette meule fe nomme