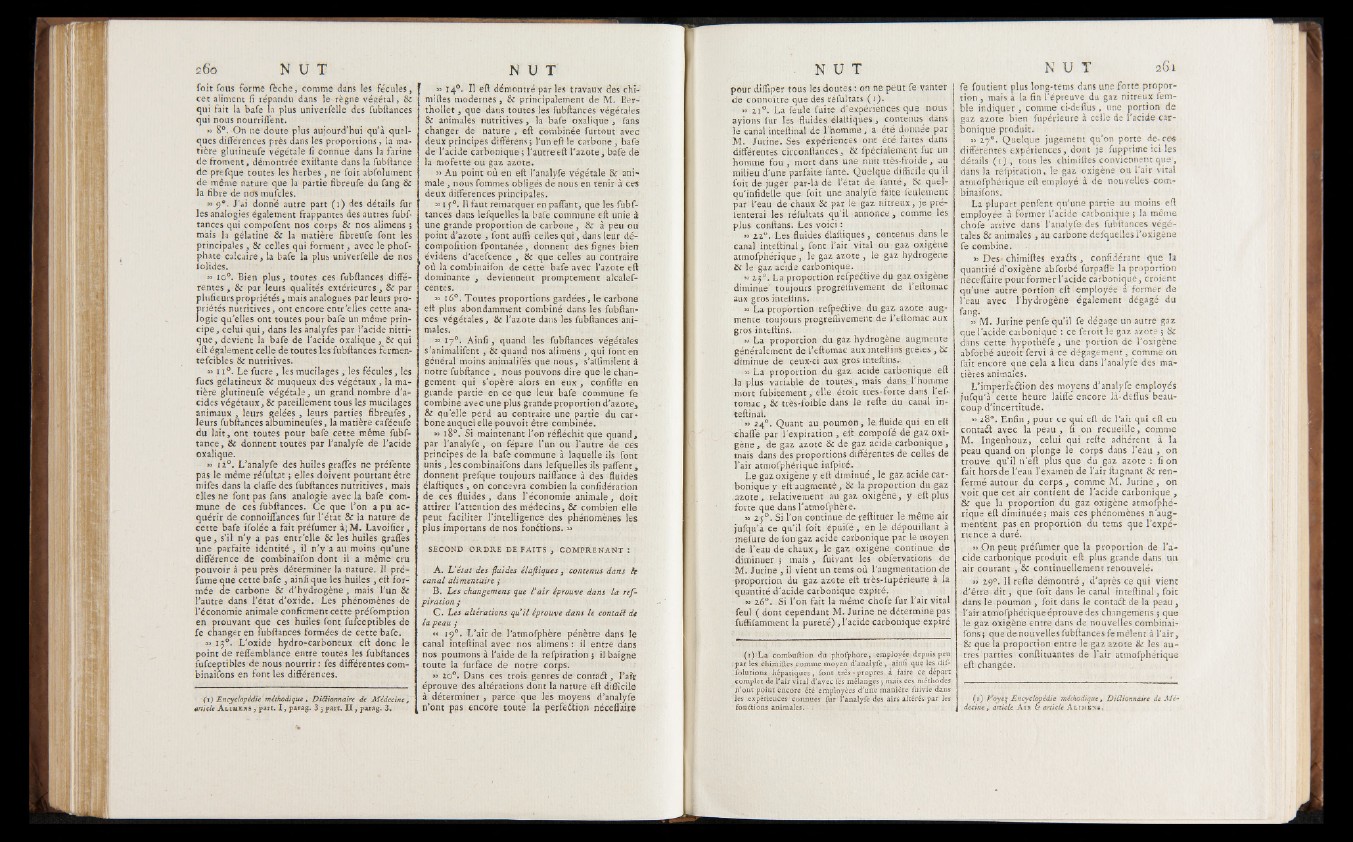
foit fous forme fèche, comme dans les fécules,
cet aliment lî répandu dans le règne végétal, &
qui fait la bafe la plus univerfelle des fubftances
qui nous nourriffent.
»9 8°. On ne doute plus aujourd’hui qu’à quelques
différences près dans les proportions, la matière
glutineufe végétale fi connue dans la farine
de froment, démontrée exiftante dans la fubftance
de prefque toutes les herbes, ne foit abfolument
de même nature que la partie fibreufe du fang &
la fibre de nos mufcles.
9®. J'ai donné autre part ( i) des détails fur
les analogies également frappantes des autres fubf-
tances qui compofent nos corps & nos alimens 5
mais h gélatine & la matière fibreufe font les
principales, & celles qui forment, avec le phof-
phate calcaire, la bafe la plus univerfelle de nos
lolides.
» io°. Bien plus, toutes ces fubftances différentes
, & par leurs qualités extérieures , & par
plufieurs propriétés, mais analogues par leurs propriétés
nutritives, ont encore entr’elles cette analogie
qu’elles ont toutes pour bafe un même principe,
celui qui, dans les analyfes par l’acide nitrique,
devient la bafe de l’acide oxalique, & qui
eft également celle de toutes les fubftances fermen-
tefcibles & nutritives.
99 1 1°. Le fucre, les mucilages, les fécules, les
fucs gélatineux & muqueux des végétaux , la matière
glutineufe végétale, un grand nombre d’acides
végétaux, & pareillement tous les mucilages
animaux , leurs gelées, leurs parties fibreufes,
leurs fubftances albumineufes, la matière caféeufe
du lait, ont toutes pour bafe cette même fubftance,
& donnent toutes par l’analyfe de l’acide
oxalique.
» 12°. L’analyfe des huiles graffes ne prélente
pas le même réfultat j elles doivent pourtant être
mifes dans la claffe des fubftances nutritives, mais
elles ne font pas fans analogie avec la bafe commune
de ces fubftances. Ce que l’on a pu acquérir
de connoiffances fur l’état & la nature de
cette bafe ifolée a fait préfumer àj M. Lavoifier,
que, s’il n’y a pas entr’elle & les huiles graffes
une parfaite identité , il n’y a au moins qu’une
différence de combinaifon dont il a même cru
pouvoir à peu près déterminer la nature. II pré-
lume que cette bafe, ainfi que les huiles, eft formée
de carbone & d’hydrogène, mais l’un &
l’autre dans l’état d’oxide. Les phénomènes de
l’économie animale confirment cette préfomption
en prouvant que ces huiles font fufceptibles de
fe changer en fubftances formées de cette bafe.
» 130. L’oxide hydro-carboneux eft donc le
point de reffemblance entre toutes les fubftances
fufceptibles de nous nourrir : fes différentes combinaisons
en font les différences.
Ci) Encyclopédie méthodique , Dictionnaire de Médecine, article A l im e n s , part. I , parag. 3 5 part, I I , parag. 3.
I « 140. Il eft démontré par les travaux des chî-
I miftes modernes, & principalement de M. Bèr-
thollet, que dans toutes les fubftances végétales
& animales nutritives, la bafe oxalique , fans
changer de nature , eft combinée furtout avec
deux principes différens? l’un eft le carbone, bafe
de l’acide carbonique? l’autre eft l’azote, bafe de
la mofette ou gaz azote.
» Au point où en eft l’analyfe végétale & animale
, nous fommes obligés de nous en tenir à ces
deux différences principales.
m 15°. Il faut remarquer en paffant, que les fubftances
dans lefquelles la bafe commune eft unie à
une grande proportion de carbone, & à peu 011
point d’azote , font auflî celles qui, dans leur dé-
compofition fpontanée, donnent des lignes bien
évidens d’acefcence , & que celles au contraire
où la combinaifon de cette bafe avec l’azote eft
dominante , deviennent promptement alcalef-
centes.
m i6°. Toutes proportions gardées, le carbone
eft plus abondamment combiné dans les fubftances
végétales, & l’azote dans les fubftances animales.
» 170. Ainfi , quand les fubftances végétales
s’animalifent, & quand nos alimens , qui font en
général moins animalifés que nous, s’affimilent à
notre fubftance , nous pouvons dire que le changement
qui s’opère alors en eux, cqnfifte en
grande partie en ce que leur bafe commune fe
combine avec une plus grande proportion d’azote,
& qu’elle perd au contraire une partie du carbone
auquel elle pouvoit être combinée.
» 180. Si maintenant l’on réfléchit que quand,
par l’analyfe, on fépare l’un ou l’autre de ces
principes de la bafe commune à laquelle ils font
unis, lescombinaifons dans lefquelles ils paffent,
donnent prefque toujours naiffance à des fluides
élaftiques , on concevra combien la confédération
de ces fluides, dans l’économie animale, doit
attirer l’attention des médecins, & combien elle
peut faciliter l’intelligence des phénomènes les
plus importans de nos fonctions. »
SECOND ORDRE DE FAITS , COMPRENANT î
A. L’état des fluides élaftiques , contenus dans h
canal alimentaire y
B. Les changemens que l ’air éprouve dans la refpiration
y
C. Les altérations quil éprouve dans le contait de
la peau y
« 190. L/air de l'atmofphère pénètre dans le
canal inteftinal avec nos alimens : il entre dans
nos poumons à l’aide de la refpiration ? il baigne
toute la furface de notre corps.
» 2o°. Dans ces trois genres de conta#, Pair
éprouve des altérations dont la nature eft difficile
à déterminer , parce que les moyens d’analyfe
n’ont pas encore toute la perfection néceffaire
pour diffiper tous les doutes : on ne peut fe vanter
de connoïtre que des réfultats (1).
p 2i°. La feule fuite d’expériences que nous
ayions fur les fluides élaftiques, contenus dans
le canal inteftinal de l ’homme, a été donnée par
M. Jurine. Ses expériences ont été faites dans
différentes circonllances, & fpécialement fur un
homme fou, mort dans une nuit très-froide, au
milieu d’une parfaite fanté. Quelque difficile qu il
foit de juger par-là de l’état de fanté, & quel-
qu’infidelle que foit une analyfe faite feulement
par l’eau de chaux & par le gaz nitreux, je pré-
fenterai les réfultats qu’il annonce, comme les
plus conftans. Les voici :
« 22°. Les fluides élaftiques, contenus dans le
canal inteftinal, font l’air vital ou gaz oxigène
atmofphérique , le gaz azote , le gaz hydrogène
& le gaz acide carbonique. | | \
w 230. La proportion refpedive du gaz oxigène
diminue’ toujours progreflivement de l’eftomac
aux gros inteitins.
» La proportion refpedive du gaz azote augmente
toujours progreflivement de l’eflomac aux
gros inteftins.
« La proportion du gaz hydrogène augmente
généralement de l’eftomac aux inteftins grëies, &
diminue de ceux-ci aux gros inteftins.- .
»La proportion du gaz acide carbonique eft
la plus variable de toutes, mais dans l’homme
mort fubitement, elle étoit très-forte dans l’ef*
tomac, & très-foible dans le refte du canal in-
teftinal.
»9 24°. Quant au poumon, le fluide qui en eft
chaffé par l ’expiration , eft compofé de gaz oxigène
, de gaz azote & de gaz acide carbonique,
mais dans des proportions différentes de celles de
l’air atmofphérique infpué.
Le gaz oxigène y eft diminué, le gaz acide carbonique
y eft augmenté, & la proportion du gaz
.azote, relativement au gaz oxigène, y eft plus
forte que dans l’atmofphère.
>» 25°. Si l’on continue dereftituer le même air
jufqu’à ce qu’il foit épuifé, en le dépouillant a
mefure de ion gaz acide carbonique par le moyen
de l’eau de chaux, le gaz oxigène continue de
diminuer 5 mais, fuivant les obfervations de
M. Jurine , il vient un tems. où l ’augmentation de
proportion du gaz azote eft très-fupérieure à la
quantité d’acide carbonique expiré.
»9 26°. .Si l’on fait la même chofe fur l’air vital
feul ( dont cependant M. Jurine ne détermine pas
fuffifamment la pureté), l’acide carbonique expiré
(i)'La combuftion du phofphore, employée depuis peu . par les chimifles .comme moyen d’analyfe , ainfi que les dif-
.folutions hépatiques, font très- propres, à faire ce départ!
complet de l’air vital d’avec fes mélangés j mais ces méthodes
n’ont point encore été employées d’une manière fuivie dans
les expériences connues fur l’analyfe des airs altérés par les
fondions animales. .
fe foutient plus long-tems dans une forte proportion
, mais a la fin l’épreuve du gaz nitreux fem-
ble indiquer , comme ci-deffus, une portion de
gaz azote bien fupérieure à celle de l’ acide carbonique
produit.
9? 27°. Quelque jugement qu’on porte de-ces
différentes expériences, dont je fupprime ici les
détails (1) , tous les chimiftes conviennent que ,
dans la refpiration, le gaz oxigène ou l’air vital
atmofphérique eft employé à de nouvelles com-
binaifons.
La plupart penfent qu’une partie au moins eft
employée à former l’acide carbonique ; la même
chofe arrive dans' l’analyfe des fubftances végétales
& animales , au carbone defquelles i’oxigène
fe combine.
99 Des chimiftes exads, confidérant que la
quantité d’oxigène abforbé furpaffe la proportion
néceffaire pour former l’acide carbonique, croient
qu’une autre portion eft employée à former de
l’eau avec l’hydrogène également dégagé du
fan9gï -M. Jurine penfe qu’ il fe dégagé un autre gaz
que l’acide carbonique : ce feroit le gaz azote 5 &
dans cette hypothèfe, une portion de l’oxigène
abforbé auroit fervi à ce dégagement, comme on
fait encore que cela a lieu dans l’ analyfe des matières
animales.
L’imperfedion des moyens d’analyfe employés
jufqu’à cette heure laiffe encore là-deffus beaucoup
d’incertitude.
99 28°. Enfin , pour ce qui eft de l’air qui eft en
contad avec la peau, fi on recueille, comme
M. Ingenhouz, celui qui refte adhérent à la
peau quand on plonge le corps dans l’eau , on
trouve qu’ il n’eft plus que du gaz azote : fi on
fait hors de l’eau l’examen de l’air ftagnant & renfermé
autour du corps, comme M. Jurine , on
voit que cet air contient de l ’acide carbonique ,
& que la proportion du gaz oxigène atmofphérique
eft diminuée? mais ces phénomènes n’augmentent
pas en proportion du tems que l'expérience
a duré. ,
99 On peut préfumer que la proportion de l’acide
carbonique produit eft plus grande dans un
air courant, & continuellement renouvelé.
99 29°. Il refte démontré, d’après ce qui vient
d’être dit, que foit dans le canal inteftinal, foit
dans le poumon , foit dans le contad de la peau,
l’air atmofphérique éprouve des changemens ? que
le gaz oxigène entre dans de nouvelles combinai-
fons ; que de nouvelles fubftances fe mêlent à l’air,
& que la proportion entre le gaz azote & les autres
parties conftituantes de l’air atmofphérique
eft changée.
(1) Voyez Encyclopédie méthodique, Dictionnaire de Médecine
y article A ir & article A l im e n s .