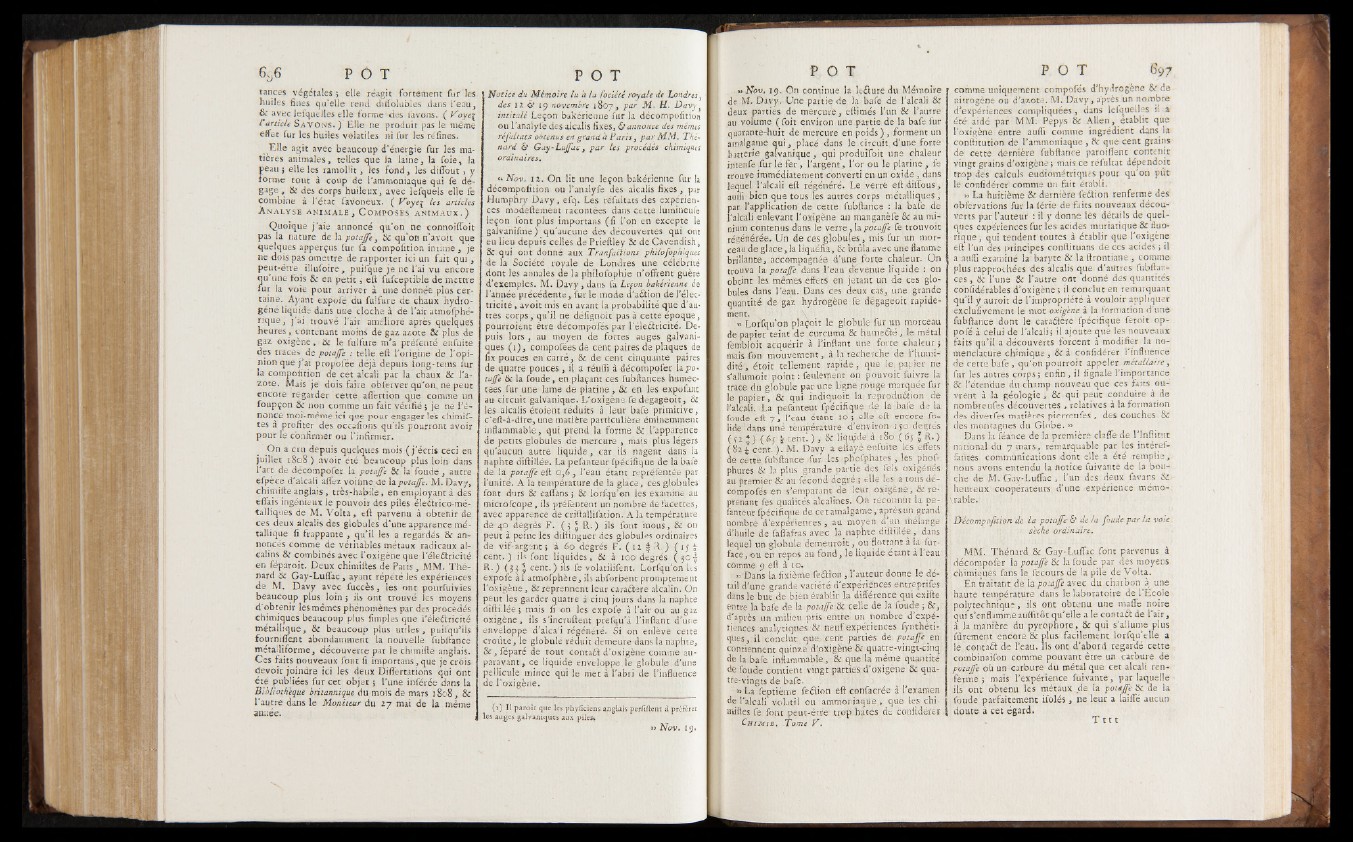
tances végétales 5 elle réagit fortement fur' les
huiles fines qu’elle rend difîolubles dans l’eau,
te avec Jefquelles elle forme des lavons. ( Voyetç
P article S a v o n s . ) Elle ne produit pas le même
effet fur les huiles volatiles ni fur les réfines.
Elle agit avec beaucoup d’énergie fur les matières
animales, telles que la laine, la foie, la
peauj elle les ramollit, les fond, les diflout » y
forme tout à coup de l’ammoniaque qui fe dégage
, & des corps huileux, avec lefquels elle fe
combine à l’état favoneux. ( Voye1 les articles
A n a l y s e a n i m a l e , C o m p o s é s a n i m a u x . )
Quoique j ’aie annoncé qu’on ne connoiffoit
pas la nature de la potajfe, & qu’on n’avoit que
quelques apperçus fur fa compofition intime, je
ne dois pas omettre de rapporter ici un fait qui,
peut-être iîlufoire, puifque je ne l’ai vu encore
qu’une fois & en petit j eft fufceptible de mettre
fur la voie pour arriver à une donnée plus certaine.
Ayant expofé du fulfure de chaux hydrogéné
liquide dans une cloche à de l’air atmolphé-
rique, j'ai trouvé l’air amélioré après quelques
heures, contenant moins de gaz azote & plus de
gaz oxigène, & le fulfure m’a préfenté enfuite
des traces de potajfe ; telle eft l’origine de l’opinion
que j’ai propofée déjà depuis long-tems fur
la compofition de cet alcali par la chaux & l’azote.
Mais je dois faire obferver qu’oa. ne peut
encore regarder cette afiertion que comme un
foupçon & non comme un fait vérifié > je ne i’e-
nonce moi-même ici que pour engager les chimif-
tes à profiter des occafions qu’ils pourront avoir
pour le confirmer ou l’infirmer.
On a cru depuis quelques mois ( j ’écris ceci en I
juillet 1800 ) avoir été beaucoup plus loin dans
l’art de décompofer la potajfe & la foude , autre
efpèce d’ alcali affez voifine de la potajfe. M. Davy,
chimifte anglais, très-habile, en employant à des
eflais ingénieux le pouvoir des piles éledtrico-mé-
talliques de M. Volta, eft parvenu à obtenir de
ces deux alcalis des globules d’une apparence métallique
fi frappante, qu’il les a regardés & annoncés
comme de véritables métaux radicaux alcalins
& combinés avec l’oxigèneque l’éledtricité
en féparoit. Deux chimiftes de Paris, MM. Thénard
& Gay-Luffac, ayant répété les expériences
de M. Davy avec fuccès, les ont pourfuivies
beaucoup plus loin 5 iis ont trouvé les moyens
d'obtenir les mêmes phénomènes par des procédés
chimiques beaucoup plus fimples que i’éleélricité
métallique, & beaucoup plus utiles , puifqu’ ils
fourniffent abondamment la nouvelle fubftance
métailiforme, découverte par le-chimifte anglais.
Ces faits nouveaux font fi importans, que je crôis
devoir joindre ici les deux Differtatiohs qui ont
été publiées fur cet objet 5 l’une inférée dans la
Bibliothèque britannique du mois de mars 1808, &
l ’autre dans le Moniteur du 27 mai de la même
année. g
Notice du Mémoire lu a la fociété royale de Londres ,
des i l & 19 novembre 1807, par M. H. Davyt
intitulé Leçon bakederme fur la décompofition
ou l’anaiyfe des alcalis fixes, & annonce des mêmes
réfultats obtenus en grand h Paris, par MM. Thénard
& Gay-Luffac, par les procédés chimiques
ordinaires.
« Nov. 1 1. On lit une leçon bakérienne fur la
décompofition ou l’analyfe des alcalis fixes, par
Humphry Davy , efq. Les réfultats des expériences
modeftemeot racontées dans cette lumineufe
leçon font plus importans (fi l’on en excepte le
gaivanifme) qu’aucune des découvertes qui ont
eu lieu depuis celles de Prieftley & de Cavendish,
& qui onr donné aux Tranfaclions philofopniques
de la Société royale de Londres une célébrité
dont les annales de la philofophie n’offrent guère
d’exemples. M. Davy, dans fa Leçon bakérienne de
l ’année précédente, fur le mode d’adtion de l’électricité
, avoit mis en avant la probabilité que d’autres
corps, qu’il ne défignoit pas à cette époque,
pourroienc être décompofés par l'électricité. Depuis
lors, au moyen de fortes auges galvaniques
(1 ), compofées de cent paires de plaques de
lix pouces en carré, & de cent cinquante paires
de quatre pouces, il a réuffï à décompofer lapo-
tajfe & la foude, en plaçant ces fubftances humectées
fur une lame de platine, & en les expofant
au circuit galvanique. L’oxigène fe dégageoit, &
les alcalis étoient réduits à leur bafe primitive,
c’ eft-à-dire, une matière particulière éminemment
inflammable 3 qui prend la forme & l’apparence
de petits globules de mercure , mais plus légers
qu’aucun autre liquide, car ils nagent dans la
naphte diftillée. La pefanteur fpécifique de là baie
de la potajfe eft 0,6, l’eau étant repréfentée par
l’unité. A la température de la glace, ces globules
font durs & caftans j & lotfqu’on les examine au
microfcope, ils préfentent un nombre de facettes,
avec apparence de criftallifation. A la température
de 40 degrés F. (3 \ IL) ils font mous, & on
peut à peine les diftinguer des globules ordinaires
de vif-argent > à 60 degrés F. ( 12 | R. ) ( iy 5
cent.) ils font liquides, & à 100 degrés ( 30^
R.) (33-9 cent.) ils fe volatilifent. Lorfqu’on les
expofe àl acmofphère, ils abforbent promptement
l’oxigène, & reprennent leur caractère alcalin. On
peut les garder quatre à cinq jours dans la naphte
diftillée j mais fi on les expofe à l’air ou au gaz
oxigène, ils s'incruftent prefqu’à l’inflant d’une
enveloppe d’alca'i régénéré. Si on enlève cette
croûte, le globule réduit demeure dans la naphte,
& , féparé de tout contadl d’oxigène comme auparavant,
ce liquide enveloppe le globule d’uns
pellicule mince qui Je met à l’abri de l’influence
de l ’oxigène.
(1) Il paroîc que les phyficiens anglais perfîftent à préférer
les auges galvaniques aux pilesi
» Nov. 19.
» Nov. 19. On continue la ledture du Mémoire
de M. Davy. Une partie de la bafe de l’alcali &
deux parties de mercure, ëftimés l’un & l’autre
au volume (foit environ une partie de la bafe fur
quarante-huit de mercure en poids ) , forment un
amalgame qui, placé dans le circuit, d’une forte
batterie galvanique, qui produîfoit une chaleur
intenfe furie fe r , l’argent, l’or ou le plarine, fe
trouve immédiatement converti en un oxide, dans
lequel l’alcali eft régénéré. Le verre eft diffous,
aufii bien que tous les autres corps métalliques,
par l’application de cette fubftance : la bafe de
l’alcali enlevant l’oxigène au manganèfe Sz au minium
contenus dans le verre, la potajfe fe trouvoit
régénérée. Un de ces globules, mis fur un morceau,
de glace, la liquéfia, & brûla avec une flamme
brillante, accompagnée d’un,e forte chaleur. On
trouva la potajfe dans l’eau dé venue liquide : on
obtint les mêmes effets en jetant un de ces globules
dans l’eau. Dans ces deux cas, une grande
quantité de gaz hydrogène fe dégageoic rapide-
m'ent. . \
» Lorfqu’on plaçoit le globule fur un morceau
de papier teint de curcuma & humedté, le métal
femblôit acquérir à l’inflant une forte chaleur 5
mais fon mouvement, à la recherche de 1 humidité,
étoit tellement rapide, que le, papier ne
s’allumoit point : feulement on pouvoit fuivre la
trace du globule par une ligne rouge marquée fur
le papier , & qui indiquoit la reproduction de
l’alcali. La pefanteut fpécifique de la baie delà
foude eft 7 , l’eau étant 10 , elle eft encore fo-
lidédans une température d’environ lyo degrés
( ? 1 *) (.6-5 | cent. ) , & Uqiiji.de'à 180 (65 J R.)
( 821 cent. ). M. Davy a effayé enfuite les effets
de cette, fubftance fur les phofphates, les phof-
phures & la plus grande partie des Tels oxigênés
au premier & au fécond degré j elle les a tous décompofés
en s’emparant de leur oxigène, & reprenant
fes qualités alcalines. On reconnut la pefanteur
fpécifique de cet amalgame, après un grand
nombre d’expériences, au moyen d’un mélange
d’huile de faflafras avec la naphte diftillée, dans
lequel un globule demeuroit, ou flottant à la fur-
face, ou en repos au fond, le liquide étant a l’eau
comme 9 eft à 10. ■ : . ^ • F •
» Dans la fixièmeLection, l’auteur donne le détail
d’une grande variété d’expériences entreprises
dans le but de bien établir la différence qui exifte
entre la bafe de la potajfe tz celle de la foude 5 &,
d-?après un milieu pris entre un nombre d’expériences
analytiques & neuf expériences fynthéti-
qiives, il conclut que:..cent parties de potajfe en
contiennent quinze d'oxigène & quatre-vingt-cinq
de la bafe inflammable, & que la même quantité
de foude contient vingt parties d’oxigène & quatre
vingts de bafe.
« La feptième fedtion eft confacrée à l’examen
de l’alcali volatil ou ammoniaque , que les chi-
îîiiftes fe font peut-être trop hâtés de confidérer
Chimie. Tome T^.
comme uniquement compofés d’hydrogène & de
nirrogène ou d'azote. M. Davy, après un nombre
d’expériences compliquées, dans lefquelles il a
été aidé par MM. Pepys & Allen, établit que
l ’oxigène entre auflï comme ingrédient dans la
conftitution de l’ammoniaque, tz que cent grains
de cette dernière fubftance paroiflent contenir
vingt grains d’oxigène, mais ce réfultat dépendoit
trop dés calculs eudiométriques pour qu’on put
le confidérer comme un fait établi.
• « La huitième & dernière feélion renferme des
obfervations fur la férié de faits nouveaux découverts
par l’auteur : il y donne les détails de quelques
expériences fur les acides muriatique & fluo-
rique, qui tendent toutes à établir que l’oxigène
eft l'un des principes conftituans de ces acides 5 il
a aufli examiné la baryte 8z la ftrontiane , comme
plus rapprochées des alcalis que d’aütres fubftances
, 8z l’une 8z l’autre ont donné des quantités
cohfidérâbles d’oxigène ; il conclut en remarquant
qu’ il y auroit de l’impropriété à vouloir appliquer
exclufivement le mot oxigène à la formation d'une
fubftance dont le caractère fpécifique feroit op-
pofé à celui de l'alcali, il ajoute que les nouveaux
faits qu’il a découverts forcent à modifier la nomenclature
chimique , & à confidérer l’ influence
de cette bafe, qu'on pourroit appeler métallaire,
fur les autres corps ; enfin, il fignale l’importance
& l’étendue du champ nouveau que ces faits ouvrent
à la géologie, & qui peut conduire à de
nombreufes découvertes , relatives à la formation
des diverfes matières pierreufes, des couches &
des montagnes du Globe. ■»
Dans la féance de la première claffe de l ’Inflitut
national du 7 mars, remarquable par les intéref-
fahtes communications dont elle a été remplie,
nous avons entendu la notice fuivante de la bouche
de M. Gay-Luffac, l’un des deux favans &
heureux coopërateurs d’une expérience mémo-
\rable.’
Décompofition de la potajfe-& de la foude par la voie
• sèche ordinaire.
MM. Thénard & Gay-Lu.ffac font parvenus à
décompofer la potajfe Sz la foude par des moyens
chimiques fans le fecours de la pile de Volta.
En traitant de la potajfe avec du charbon à une
haute température dans le laboratoire de l’Ecole
polytechnique, ils ont obtenu une maffe noire
qui s’enflamme auftitôt qu’elle a le contaét de l'air ,
à la manière du pyrophore, & qui s’allume plus
fûrement encore & plus facilement lorfqu’elle a
le contaft de l’eau. Ils ont d’abord regardé cette
combinaifon comme pouvant être un carbure de
potajfe ou un carbure du métal que cet alcali renferme
5 mais l’expérience fuivante, par laquelle
ils ont obtenu les métaux de la potajfe & de la
foude parfaitement ilolés, ne leur a laiffé aucun
doute à cet égard. T 1 1 1