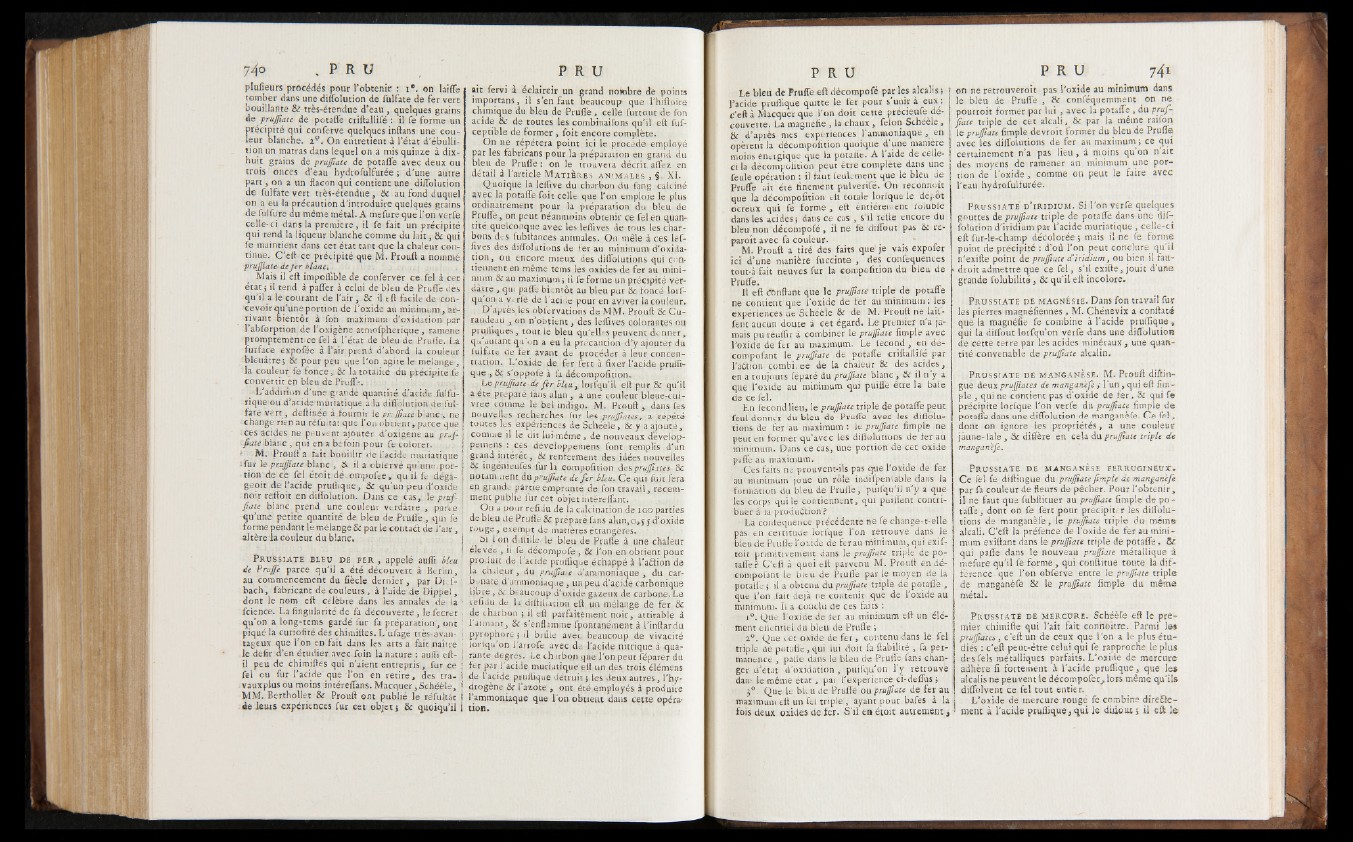
plufieurs procédés pour l’obtenir : i*. on laifle
tomber dans une diflblution de fulfate de fer vert
bouillante & très-étendue d’eau , quelques grains
de prujfiate de potaffe criftallifé : il fe forme un
précipité qui conferve quelques inftans une couleur
blanche. 2e. On entretient-à l’état d’ébullition
un matras dans lequel on a mis quinze à dix-
huit grains de prujfiate de potaffe avec deux ou
trois onces d’eau hydrofulfuréè ; d'une autre
part 3 on a un flacon qui contient une diflblution
de fulfate vert très-étendue , & au fond duquel
on a eu la précaution d'introduire quelques grains
de fulfure du même métal. A mefure que l'on verfe
celle-ci dans là première, il fe fait un précipité
qui rend la liqueur blanche comme du lait, & qui
fe maintient dans cet état tant que la chaleur continue.
C ’eft ce précipité que M. Prouft a nommé
prujfiate* def er blanc^
Mais il eft impolfible de conferver ce fel à cet
état ; il tend à paffer à celui de bleu de Prude dès
qu'il a le courant de l’air, & il eft facile de ^concevoir
qu’une portion de l ’oxide au minimum ^ arrivant
bientôt à fon maximum d’oxidation par
l’abforption de l’oxigène atmofpherique, ramene
promptemèntice fel à l’état de bleu de Prude. La
furface expôfée à l’air prend d’abord la couleur
bleuâtre; & pour peu que l’on agite le mélange, [
la couleur fe f o n c e & la totalité du précipite fe
convertit en bleu de Pruffe.
•L’addition d'une grande quantité d’acide.fulfu-
rique ou d’ acide muriatique à la diflblution de.fulfate
vert, deftiiîëe à,fournir le pr:Jÿ-, ue b'iwc-y ne I
change rien au réfuitar que l’on obtient, parce que
• ces acides ne peuvent ajouter d’oxigène.au pruf- ]
fiatèblanc , qui en a befoin pour fe colorer. [
r M. -Prouft a fait bouillir de l’acide muriatique
ffur le pnujfiate blanc , & il a obfervé qu'une.,por- I
tion de ce fel étoit dé^ompofee, qu il fe dégà- 1
geoit de l’acide pruflîque, & qu’un peu d’ oxide
noir reffoit en dilfolution. Dans .ce cas, le pruf- \
fiate blanc prend une couleur verdâtre , parce î
qu’une petite quantité de bleu de.Prufle,, qui fe f
forme pendant le mélange & par le contad de l’air,
altère la couleur du blanc. I!
P r u s s i a t e b l e u d e f e r , appelé aufli bleu'
de Prujfe parce qu’il a été découvert à Berlin,
au commencement du fiècle dernier , par Dicf- 1
bach, fabricant de couleurs, à l’aide de Dippel,
dont le nom eft célèbre dans les annales de la •
fcience. La Angularité de fa découverte , le fecret •
qu’on a long-rems gardé fur fa préparation1, ont •
piqué la curiofité des chimiftes. L'ufage très-avan- I
tageux que l’on en fait dans les arts a fait naître :
le defir d’en étudier avec foin la nature : auflî eft-
il peu de chimiftés qui n’aient entrepris., fur .c.e
fel ou fur l’acide que l’on en retire, des tra- i
vaux plus ou moins intéreffans. Macquer, Schéèle, I
MM. Berthollet & Prouft ont publié le réfulitâc {
de leurs expériences fur cet objet > & quoiqu’il !
ait fervi à éclaircir un grand nombre de points
importans, il s’en faut beaucoup que l’hiftoire
chimique du bleu de Prufle, celle furtout de fon
acide & de toutes les combinaifons qu’il eft luf-
ceptible de former, foit encore complète.
On ne répétera point ici le procédé employé
par les fabricans pour la préparation en grand du
bleu de Pruffe : on le trouvera décrit affez en
détail à l ’article Matières animales , §. XI.
Quoique la lelfive du charbon du fang calciné
avec la potaffe foit celle que l’on tmploie le plus
ordinairement pour la préparation du bleu de
P/nffe, on peut néanmoins obtenir ce fel en quantité
quelconque avec les leflivés de tous les charbons
des fubftances animales. On mêle à ces lef-
ftves des diflfolutions de fer au minimum d’oxidation
, ou encore mieux des diffolutions qui contiennent
en même tems les oxides de fer au minimum
& au maximum; il fe forme un précipité verdâtre
, qui paffe bientôt au bleu pur & foncé lorf-
qu on a verlé de l'acine pour en aviver la couleur.
I O après,lesoblervations de MM. Prouft & Cu-
rau.deait , on n’obtient, des leflives colorantes ou
pruiliques, tout le bleu qu'elles peuvent donner,
qu autant qu on a eu la précaution d’y ajouter du
fulfate de fer avant de procéder à leur concentration.
L’oxide de, fer fert à fixer l’acide pruflk-
que , &: s’pppofe à fa décompofition..
Le prujfiate d.e fer Heu>. lorfqu’il eft pur & qu’il
a été préparé fàns alun , a une couleur bleue-cui-
vrée comme le bel indigo. M. Prouft, dans Ces
nouvelles recherches fur les prujjîates, a répété
toutes les expériences de Schéèle, &c y a ajouté,
comme il le dit lui-même, de nouveaux develop-
pemens : ces développemens font remplis , d’un
grand intérêt, & renferment des idées nouvelles
Ôç ingénieufes fur la çompofition des prujfiat.es &
notamment dix prujfiate de fer bleu. Ce qui fuit fera
en grande partie emprunté; de fon travail, récent
ment publie fur cet objet intéreffant.
On a pour réfîdu de la calcination de ioo parties
de bleu de Prufîe & préparé fans alun, 0,5 5 d’oxide
rouge , exempt de matières étrangères*
Si 1 on diftiile le bleu de Pruffe à une chaleur
élevée , il fe décompofe, & l’on en obtient pout
produit de l'acide pruflîque échappé à l’aêtion de
la chaleur, du prujfiaie a’ammoniaque , du carbonate
d’ammoniaque, un peu d'acide carbonique
libre, & beaucoup d’oxide gazeux de carbone. Le
refidu de la diftihation eft un mélange de fer &
de charbon ; il eft parfaitement noir, attirable à
l'aimant, & s’enflammé fpontanément à l’inftardu
pyrophore ; il brûle avec beaucoup de vivacité
loriqu on 1 ârrofe avec de l’acide nitrique à quarante
degres. Le chirbo» que l ’on peut féparer du
fer par l'acide muriatique eft un des trois élémens
de l’acide pruflîque détruit ; les deux autres, l’hydrogène
& l’azote , ont été employés à produire
l’ammoniaque que l'on obtient dans cette opération
»
Le bleu de Pruffe eft décompofé par les alcalis; ;
l’acide pruflîque quitte le fer pour s unir a eux :
c’eft à Macquer que l’on doit cette précieufe découverte.
La magnéfie, la chaux, félon Schéèle,
& d’après mes expériences l’ammoniaqu-e, en
opèrent la décompofition quoique d’une manière
moins énergique que la potafïe. A 1 aide de celle-
ci la décompofition peut être complète dans une
feule opération : il faut feulement que le bleu de
Pruffe ait été finement pulvérifé. On reconne/it
que la décompofition elt totale torique le dépôt
ocreux qui fe forme , eft èntiérement /oiubie
dans les acides ; dans ce cas , s’il relie encore du
bleu non décompofé, il ne fe diffout pas & re-
paroît avec fa couleur.
M. Prouft a tiré des faits que je vais expofer
ici d’une manière fuccinte , des confequences
tout-à fait neuves fur la çompofition du bleu de
Pruffe*
Il eft Cbnftant que le prujfiate triple de potafle
ne contient que l’oxide de fer au minimum : les
expériences de Schéèle & de M. Prouft ne laif-
fent aucun doute à cet égard. Le premier n a jamais
pu réuflîr à combiner le prujfiate fimple avec
l’oxide de fer au maximum. Le fécond, en dé-
compofant ie prujfiate de potafle criftallifé par
l’aétion combinée de la chaleur & des acides,
en a toujours féparé du prujfiate blanc , & il n'y a
que l’oxide au minimum qui puiffe être la bafe
de ce fel.
En fécond lieu, le prujfiate triple de potafle peut
feul donner du bleu de Pruffe avec les diflolu-
tions de fer au maximum: ie prujfiate fimple ne
peut en former qu’avec les diffolutions de fer au
minimum. Dans ce cas, une portion de cet oxide
paffe au maximum.
Ces faits ne prouvent-ils pas que l’oxide de fer
au minimum joue un rôle indifpeniable dans la
formation du bleu de Prufle, puifqü’il n’y a que
les corps qui le contiennent, qui puiffent contribuer
à la prod uction ?
La coniéquence précédente ne fe change-t-elle
pas en certitude lorfque l’on retrouve dans le
bleu de Prufle l’oxide de fer au minimum, qui exif-
toit primitivement dans 1 e prujfiate triple de potaffe?
C ’eft à quoi eft parvenu M. Prouft en déco
mp© fan t le bieu de Pruffe par le moyen de la
potaffe ; il a obtenu du prujfiate triple de potafle ,
que l’on fait déjà ne contenir que de l’oxide au
minimum. Il a conclu de ces faits :
i°. Que l'oxide de ter au minimum eft un élément
efientiel du bleu de Prufle ;
20. Que cet oxide de fe r , contenu dans lé fel
triple de potafle, qui lui doit fa fiabilité , fa permanence
, pâlie dans le bleu de Pruffe fans changer
d’éta.t d'oxidation , puifqu on l’y retrouve
dam le même état, par l’expérience ci- deffüs ;
50. Que le bku de Pruffe ou prujfiate de fer au
maximum eft un fel triple , ayant pour bafes à la
fois deux oxides de fer. S’il e» étoit autrement^
on ne retrouveront pas l'oxide au minimum dans
le bleu de Pr.uffe , & conféquemment on ne
pourroit former par lui , avec la potaffe , du pruf-
fiate triple de cet alcali, & par la même raifon
le prujfiate fimple devroit former du bleu de Pruffe
avec les diffolutions de fer au maximum ; ce qui
certainement n’a pas lieu, à moins qu’on n’ait
des moyens de ramener au minimum une portion
de l ’oxide, comme on peut le faire avec
l’eau hydrofulfuréè.
P r u s s i a t e " d ’ i r i d i u m . Si l’on verfe quelques
gouttes de prujfiate triple de potaffe dans une dif-
folution d’iridium par l’acide muriatique, celle-ci
eft fur-le-champ décolorée ; mais il ne fe forme
point de précipité : d'où l’on peut conclure qu’il
n’exifte point de prujfiate d’iridium, ou bien il fau-
* droit admettre que ce fe l, s’ il exifte, jouit d’une
grande folubilité, & qu’il eft incolore.
P r u s s i a t e d e m a g n é s i e . Dans fon travail fur
les pierres magnéfiennes, M. Chénevix a conftaté
que la magnéfie fe combine à l’acide pruflîque,
qui la diffout lorfqu’on verfe dans une aiffolutiora
de cette terre par les acides minéraux , une quantité
convenable de prujfiate alcalin.
P r u s s i a t e d e m a n g a n è s e . M. Prouft diftin-
gue deux prujjîates de manganefe y l'un , qui eft fimple
, qui ne contient pas d’oxide de fer, & qui fe
précipite lorfque l’on verfe du prujfiate fimple de
potaffe dans une diflblution de manganèfe. Ce fel,
dont on ignore les propriétés, a une couleur
jaune-fale , & diffère en cela du prujfiate triple de.
manganefe.
P r u s s i a t e d e m a n g a n è s e f e r r u g in e u x '»
Ce fel fe diftingue du prujfiate fimple de manganefe
par fa couleur de fleurs de pêcher. Pour l’obtenir,
il ne faut que fubftituer au prujfiate fimple de potaffe,
dont on fe fert pour précipiter les diffolutions
de manganèfe, le prujfiate triple du même
alcali. C’eft la préfenee de l'oxide de fer au minimum
exiftant dans le prujfiate triple de potaffe, &
qui paffe dans le nouveau prujfiate métallique à
mefure qu’il fe fqrme, qui conftitue toute la différence
que l’on obferve entre le prujfiate triple
de manganèfe & le prujfiate fimple du même
métal.
P r u s s i a t e d e m e r c u r e . 5chéèFe eft le premier
chimifte qui l’ait fait connoî.tre. Parmi les
prujjîates, c ’eft un de ceux que l’on a le plus étudiés
: c’eft peut-être celui qui fe rapproche le plus
des fels métalliques parfaits. L’oxide de mercure
adhère fi fortement à l’acide pruflîque, que le*
alcalis ne peuvent le décompofétp. lors même qu’il*
diffolvent ce fel tout entier.
L’ oxide de mercure rouge fe combine dire&e-
ment à l’acide pruflîque, qui le diffout > il eft: le