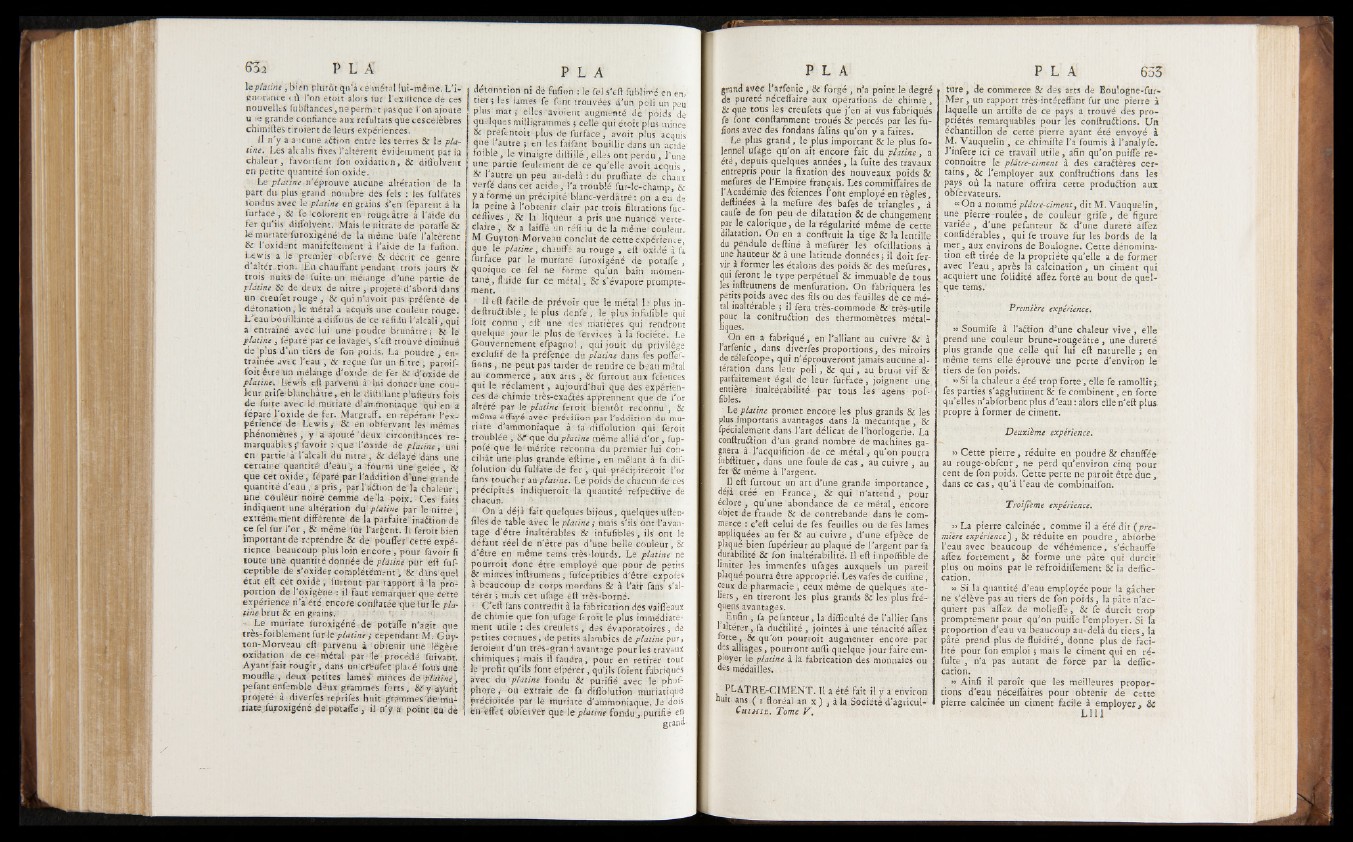
1 '&platine , bien plutôt qu'à ceHnétal lui-même. L’ignorance
( ù l’on etoit alors fur l ’exiftence dé ces
nouvelles fubftànces, ne permet pas que l'on ajoute
u ie grande confiance aux refui tats que ces célébrés
chimi’ftes tiroientde leurs expériences.
Il n'y a aucune aétion entre lès terres Sc le platine.
L e s alcalis fixes l'altèrent évidemment par la
chaleur, favorifem fon oxidaricn, & diflolvent 1
en petite quantité fon oxide.
Le platine n'éprouve aucune altération de la
part du plus-grand nombre des fels : les fulfates
fondus avec le platine en grains s'en réparent à la
furface, 8c fe colorent en roiigtâtre à l'aide du
fer qu'ils dilfolyent. Mais le nitrate de potafle &
le muriate furoxigéné'de la même bafe l'altèrent
& l'oxident manifeftement à l'aide de la fufion.
Lewis a le premier obfèrvé & décrit ce genre
d’altér-tion. En chauffant pendant trois jours 8c
trois nuits-de fuite< un. mélange d'une partie de
platine & de deux de nitre , projeté d'abord dans
un creufet rouge , & qui n'avoit pas préféntë de
détonation, le métal a acquis une couleur rdugè.
L'eau bouillante a diflous de ce réfidu l'alcali, qui
a entraîné avec lui une poudre brunâtre ; & lé
platine, féparé par ce lavage", s'ëft trouvé diminué
de plus d'un tiers de fon poids. La poudre , entraînée
avec l'eau , & reçue fur un fi'.tre > paroif-
foitêtream mélange d'oxide de fer & d^o-xide de
platine, Lewis eft parvenu à fui donner "une couleur
grifé*blanchâtre, eh lé diftiîlant plufiéùrs fois
de fuite ave-c lé muriate d?a&r.fr©niaquô '.quL-en* a
féparé l'oxide de fer. Margraff, en répétant l'expérience
de Lewis, 8c en obfervant lès mêmes
phénomènes, y a ajouté deux circonftanees re- ,
marquablsTS y favoir : que l'oxide de platine t uni
en partie à l’alcali du nitre, 8c délayé dans uné
certaine quantité' d-eau, a fourni une gelée &
que cet oxide, féparé par l'addition XL-une grande
quantité d'eau , a pris, par l'abtion de*la chaleur*
une cdulèur noire comme delà ppix. Ces faiti
indiquent une altération du! platine j>ar le-ni tre ,
extrêmement différente dé la parfaite inaélion de
ce fel fur l'o r , & même fur l’argent. Il féroit bien
important de reprendre 8c de pôuffer'xette expérience
beaucoup plus loin encore, pour favoir fi
foute une quantité donnée dé platine pur eft fuf-
ceptible de s'oxider complètement 5, & dans quel
état eft cet oxidè, fiïrtout par rapport à la proportion
de l’oxigène : il Faut remarquer que Cette
expérience n'â-été encore confiatéëqbë furie platine
brut & en grains.'
Le muriate furoxigéné de potafle n'agit que
très-foiblement fur le platine ; cependant M; Guy-
ton-Morveau eft parvenu à obtenir une légère
oxidation de ce- métal par le procédé füivaht.
Ayant'.fait rougir, dans uncféufet placé fous uné
mouffle, deux petites lamés" riVinces de plktinè^
pefant enfemble deux grammes forts, &;y-ayant
projeté à diverfes reprifes huit grarnmes'de triii1
riatejfuroxigéné .ds phtafte , il n'y a point êu de
détonation ni dé fufion : le fel s'eft fubli^é en en-
tier ; les lamés fe font trouvées d'un poli un peu
plus mat ; elles avbient augmenté de poids de
quelques milligramme^ ; celle qui étoic plus mince
& préfentoit plus de furface, avoit plus acquis
que l'autre ; en les faifant bouillir dans un acide
foible, le vinaigre diftilié,elles ont perdu, H H
une partie feulement de ce qu'elle avoit acquis,
& 1 autre un peu au-delà : du pruflîate de chaux
verfé dans cet acide, l'a troublé fur-le-champ, &
y a formé un précipité blanc-verdâtre : on a eu de
la peine à l'obtenir clair par trois filtrations fuc-
cefiives, 8c la liqueur a pris une nuancé verte-
claire, & a Iai£ïe un réfi iu de la même couleur.
M Guyton-Morveau conclut de cette expérience,
que le platine, chauffé au rouge , eft oxi de à fa
furface par le muriate furoxigéné de potaffe ,
quoique ce fel ne forme qu'un bain momen-
tanét> fluide fur ce métal, 8c s'évapore prompte-
: ment.
11 eft facile de prévoir que le métal L plus in-
deftruéliblè, le plus denfe, le plus infulîble qui
l foit connu , ‘ eft une des matières qui rendront
: quelqué jour le plus de fervices à là fociété. Le
; Gouvernement efpagnol , qui jouit du privilège
exclufif de la préfence du platine dans fes poflef-
fions, ne peut pas taider de rendre ce beau métal
auxommercé, aux arts , 8c furtout aux fciences
qui le réclament, aujourd'hui que des expérien-
i ces de chimie très-exaéfés apprennent que de l'or
; altéré par le platine feroit bientôt reconnu , &
même effayé avec précifion par l'addition du mu-
riite d'ammoniaque à •fa’ rliftblution qui feroit
troublée , 8C* que du platine même allié d'or, fup-
pofé que le mérite reconnu du premier lui conciliât
une plus grande eftime, en mêlant à fa dif-
folutibn* du fùlfàteide fe r , qui précipireroit l’or
fans toucher auplatine. Le poids de chacun de‘ces
précipités indiqberoit la quantité refpebtive de
chacun.
©n a déjà fait quelques bijous, quelques uften-
filesde table avec le platine; mais s'ils ont l’avantage
d'être inaltérables 8c infufibles, ils ont le
défaut réel de n'être pas d’une belle couleur j &
d'être en même tems très-lourds. Le platine ne
pourroit donc être employé que pour de petits
& minces'inftrumens ; fufeeptibies d'être expofes
à beaucoup de corps mordans 8c à l'air fans s’altérer
> mais cet ufage èft très-borné.
I C'eft fans contredit à la fabrication des vaiflfeaux
dé chimie que fon ufage ftrôît le plus immédiatement
utile : des creufers j des évaporatoires, de
petites cornues, de petits alambics de platine pur,
feroient d'un très-gran 1 avantage pour les travaux
chimiques ; mais il faudra, pour en retirer touc
Je profit qu'ils font efpérer, qu’ils foient fabriqués
avec du plâtine fondu & purifié avec le phof-
phore i ou extrait de fa diflblution muriatiqu®
précipitée par le muriate d'ammoniaque. Je dois
ën effet obfeiver que le platine fondu,,-purifié en
grand avec l’arfenic , & forgé, n*a point le degré
de pureté nécelfaire aux opérations de chimie,
& que tous les creufets que j'en ai vus fabriqués
fe font conftamment troués & percés par les fu-
flons avec des fondans falins qu'on y a faites.
Le plus grand, le plus important & le plus fo-
lennel ufage qu'on ait encore fait du platine, a
été, depuis quelques années, la fuite des travaux
entrepris pour la fixation des nouveaux poids &
mefures de l'Empire français. Les commiffaires de
l’Academie des feiences l'ont employé en règles,
deftinées à la mefure des bafes de triangles, à
caufe de fon peu de dilatation & de changement
par le calorique, de la régularité même de cette
dilatation. On en a conftruit la tige & la lentille
du pendule deftiné à mefürer les ofcillations à
une hauteur & à une latitude données; il doit fer-
vir à former les étalons des poids & des mefures,
qui feront le type perpétuel & immuable de tous
les inftrumens de mensuration. On fabriquera lés
petits poids avec des fils ou des feuilles de ce métal
inaltérable ; il fera très-commode & très-utile
pour la conftruélion des thermomètres métalliques.
; On en a fabriqué -, en l'alliant au cuivre & à
l'arfenic, dans diverfes proportions, des miroirs
de télefeope, qui n'éprpuveront jamais aucune altération
dans leur poli, & qui, au bruni vif &
parfaitement égal de leur furface, joignent une.
entière inaltérabilité par tous les agens pof-
lîbles.
Lz platine promet encore les plus grands & les
plus importans avantages dans la mécanique, &
fpécialement dans l ’art délicat de l’horlogerie. La
cônftruélion d’un grand nombre de machines gagnera
à l’acquifition de ce métal,- qu'on pourra
fubftituer, dans une foule de cas, au cuivre , au
fer 6c même à l’argent.
Il eft furtout un art d’une grande importance,
déjà créé en France, & qui n’attend, pour
éclore , qu'une abondance de ce métal, encore
objet de fraude & de contrebande dans le commerce
: c'eft celui de fes feuilles ou de fés lames
appliquées au fer & au cuivre, d'une efpèce de
plaqué bien fupérieur au plaqué de l'argent par fa
durabilité & fon inaltérabilité. Il eft impoflible de
limiter les immenfes ufages auxquels un pareil
plaqué pourra être approprié. Les vafes de cuifine,
ceux de pharmacie , ceux même de quelques ateliers,
en tireront les plus grands & les plus fré-
quens avantages.
Enfin , fa pefanteur, la difficulté de l’allier fans
1 altérer, fa duétilité, jointes à une ténacité aflez
forte, & qu'on pourroit augmenter encore par
des alliages, pourront aufti quelque jour faire employer
le platine à là fabrication des monnaies ou
des médailles.
, PLATRE-CIMENT. Il a été fait il y a'environ
huit ans ( i floréal an x ) * à là Société d’agticul-
Chimie. Tome V.
ture, de commerce 8c des arts de Boulogne-fur-
Mer , un rapport très-intéreflant fur une pierre i
laquelle un artifte de ce pays a trouvé des propriétés
remarquables pour les conftruélions. Un
échantillon de cette pierre ayant été envoyé à
M. Vauquelin, ce chimifte l’a fournis à l’anaJyfe.
J'infère ici ce travail utile, afin qu'on puifle re-
connoitre le plâtre-ciment à des caractères certains,
8c l'employer aux çonftruétions dans les
pays où la nature offrira cette production aux
obfervateurs.
«On a nommé plâtre-ciment, dit M. Vauquelin,
une pierre-roulée, de couleur grife, de figure
variée , d’une pefanteur & d'une dureté aflez
confîdërables, qui fe trouve fur les bords de la
mer, aux environs de Boulogne. Cette dénomination
eft tirée de la propriété qu'elle a de former
avec l'eau, après la calcination, un ciment qui
acquiert une folidité aflez forte au bout de quelque
tems.
Première expérience.
Soumife à l’aCtion d’une chaleur vive , elle
prend une couleur brune-rougeâtre, une dureté
plus grande que celle qui lui eft naturelle j en
même tems elle éprouve une perte d'environ le
tiers de fon poids.
»Si la chaleur a été trop forte, elle fe ramollit;,
fes parties s'agglutinent 8c fe combinent, en forte
qu'elles n’abforbent plus d'eau : alors elle n’eft plus
propre à former de ciment.
Deuxième expérience.
» Cette pierre, réduite en poudre 8c chauffée
au rouge-obfcur, ne perd qu’environ cinq pour
cent de fon poids. Cette perte ne paroît être due ,
dans ce cas, qu'à l’eau de combinaifon.
Troifième expérience.
» La pierre calcinée, comme il a été dit (première
expérience} , 8c réduite en poudre, abiorbe
l’eau avec beaucoup de véhémence, s’échauffe
aflez fortement, 8c forme une pâte qui durcit
plus ou moins par le refroidiffement 8c la deflic-
cation.
» Si la quantité d’eau employée pour la gâcher
ne s'élève pas au tiers de fon poids, la pâte n’acquiert
pas aflez de moliefle, 8c fe durcit trop
promptement pour qu'on puifle l'employer. Si la
proportion d’eau va beaucoup au-delà du tiers, la
pâte prend plus de fluidité, donne plus de facilité
pour fon emploi ; mais le ciment qui en ré-
fulte , n'a pas autant de force par la deflîc-
cation.
_ » Ainfi il paroît que les meilleures proportions
d’eau nécëflaires pour obtenir de cette
pierre calcinée un ciment facile à employer* &
L U I