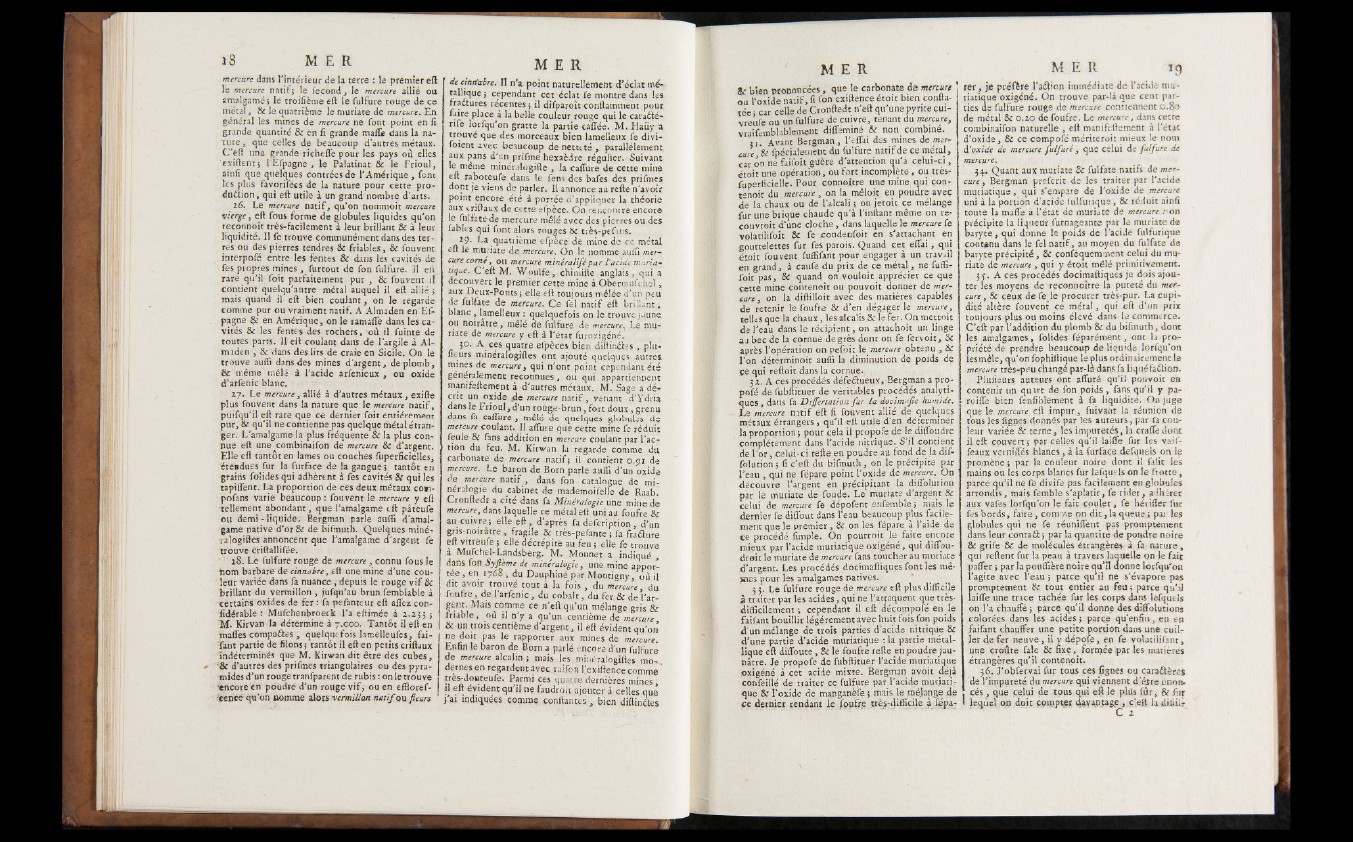
mercure dans l'intérieur de la terre : le premier eft
le mercure natif; le fécond, le mercure allié ou
amalgamé) le troifième eft le fulfure rouge de ce
métal, & le quatrième le murîare de mercure. En
général les mines de mercure ne font point en fi
grande quantité & en fi grande maffe dans la nature
, que celles de beaucoup d'autres métaux.
C'eft une grande richeffe pour les pays où elles
exiftent; l'Efpagne * le Palatinat & le Frioul,
ainlï que quelques contrées de l'Amérique , font
les plus favorifées de la nature pour cette production,
qui eft utile à un grand nombre d'arts.
16. Le mercure natif, qu’on nommoit mercure
•vierge , eft fous forme de globules liquides qu'on
reconnoît très-facilement à leur brillant & à leur
liquidités II fe trouve communément dans des terres
ou des pierres tendres & friables, & fou vent
interpofé entre les fentes & dans les cavités de
fes propres mines , furtout de fon fulfure. Il eft
rare qu'il foit parfaitement pur , & fouvent i f
contient quelqu'autre métal auquel il eft allié ;
mais quand il eft bien coulant, on le regarde
comme pur ou vraiment natif. A Almaden en Ef--
pagne en Amérique, on le ramaffe dans les cavités
& les fentes des rochers, où il fuinte de
toutes parts. 11 eft coulant daifr de l'argile à Al- i
maden , & dans des lits de craie en Sicile. On le
trouve auffi dans des mines d'argent, de plomb,
& même mêlé à l'acide arfenieux , ou oxide
d’arfenic blanc.
27. Le mercure, allié à d’autres métaux, exifte
plus fouvent dans la nature que le mercure natif,
puifqu'il eft rare que ce dernier foit entièrement
pur, & qu'il ne contienne pas quelque métal étranger.
L’amalgame la plus fréquente & la plus connue
eft une combinaifon de mercure & d'argent.
Elle eft tantôt en lames ou couches fuperficielles,
étendues fur la furface de la gangue ; tantôt en
grains foîides qui adhèrent à fes cavités qui les
tapiffent. La proportion de ces deux métaux co*i-
pofans varie beaucoup: fouvent le mercure y eft
tellement abondant, que l'amalgame eft pâteufe
ou demi-liquide. Bergman parle auffi d’amalgame
native d'or& de bifmuth. Quelques miné-
ralogiftes annoncent que l'amalgame d'argent fe
trouve criftallifée.
28. Le fulfure rouge de mercure, connu fous le
nom barbare de cinnabre,eft une mine d'une couleur
variée dans fa nuance, depuis le rouge vif &
brillant du vermillon, jufqu’au brun femblable à
certains oxides de fer : fa pefanteur eft affez con-
iidérable : Mufchenbroeck l'a eftimée à 2,233 5
M- Kirvan la détermine à 7.000. Tantôt il eft en
maffes compactes, quelquefois lamelleufes, fai-
■ Rjnt partie de filons* tantôt il eft en petits criftaux
indéterminés que M. Kirvran dit être des cubes,
'& d’ autres des prifmes triangulaires ou des pyramides
d’un rouge tranfparent de rubis : on le trouve
Encore en poudre d'un rouge v if, ou en effloref-
Jcence qu'on nomme alors •vermillon natif ou fleurs
de ctiin'àbre. Il n'a point naturellement d'éclat métallique
5 cependant cet éclat fe montre dans les
fraCtures récentes 5 il difparoît conftammentpour
faire place à la belle couleur rouge qui le carad^é-
rife lorfqu'on gratte la partie caffée. M. Haüy^a
trouvé que des morceaux bien lamelieux fe divi-
foient avec beaucoup de netteté , parallèlement
aux pans d'un prifmé hexaèdre régulier. Suivant
am^me m^n®ra^°8*^e i la caffure de cette mine
eft raboteufe dans le fens des bafes des prifmes
dont je viens de parler. Il annonce au refte n'avoir
point encore été à portée d’appliquer la théorie
aux criftaux de cette efpèce. On rencontre encore
le fui fa te-de mercure mêlé avec des pierres ou des
fables qui font alors rouges & très-pefuis.
29. La quatrième efpèce de mine de ce métal
eft le muriate de mercure. On le nomme auffi mer-
cure corne, ou mercure minéralifé par l'acide maria-
tique. C'eft Al. Woulfe, chimifte anglais, qui a
découvert le premier cette mine à Obermufcnel,
aux Deux-Ponts 5 elle eft toujours mêlée d’un peu
de fulfate de mercure. Ce fel natif eft brillant *,
blanc , lameüeux : quelquefois on le trouve jaune
ou noirâtre, mêlé de fulfure de mercure^ Le mu-
riate de mercure y eft à l'état furoxigéné.
30. A ces quatre efpèees bien diftinéies , plu-
lîeurs minéralogiftes ont ajouté quelques aurrei
mines de mercure, qui n'ont point cependant été
généralement reconnues, ou qui appartiennent
manifeftement à d'autres métaux. M. Sage a décrit
un oxide de mercure natif, venant d’Ydria
dans le Frioul, d’un roûge-brun, fort doux, grenu
dans fa caffure, mêlé de quelques globules dp
mercure coulant. Il affure que cette mine fe réduit
feule & fans addition en mercure coulant par l'action
du feu. M. Kirwan la regarde comme du
carbonate de mercure natif j il contient 0.91 de
mercure. Le baron de Born parle aaffi d'un oxide
de mercure natif, dans fon catalogue de minéralogie
du cabinet de mademoifelle de Raab.
Cronftedt a cite dans fa Minéralogie une mine de
mercure, dans laquelle ce métal eft uni au foufre &
au cuivre; elle eft, d’après fa defeription, d’un
gris-noirâtre, fragile & très-pefante; fa frafture
eft vitreufe 5 elle décrépite au feu ; elle fe trouve
à Mufchel-Landsberg. M. Monnet a indiqué ,
dans fon Syftéme de minéralogie, une mine apportée,
en 1768, du Dauphiné par Montigny, où il
dit avoir trouvé tout à la fois , du mercure, du
foufre, de l'arfenic, du cobalt, du fer & de l’argent.
Mais comme ce n'eft qu'un mélange gris &
friable, où il n'y a qu’un centième de mercure
& un trois centième d'argent, il eft évident qu’on
ne doit pas le rapporter aux mines de mercure.
Enfin le baron de Born a parlé encore d'un fulfure
de mercure alcalin 5 mais^ les minéralogiftes modernes
en regardent avec raifon l.’exiftence comme
très-douteufe. Parmi ces quatre dernières mines,
jj eft évident qu’il ne faudroit ajouter à celles que
j ai indiquées comme confiantes , bien diftinctes
Sc bien prononcées, que le carbonate de mercure
ou l’oxide natif, fi fon exiftence étoit bien confta-
*ée ; car celle de Cronftedt n’eft qu'une pyrite cui-
vreufe ou un fulfure de cuivre, tenant du mercure,
vraisemblablement difféminé & non combiné.
2i. Avant Bergman, l’effai des mines de mercure
fpécialement du fulfure natif de ce métal,
car on ne faifoit guère d'attention qu’à celui-ci,
étoit une opération, ou fort incomplète, ou très-
fuperficielle. Pour connoître une mine qui contenoit
du mercure, on la mêloit en poudre avec
de la chaux ou de l’alcali 5 on jetoit ce mélange
fur une briqué chaude qu’à l'inftant même on re-
couvroit d'une cloche, dans laquelle le mercure fe
volatilifoit & fe condenfoit en s'attachant en
gouttelettes fur fes parois. Quand cet effai, qui
étoit fouvent fuffifant pour engager à un travail
en grand, à caufe du prix de ce métal, ne fuffi-
foic pas, & quand on vouloir aporécier ce que
cette mine contenoit ou pouvoit donner de mercure,
on la diftilloit avec des matières capables
de retenir le foufre & d’en dégager le mercure,
telles que la chaux, les aicalis.& le fer. On mettoit
de l'eau dans le récipient, on attachoit un linge
a j bec de la cornue de grès dont on fe fetvoit, &
après l'opération on pefoit \e mercure obtenu , &
l ’on déterminoit aufli la diminution de poids de
ce qui reftoit dans la cornue.
32. A ces procédés défectueux, Bergman a pro-
pofé de lubftituer de véritables procédés analytiques,
dans fa Dijfertation fur la docimufle humide.
Le mercure natif eft fi fouvent allié de quelques
métaux étrangers, qu'il eft utile d’en déterminer
la proportion; pour cela il propofe de le diffoudre
complètement dan^ l'acide nitrique. S'il contient
de l'or, celui-ci refte en poudre au fond de la djf-
folution ; fi c'eft du bifmuth, on le précipite par
l’eau , qui ne fépare point l'oxide de mercure, On
découvre l'argent en précipitant la diffolution
par le muriate de fonde. Le muriate d'argent &
celui de mercure fe dépofent enfemble j mais le
dernier fe diflout dans l’eau beaucoup plus facilement
que le premier, & on les fépare a 1 aide de
ce procédé fimple. On pourroi.t le faire encore
mieux par l’acide muriatique oxigéné, qui diffou-
droit le muriate de mercure fans toucher au muriate 1
d’ argent. Les procédés docimaftiques font les mê-
pnes pour les amalgames natives.
33. Le fulfure rouge de mercure eft plus difficile
à traiter par les acides, qui ne l’attaquent que très-
difficilement ; cependant il eft qéçompofé en le
faifant bouillir légèrement avec huit foisfon poids
d'un mélange de trois parties d’acide nitrique &
d'une partie d’acide muriatique : la partie métallique
eft diffoute, & le foufre refte en poudre jaunâtre.
Je propofe de fubftituer l’acide muriatique
.oxigéné à cet acide mixte. Bergman avqit déjà
confeillé de traiter ce fulfure par l’acide muriatique
& l’oxide de ma.nganèfe; mais le mélange de
ce dernier tendant le joufre très-difficile a fépa:
rer, je préfère l'aéfcion immédiate de l'acide muriatique
oxigéné. On trouve par-là que cent parties
de fulfure rouge de mercure contiennent 0.80
de métal & 0.20 de foufre. Le mercure, dans cette
combinaifon naturelle , eft manifeftement à l’état
d'oxide, & ce compofé mériteroit mieux le nom
à’oxide de mercure Julfuré, que celui de fulfure de
mercure.
34. Quant aux muriate & fulfate natifs de mercure
, Bergman preferit de les traiter par l’acide
muriatique, qui s’empare de l’oxide de mercure
uni à la portion d’acide fulfurique, & réduit ainfi
toute la maffe à l'état de muriate de mercure r on
récipite la liqueur furnageante par le muriate de
aryce, qui donne le poids de l'acide fulfurique
contenu dans le fel natif, au moyen du fulfate de
baryte précipité, & çonféquemment celui du muriate
de mercure , qui y étoit mêlé primitivement.
3 y. A ces procédés docimaftiques je dois ajouter
les moyens de reconnoître la pureté du merr-
cure, & ceux de fe le procurer très-pur. La cupidité
altère fouvent ce métal, qui eft d’un prix
toujours plus ou moins élevé dans le commerce.
C'eft par l’ addition du plomb & du bifmuth, dont
| les amalgames, folides féparément, ont la pror
prjété de prendre beaucoup de liquide lorfqu’on
lesmêle, qu'on fophiftique le plus ordinairement le
mercure très-peu changé par-là dans fa liquéfa&ion.
Piufieurs auteurs ont affuré qu’il pouvoit en
contenir un quart de fon poids, fans qu'il y par
roHte bien fenfiblement à fa liquidité. On juge
que le mercure eft impur, fuivant la réunion de
tous les lignes donnés par les auteurs, par fa couleur
variée & terne, les impuretés, la craffe dont
ij eft couvert; par celles qu'il iaiffe fur les vaif-
feaux verniffés blancs, à la furface defquels on le
promène ; par la couleur noire dont il falit les
mains ou les corps blancs fur lefquEls on le frotte,
parce qu'il ne fe divife pas facilement en globules
arrondis, maïs femble s'aplatir, fe rider, adhérer
aux yafes lorfqu’on le fait couler, fe hérifter fur
fes bords, faire, convie on dit, la queue ; par les
globules qui ne fe réuniffent pas promptement
dans leur contaèt ; par la quantité dp poudre noire
& grife & de molécules étrangères à fa nature,
qui reftent fur la peau à travers laqijelle on le fait
paffer ; par la pouffière noire qu'il donne lorfqu'on
l'agite avec l’eau 5 parce qu'il ne s’évapore pas
promptement & tout entier ail feu ; parce qu'il
iaiffe une trace tachée fur les corps dans lefquels
on l’a chauffé ; parce qu'il donne des diffolutions
colorées dans les acides ; parce qu’enfin, ep en
faifant chauffer une petite portion dans une cuilr
1er de fer neuve, il y dépofe, en fe volatilifant,
.une croûte fale & fixp, formée ;par les matières
étrangères qu’ il contenoit.
36. J’obfervai fur tous ces fignes ou caractères
de l'iippureté du mercure qui viennent d’être énoncés
, que celui de tous qui eft le plüs fûr, & fur
i lequel on doit compter davantage , c'eft la difiii-
C 2