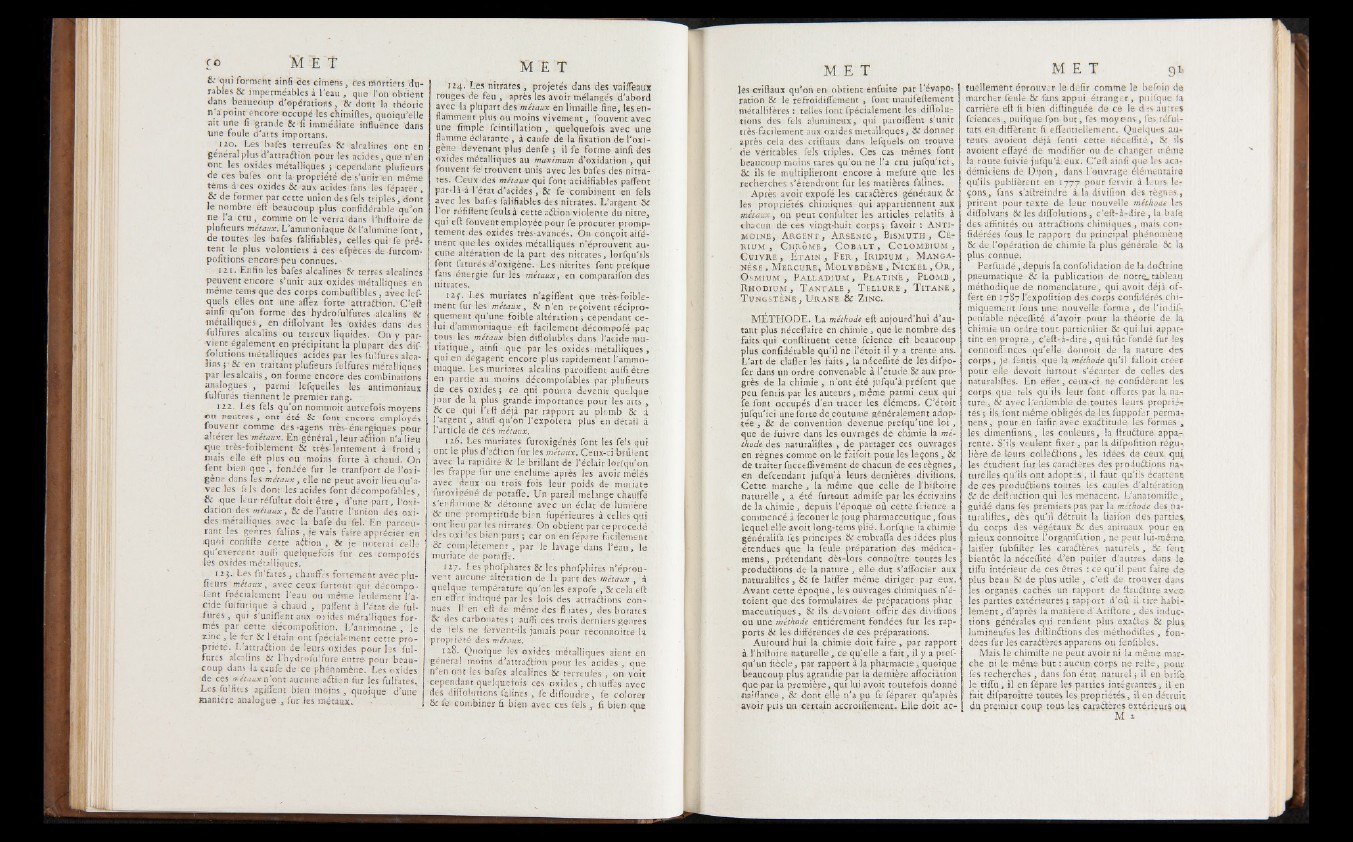
&• qui forment ainfi ces cimens, c'es mortiers durables
& imperméables à l’eau , que l’on obtient
dans beaucoup d'opérations, & dont la théorie
n’ a point èncore occupé les chimiftés, quoiqu'elle
ait une fi -grande & fi immédiate influence dans
une foule d'aits importans.
•120. Les bafes terreufes '& alcalines ont en
général plus d'attraCtion pour les acides, que n’en
ont les oxides métalliques } -cependant plufieurs
de ces bafes ont la- propriété de s'unir en même
tems à ces oxides & aux-acides fans les réparer ,
& de former par cette union des fels triples, dont
le nombre eft beaucoup plus confidérable qu'on
ne l'a cru, comme on le verra dans Thiftoire de
plufieurs 'métaux. L'ammoniaque & l'alumine font,
de toutes les bafes falifiablés, celles qui fe prêtent
le plus volontiers à cês: efpèees ae-furcom-
pofitior.s encore'peu connues. H
m . Enfin les bafes alcalines & terres alcalines
peuvent encore s'unir aux oxides métalliques ven
même tems que des corps combuftibles, avec lef-
quels elles ont une affez forte attraction. G'eft
ainfi'qu'on forme dès hydrofulfures ralcâlins &
métalliques, en diffolvant les oxides dans des.
fulfures alcalins ou terreux liquides. On y parvient
également en précipitant la plupart des dif-
folutions métalliques acides par les fulfures alcalins
}■ & ’en traitant plufieurs fulfures' métalliques
par les alcalis, on forme encore des combinaif ons i
analogues , parmi lefquelles les antimoniaux
fulfurés tiennent le premier rang.
122. Les fels qu’on nommoit autrefois moyens
ou neutres , ont été & font encore employés
fouvent comme des-agens très-énergiques pour
altérer les métaux. En général, leur aCtion n’a lieu
que trèsToiblement & très-lentement à froid ;
mais elle ëft plus ou moins forte à chaud. On
fient bien que > fondée fur le tranfport de l’oxi-
gène dans les métaux i elle ne peut avoir lieu qu’avec
les fils dont les acides font décompofables,
& que leur réfultat doit être, d’une part, liquidation
des métaux, & de l'autre l ’union des oxides
métalliques avec la bafe du fel.' En parcourant
les genres falins . je vais faire apprécier en
quoi confifte cette aCtion , & je noterai celle
qu’exercent au (fi quelquefois fur ces compoies
les oxides métalliques.
123. Les fu'fates , chauffes fortement avec pi 117
fieurs métaux, avec ceux furtotit qui déeompo-
fent fpécialement l’eau ou même feulement J'a-
cide fulfurique à chaud , paflent à l'état de fui-'
fLires, qui s’unifient aux oxides métalliques formés
par cette décompofition. L'antimoine , le
, le fer & l'étain ont fpécialement cette propriété.
L'attraCtion de leurs oxides pour les fulfures
alcalins & l ’hydrofulfure entre- pour beaucoup
dans laçaufe de ce phénomène. Les oxides
de ces métaux n'ont aucune aCtion fur les fui fa tés.
Les fulfitts agjifent bien moins, quoique d’une
manière analogue x fur les métaux.
124. Les nitrates , projetés dans des vaiffeaux
rouges de feu , après les avoir mélangés d’abord
avec la plupart des Wraüa: en limaille fine, les enflamment
plus o-u moins vivement, fouvent avec
une fimple feintillation , quelquefois avec une
flamme éclatante, à caufe de la fixation de l’oxi-
gène devenant plus denfe y il fe forme* ainfi des
oxides métalliques au maximum d’oxidation , qui
fouvent fie trouvent-unis avec lès bafes des nitrates.
Ceux des métaux qui font acidifiables paflent
parrlà-à l ’état d’acides, & fe combinent en fels
avec les bafes falifiablés des nitrates. L’argent &
l’or réfiftent feuls à cette aCtion violente du nitre,
qui eft fouvent employée pour fe procurer promptement
dés oxides très-avancés. On conçoit aifé-
menc que les oxides métalliques n'éprouvent aucune
altération de la part dés nitrates, lorsqu'ils
•font faturés d'oxigène. Les nitrites font prefque
fans énergie fur les métaux, en comparaifon des
nitrates.
i2 f. Les muriates n'agiflent que très-foible-
ment fur les métaux, & n’en reçoivent réciproquement
qu'une fioible altération j cependant celui
d’ammoniaque eft facilement décompofé par
tous les métaux bien difioltibles dans l'acide muriatique,
ainfi .que par les oxides-métalliques ,
qui en dégagent encore plus rapidement l'ammoniaque.
Les muriates alcalins parodient au fl? être
en partie au moins décompofables par plufieurs
de ces oxides } ce qui pourra devenir quelque
jour de la. plus grande importance pour les arts >
& ce qui l’eft déjà par rapport au plomb & à
l'argent, ainfi qu’on l’expofera plus en détail à
Tarticle de ces métaux.
126. Les muriates furoxigénés font les fiels qui
ont le plus d’aCtion fur les métaux. Ceux-ci brûlent
avec la rapidité & le brillant de l'éclair lorfqu’on
les frappe fur une enclume après les avoir mêlés
avec deux ou trois fois leur poids de muiiate
furôxigéné de potafle. Un pareil-mélange chauffé
s’enflamme & détonne avec un éclat de lumière
& une promptitude bien fupérieures à celles qui
ont lieu par les nitrates. On obtient par ce procédé
des o,xides bien purs ; car on en fépare facilement
& complètement, par le lavage dans j'éau, le
muriate de potafle.
r27- Les phofphates & les phofphites n’éprouvent
aucune altération de la part des métaux , à
quelque température qu’on les expofe , & cela eft
en effet indique par les lois des attractions connues
I! en eft de même des fl iates, des borates
& des carbonates ; au/fi ces trois derniers genres
de fels ne fervent-ils jamais pour reconnoitre h
propriété des métaux,
128. Quoique les oxides métalliques aient en
général moins d’attraCtion pour les acides, que
n'en ont les bafes alcalines & terreufes, on voit
cependant quelquefois ces oxides , chauffés avec
des diffohilions lalines, fedifîoudre, fe colorer
& fe-combiner fi bien ave.c ces fels, fi bien que
lés criftaux qu'on en obtient enfui te parl‘évapo->
ration & le refroidiffement , font manifeftement
métallifères : telles font fpécialement les diflolu-
tions des fels alumineux, qui paroiflent s’unir
très-facilement aux oxides métalliques, & donner
après cela des criftaux dans lefquels on trouve
de véritables fels triples. Ces cas mêmes, font
beaucoup moins.rares qu’on ne l'a cru ju.fqu’ici ,
& ils fe multiplieront encore à mefure que les
recherches s’étendront fur les matières falines.
Après avoir expofé les caraCtères généraux &
les propriétés chimiques qui appartiennent aux
métaux., on peut confulter les articles relatifs à
chacun de ces vingt-huit corps.}:- Lavoir : A n t i - ;
m o i n e , A r g e n t , A r s e n i c , B i s m u t h , C é r
i u m C h r o m e , C o b a l t , C o l o m b i u m ,
C u i v r e , É t a i n , F e r , I r i d i u m , M a n g A t
n e se , M e r c u r e , Mo l y bd èn e , N ic k e l , O r ,
O s m i u m , P a l l a d i u m , P l a t i n e , P l o m b ,
R h o d i u m , T a n t a l e , T e l l u r e , T i t a n e ,
T u n g s t è n e , U r a n e & Z i n c ..
MÉTHODE. La méthode eft aujourd’hui d'autant
plus néceffaire en chimie, que le nombre des
faits, qui conftituent cet.te fcience eft beaucoup
plus confidérable qu’il rte l'étoit il y a trente ans.
L'art de clafler les faits., la néceflité de lesdifpor
lèr dans un ordre convenable à l’étude & aux pror
grès de la chimie , n’ont été jufqu’àjpréfent que
peu fentis par les auteurs, même parmi ceux qui
fie. font occupés d’en tracer les élémens, C’étoit
jufqu’ici une forte de coutume généralement adoptée
, & de convention devenue prefqu’une lo i,
que de fuivre dans les ouvrages de chimie la méthode
des naturaliftes , de partager ces ouvrages
en règnes comme on le faifoit pour les leçons, &
de traiter fucceffivement de chacun de ces règnes.,
en defeendant jufqu’à leurs, dernières divifions.
Cette, marche, la même que celle de l’hiftoire
naturelle, a été furtout admife par les écrivains
delà chimie, depuis l’époque ou cette fcience a
commencé à fecouer le joug pharmaceutique, fous
lequel elle avoit long-tems plié. Lorfque la chimie
généralifa lès. principes & embrafîa des idées plus
étendues que. la feule préparation des médica-
mens, prétendant dès-lors connoître toutes les
productions de la nature, elle dut s’aflocier aux
naturaliftes, & fe laiffer même diriger par eux.
Avant cette époque, les ouvrages chimiques n’é-
toient que des formulaires de préparations phar
maceutiques, & ils dévoient offrir de.s divifions
ou une méthode entièrement fondées fur les rapports
& les différences de ces. préparations.
Aujourd’hui la chimie doit faire , par rapport
à. l’hiftoire naturelle,, ce qu’elle a fait, il y a pief-
qu'un fiècle, par rapport à la pharmacie, quoique
beaucoup plus agrandie par la dernière affociàtion
que par la première, qui lui avoit toutefois donné
irai fiance, & dont elle n’a pu fe féparer qu’après
avoir plis un certain açcroiftëmen^ Elle doit açtuellement
éprouver le defir comme le befoin de
marcher feule & fans appui étranger, puifque la
carrière eft fi bien diftingpée de ce le des autres
fciencest, puifque fon but, fes moyens, fes réful-
tats en diffèrent fi eflentiellement. Quelques au^
teurs avoient déjà fenti cette néceflité, & ils
ayoient eflayé de modifier ou de changer même
la route fuivie jufqu’à, eux. C’eft ainfi que les académiciens
de Dijorv, dans l ’ouv.rage élémentaire
qu’ils publièrent en 1777 pour fervir à leurs, leçons,
lans s’aftreindre à la divifion des règnes.,
prirent pour texte de leur nouvelle méthode les
diflblvans & les diflolutions , c’eft-àr-dire, la bafe
des.; affinités, ou attraétions chimiques., mais confédérées
fo.u.s le.rapport du principal phénomène
& de l’opération de chimie fa plus générale & la
plus connue..
Perfuadé,.depuis fa.confofidation de la dpélrine
pneumatique & la publication de: notre» tableaq
méthodique de nomenclature, qui avoit déjà offert
en 1787 l’expofition des.corps confidérés chimiquement
fous une nouvelle forme, de l’indif-,
penfable néceffité d'avoir pour la-théorie de la.
chimie un ordre.tout particulier & qui lui appar-r
tînt en propre. , c'eft-à-dire, qui, fût fondé fur les
connoiffançes qu’elle donnoif de la narure des
corps, je fèntis que la méthode qu’il falloir créée
pour elle devoit fur-tout s’écarter de celles des
naturaliftes. En effet, ceux-ci ne çonfidèrent les
corps que tels qu’ils leur font offerts par la na.-:
ture,, & avec, l'enfemble de toutes leurs proprié-j
tés j ils,font même obligés de. les.fuppofer perma-,
nen,s3 pour en faifir avec exactitude, les formes ,
les. dimenfions,, les couleurs, la ftruéture appa-,
rente. S’ ils veulent fixer, par la difpofition régu-,
îière de leurs collections, les idées, de ceux qui
les étudient fur les caractères des productions na-,
turelles qu’ils ont adoptés., il faut qu’ils écartent;
; de ces. productions toujt.es les çaufes d’altération,
& de deflruCtion qui les menacent. L'anatomifte,
; guidé dans, fes premiers pas, par la méthode des na-
i turaliftes,, dès qu’il détruit la liai fon des parties»
; du corps des végétaux &c des animaux pour eu* s mieux connoître l'organifuion, ne peut lui-même.
• laiffer fubfifter les caraCtères, naturels, & fent
bientôt la néceflité d’en puifer d’autres dans le
; tiflu intérieur de ces êtres : ce qu’ il peut faire de
plus beau & de plus utile, c'eft de trouver dans
: les organes cachés un rapport de ftruCture avec-
les parties extérieures j rapport d’c>-ù il tire habilement,
d’après la. manière d’Ariftore, des induc-
' tions générales qui rendent plus exaCtes & plus
lumineufes les diftinCfions des méthodiftes , fondées
fur les caraCtères apparens ou fenfibles.
Mais le chimifte ne peut avoir ni la même marche
ni le même but : aucun corps ne refte, pour
fes recherches, dans fon état naturel} il en brife
le tiflu, il en fépare les parties intégrantes, il en
fait difparoître toutes les propriétés, il en détruit
du premier coup tous les caraCtères extérieurs ou
M 2