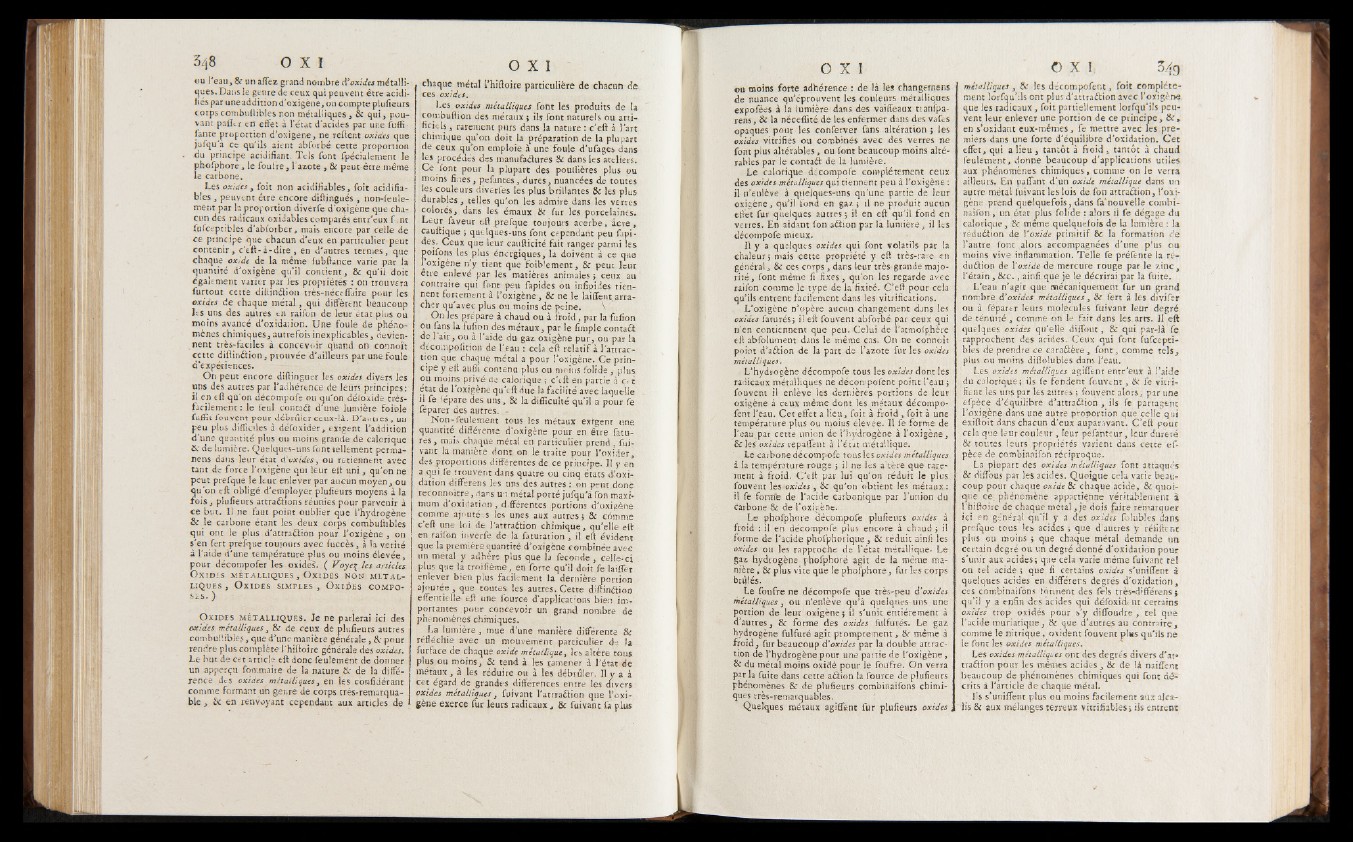
ou lJeau, & un aflez grand nombre A* oxides métalliques.
Dans le genre de ceux qui peuvent être acidifiés
par uneadditiond’oxigène, on compte plufieurs
corpscombullibles non métalliques, & qui, pouvant
pâlîtr. eiî effet à l’état d’acides par une fuffi-
fante proportion d’oxiger.e, ne relient oxides que
jufqu’a ce qu’ils aient abforbé cette proportion
du principe acidifiant. Tels font fpécialement le
phofphore, le foufre, l’azote , & peut-être même
le carbone.
Les oxides, foit non acidifiables, foit acidifia-
bles, peuvent être encore diftingués, non-feulement
par h proportion diverfe d'oxigène que chacun
des radicaux oxidables comparés entr’eux f .nt
fufceptibles d’abforber, mais encore par celle de
ce principe que chacun d’eux en particulier peut
contenir, c'eft-à-dire , en d’autres termes, que
chaque oxide de la même fubftance varie par la
quantité d’oxigène qu’ il contient, & qu’il doit
également varier par Tes propriétés : on trouvera
furtout cette diüin&ion très-néceflaire pour les
oxides de chaque métal, qui diffèrent beaucoup
les uns des autres en raifon de leur état plus ou
moins avancé d’oxidation. Une foule de phénomènes
chimiques, autrefois inexplicables, deviennent
très-faciles à concevoir quand on connoît
cette diftin&ion, prouvée d’ailleurs par une foule
d’expériences.
On peut encore diftinguer les oxides divers les
uns des autres par l’adhérence de leurs principes:
il en eft qü'on décompofe ou qu’on défoxide très-
facilement : le feul contaél d’une lumière foible
fuffit fouvent pour débrûîer ceux-là. D’autres, un
peu plus difficiles à défoxider, exigent l’addition
d’une quantité plus ou moins grande de calorique
de lumière. Quelques-uns font Bellement perma-
nens dans leur état à.'oxides, ou retiennent avec
tant de force l’oxigène qui leur elt uni, qu’on ne
peut prefque le leur enlever par aucun moyen, ou
qu’on eft obligé d’employer plufieurs moyens à la
fo is , plufieurs attractions réunies pour parvenir à
ce but. Il ne faut point oublier que l’hydrogène
& le carbone étant les deux corps combuftibîes
qui ont le plus d’attraClion pour l’oxigène , on
s’en fert prefque toujours avec fuccès, à la vérité
à l’aide d’une température plus ou moins élevée,
pour décompofer les oxides. ( Voyel les articles
O x id e s m é t a l l i q u e s , O x i d e s n o n m é t a l l
i q u e s , O x i d e s s im p l e s , O x i d e s c o m p o s
e s . )
O xides m é t a l l iq u e s . Je ne parlerai ici des
oxides métalliques 3 & de ceux de plufieurs autres
combuüibles, que d’une manière générale, &r pour
rendre plus complète l'hiftoire générale des oxides.
Le but de cet article eft donc feulement de donner
un apperçu fommaire de la nature & de la différence
des oxides métalliques 3 en les confidérant
comme formant un genre de corps très-remarquable
, & en renvoyant cependant aux articles de
chaque métal l’hiftoire particulière de chacun de
ces oxides.
Les oxides métalliques font les produits de la
conibuftion des métaux ; ils font naturels ou artificiels,
raremenc purs dans la nature : c’eft à l'art
chimique qu’on doit la préparation de la plupart
de ceux qu’on emploie à une foule d’ufages dans
les procédés des manufactures & dans les ateliers.
Ce font pour la plupart des poulfières plus ou
moins fines, pefantes, dures, nuancées de toutes
les couleurs diverfes les plus brillantes & les plus
durables , telles qu’on les admire dans les verres
colorés, dans les émaux & fur les porcelaines.
Leur faveur eft prefque toujours acerbe, âcre,
cauftique ; quelques-uns font cependant peu rapides.
Ceux que leur caufticité fait ranger parmi les
poifons les plus énergiques, la doivent à ce que
I oxigène n’y tient que foib-ement, & peut leur
etre enlevé par les matières animales ; ceux au
contraire qui font peu fapides ou infipides tiennent
fortement à l’oxigène , & ne le laiflent. arracher
qu’avec plus ou moins de peine. \ C, ;
. On les prépare à chaud ou à froid, par la fufion
ou fans la fufion des métaux, par le fimple contaCt
de l ’air, ou à l’aide du gaz oxigène pur, ou par la
décompofition de l’eau : cela eft relatif à l'attraction
que chaque métal a pour I’oxîgène. Ce principe
y eft auffi contenu plus ou moins folide, plus
ou moins privé fie calorique ; c’tft en partie à c.cz
état de l’oxigène qu’tft due la facilité avec laquelle
il fe fepare des uns, & la difficulté qu’il a pour fe
féparer des autres. -
Non-feulement tous les métaux exfgenr une
quantité^ différente d’oxigène pour en être fatu-
res, mais chaque métal en particulier prend , fui-
vant la maniéré dont on le traite pour l’oxider,
des proportions différentes de ce principe. Il y en
a ^rouver,t dans quatre ou cinq états d’oxi-
dation différens les uns des autres : on peut donc
reconnaître, dans un métal porté jufqu'à fon maximum
d’oxidation , différentes portions d’oxigène
comme ajouté-.s les unes aux autres j & comme
c’eft une loi de l ’attra&ion chimique, qu’elle eft
en raifon inverfe de la faturation , il eft évident
que la première quantité d’oxigène combinée avec
un métal y adhère plus que la fécondé , celle-ci
plus que la tmifième, en forre qu’il doit fe laifler
enlever bien plus facilement la dernière portion
ajourée, que toutes les autres. Cette diftin&ion
effenrielle- eft une fource d’applications bien importantes
pour concevoir un grand nombre de
phénomènes chimiques.
La lumière , mue d'une manière différente &
réfléchie avec un mouvement particulier de la
furface de chaque oxide métallique, les altère tous
plus ou moins, & tend à les çamener à l’état de
métaux , à les réduire ou à les débruler. Il y a à
cet égard de grandes différences entre les divers
oxides métalliques , fuivant l’atrraêlion que l’oxigène
exerce fur leurs radicaux, & fuivant fa plus
ou moins forte adhérence : de là les changemens
de nuance qu’éprouvent les couleurs métalliques
expofées à la lumière dans des vaiffeaux uanfpa-
rens, & la néceflité de les enfermer dans des vafes
opaques pour les conferver fans altération > les
oxides vitrifiés ou combinés avec des verres ne
font pius altérables, ou font beaucoup moins altérables
par le contaéfc de la lumière.
Le calorique décompofe complètement ceux
des oxides métalliques qui tiennent peu à l’oxigène :
il n’enlève à quelques-uns qu'une partie de leur
oxigène, qu’il fond en gaz j il ne produit aucun
effet fur quelques autres ; il en eft qu'il fond en
verres. En aidant fon adtion par la lumière, il les
décompofe mieux.
Il y a quelques oxides qui font volatils par la
chaleur j.mais cette propriété y eft très-race en
général, & ces corps, dans leur très-grande majorité,
font même fi fixes, qu'on les regarde avec
raifon comme le type de la fixité. C’eft pour cela
qu’ils entrent facilement dans les vitrifications.
L’oxigène n’opère aucun changement dans les
oxides farurés; il eft fouvent abforbé par ceux qui
ri en contiennent que peu. Celui de l’atmolphère
eft abfolument dans le même cas. On ne connoît
point d’aétion de la part de l’azote fur les oxides
métalliques.
L’hydrogène décompofe tous les oxides dont les
radicaux métalliques ne décompofent point l’eau ;
fouvent il enlève les dernières portions de leur
oxigène à ceux même dont les métaux décompo-
fent l’eau. Cet effet a lieu, foit à froid, foit à une
température plus ou moins élevée. Il fe forme de
l'eau .par cette union de l’hydrogène à l’oxigène,
& les oxides repaffent à l’état métallique.
Le carbone décompofe tous les oxides métalliques
à la température rouge ; i! ne les a:tère que rarement
à froid. C ’eft par lui qu’on réduit le plus
fouvent les oxides , & qu’on obtient les métaux.:
il fe forvrïfe de l’acide carbonique par l ’union du
carbone & de l’oxigène.
Le phofphore décompofe plufieurs oxides à
froid : il en décompofe plus encore à chaud ; il
forme de l’acide phofphorique, & réduit ainli les
oxides ou les rapproche de l’état mérallique. Le
gaz hydrogène phofphoré agit de la même maniéré,
& plus vite que le phofphore, fur les corps
brûlés.
Le foufre ne décompofe que très-peu d’oxides
métalliques, ou n’enlève qu’à quelques-uns une
portion de leur oxigène 5 il s’unit entièrement à
d’autres, & forme des oxides fulfurés. Le gaz
hydrogène fulfuré agît promptement, &r même à
froid, fur beaucoup à'oxides par la double attraction
de l’hydrogène pour une partie de l’oxigène,
& du métal moins oxidé pour le foufre. On verra
par la fuite dans cette a&ion la fource de plufieurs
phénomènes & de plufieurs combinaifons chimiques
très-remarquables.
Quelques métaux agiflent fur plufieurs oxides ,
métalliques, & les décompofent, foit complètement
îorfqu’ ils ont plus d’attra&ion avec l’oxigène
que les radicaux, foit partiellement lorfqu’ils peuvent,
leur enlever une portion de ce principe, & ,
en s’oxidant eux-mêmes, fe mettre avec les premiers
dans une forte d’équilibre d’oxidation. Cet
effet, qui a lieu, tantôt à froid, tantôt à chaud
feulement, donne beaucoup d’applications utiles
aux phénomènes chimiques, comme on le verra
ailleurs. En paffant d’un oxide métallique dans un
autre métal fuivant les lois de fon artraélion, l’oxi-
gène prend quelquefois, dans fa4nouvelle combi-
naifon , un état plus folide : alors iî fe dégage du
calorique, & même quelquefois de la lumière : la
réduétion de Y oxide primitif & la formation de
l’autre font alors accompagnées d’une p’us ou
moins vive inflammation. Telle fe préfente la réduction
de Xoxide de mercure rouge par le zinc,
l’étain, & c ., ainfi que je le décrirai par la fuite.
L’eau n’ agit que mécaniquement fur un grand
nombre à*oxides métalliques , & fert à les divifer
ou à féparer leurs molécules fuivant leur degré
de ténuité, comme on le fait dans les arts. II eft
quelques oxides qu’elle diffout, & qui par-là fe
rapprochent des acides. Ceux qui font fufcepti-
bles de prendre ce caractère, font, comme tels,
plus ou moins diflolubles dans l’eau.
Les oxides métalliques agifient enrr'eux à l’aide
du calorique;.ils fe fondent fouvent, & fe vitrifient
les uns par les autres ; fouvent alors, par une
efpèce d’équilibre d’attraClion, ils fe partagent
l’oxigène dans une autre proportion que celle qui
exiftoit dans chacun d’eux auparavant. C ’eft pour
cela que leur couleur, leur pefanteur, leur dureté
& toutes leurs propriétés varient dans cette efpèce
de combinaifon réciproque.
La plupart des oxides métalliques font attaques
& diffous par les acides. Quoique cela varie beaucoup
pour chaque oxide & chaque acide, & quoique
ce, phénomène appartienne véritablement à
l'bjftoire de chaque métal, je dois faire remarquer
ici en general qu’il y a des oxides folubles dans
prefque tous les acides ; que d'autres y réfiftenc
plus on moins ; que chaque métal demande un
certain degré ou un degré donné d’oxidation pour
s’unir aux acides; que cela varie même fuivant tel
ou tel acide ; que fi certains oxides s'unifient à
quelques acides en différées degrés d’oxidation,
ces combinaifons forment des fels très-différens $
qu’il y a enfin des acides qui défoxident certains
oxides trop oxides pour s’y diffoudre , tel que
l’acide muriatique, & que d’autres au contraire,
comme le nitrique, oxident fouvent plus qu’ils ne
le font les oxides métalliques. '
Les oxides métalliques ont des degrés divers d’at*
tra&ion pour les mêmes acides , & de là naiflent
beaucoup de phénomènes chimiques qui font décrits
à l’article de chaque métal.
Ils s’ unifient plus ou moins facilement aux alcalis
& aux mélanges terreux vitrifiabJes, ils entrent