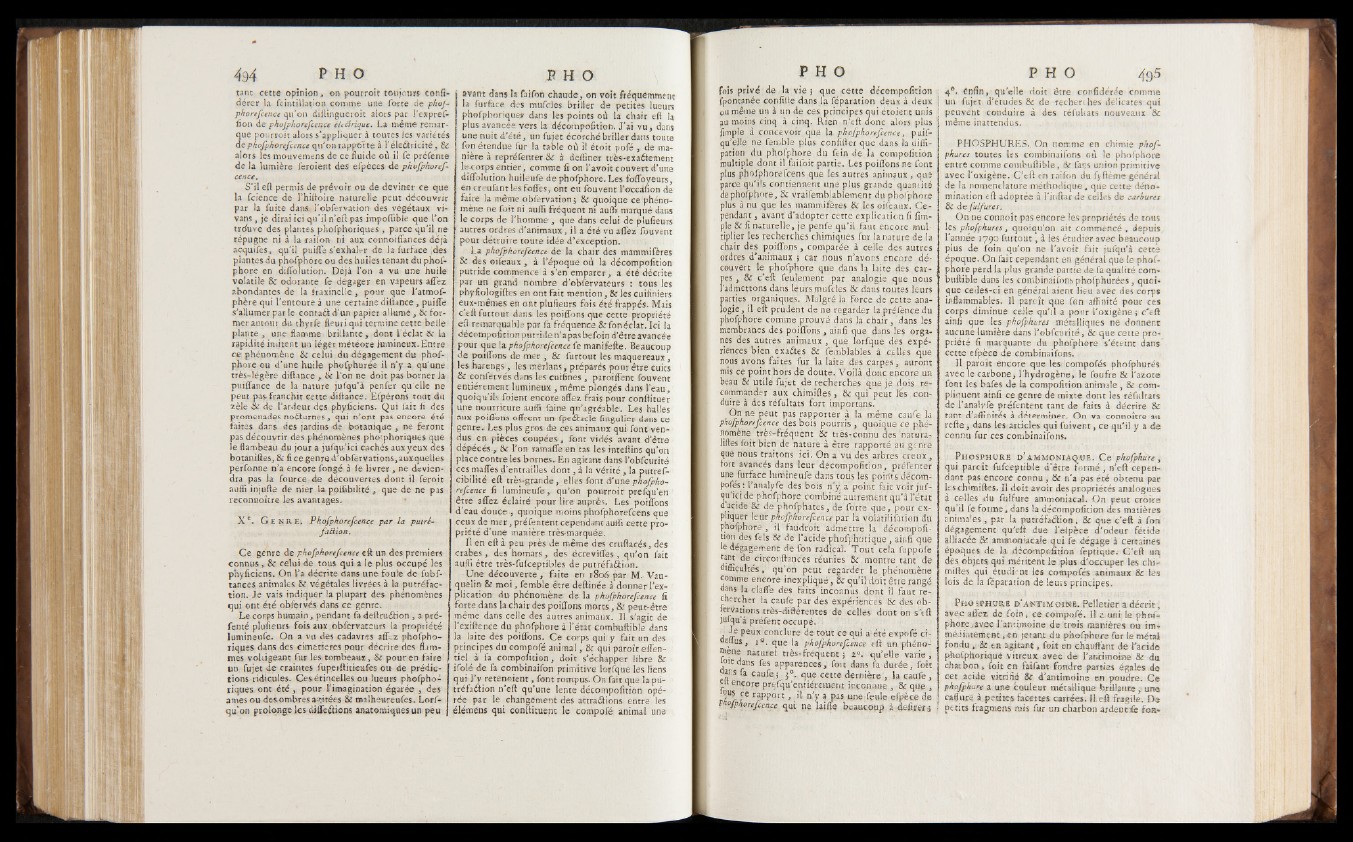
tant cette opinion, ©n pourroit toujours confï*
dérer la fcintillation comme une forte de phoj-
phorefcence qu’on diftingueroit alors par J’expref-
fion de pkojphorefcençe éltCtrique. La même remar-
ue pourroit alors s’appliquer à toutes les variétés
%phofphorefcence qu’on rapporte à l’éleétiicité, &
alors les mouvemens de ce fluide où il fe préfente
de la lumière feroient des efpèees de phofphorefeence.
S’il eft permis de prévoir ou de deviner ce que
la fcience de l’hiftoire naturelle peut découvrir
par la fuite dans l’obfevvation des végétaux vi-
vans, je dirai ici qu’il n’eft pas impoflîble que l’on
trduve des plantes phofphoriques , parce qu’il ne
répugne ni a la raifon ni aux cénnoifiances déjà
acquifes, qu’il puiffe s’exhaler de la furface des
plantes du phofphore ou des huiles tenant du phof»
phore en diffbîution. Déjà l’on a vu une huile
volatile & odorante fe dégager en vapeurs allez
abondantes de la fraxinelle, pour que l’atmof-
phère qui l’entoure a une certaine diftanee, puiffe
s’allumer par le eonraéà d’un papier allumé , & former
autour du thyrfe fleuri qui termine cette belle
plante une flamme brillante, dont l’éclat & la
rapidité imitent un léger météore lumineux. Entre
ce phénomène & celui du dégagement du phof-
phore ou d’une huile phofphurée il n’y a qu’une
très-légère diftanee , & l ’on ne doit pas borner la
puiffance de la nature jufqu’ à penfer qu'elle ne :
peut pas-franchir cette diftanee. Efpérons tout du :
zèle & de l’ardeur des phyficiens. Qui fait fl des ]
promenades noéturnes, qui n’ont pas encore été h
faites dans des jardins de botanique , ne feront
pas découvrir des phénomènes phofphoriques que
le flambeau du jour a jufqu’ici cachés aux yeux des
botaniftes, & fi ce genre d’obfervations, auxquelles
perfonne n’a encore fange à fe livrer, ne deviendra
pas la fource de découvertes dont il feroit
auflî injufte de nier la. ppffibilité , que de ne pas
reconnaître les avantages.
X e. GENRE. Phofphorefeence par la putréfaction.
Ce genre de phofphorefeence eft un des premiers
connus, & celui de tous qui a le plus occupé les
phyficiens. On l’a décrite dans une foule de fubf-\
tances, animales & végétales livrées à la putréfaction.
Je vais indiquer la plupart des phénomènes
qui ont été obfervés dans ce genre. '
Le corps humain * pendant fa deftru&ion, a pré-
fenté plufieurs fois aux obfervateurs la propriété
lumineufe. On a vu des cadavres aflfcz phofphoriques
dans des cimetières pour décrire des flammes
voltigeant fur les tombeaux, Sc pour en faire
un fujet de craintes fuperftitieiifes ou de prédictions
ridicules. Ces étincelles ou lueurs phofpho^
riques ont été , pour l’imagination égarée , des
âmes ou desombres agitées & mal heure ufes.. Lorf-
qu’on prolonge les diffeétions anatomiques un peu
j avant dans la faifon chaude, on voit fréquemment
la furface des mufcles briller de petites lueurs
phofphoriques dans lès points où la chair eft la
plus avancée vers la décompofition. J’ai vu, dans
une nuit d’été, un fujet écorGhébriller dans toute
fon étendue fur la table où il étoit pofé , de manière
à représenter & à deftîner très-exa&ement
le-corps entier, comme fi on l’avoir couvert d’une
diffolution huileufe de phofphore. Les folîbyeurs,
en creufant les foflfes, ont eu fouvent l’oceafion de
faire la même oblervation ; & quoique ce phénomène
ne foit ni aufli fréquent ni aufli marqué dans
le corps de l’homme , que dans celui de plufieurs
autres ordres d’animaux, il a été vu affez fouvent
pour détruire toute idée d’exception.
La phofphorefeence de k chair des mammifères
& des eifeaux , à l’époque où la décompofition
; putride commence à s’en emparer, a été décrite
1 par un grand nombre d’obfervateurs : tous les
phyfiologiftes en ont fait mention, & les cuifiniers
eux-mêmes en ont plufieurs fois été frappés. Mais
c’eft furtout dans les poiffons que cette propriété
eft remarquable par fa fréquence & fon éclat. Ici la
décompofition putride n’a pas befoin d’être avancée
pour que la pkofphorefcence fe manifefte. Beaucoup
de paillons de mer , & furtout les maquereaux ,
des harengs, les merlans, préparés pour être cuits
& eonlervés dans les cuifines , paroiffent fouvent
entièrement lumineux, même plongés dans l’eau,
quoiqu’ils foient encore affez frais pour conftituer
une nourriture aufli faine qu’agréable. Les halles
aux poiffons offrent un- fpeéhcle fingulier dans ce
genre.. Les plus gros de ces animaux qui font vendus
en pièces coupées, font vidés avant d’être
dépecés & l’on ramaffe en tas les inteftins qu’on
place contre les bornes. En agitant dans l’obfcurité
ces maffes d’entrailles dont, à la vérité , la putref-
cibilké eft très-grande, elles font d’uneph&fpko-
refeence fi lumineufe, qu’on pourroit prefqu’en
être affez éclairé pour lire auprès. Les poiffons
d’eau douce , quoique moins phofphorefcens que
ceux de mer, préfententcependant aufli cette propriété
d’une manière trèsmatquée'.
Il en eft à peu près de même des cruftacés, des
crabes, des homars, des écreviffes, qu’on fait
aufli être très-fufceptibles de putréfaction.
Une découverte, faite en rSo6 par M. Vau-
quelin & moi, femble être deftinëe à donner l’explication
du phénomène de la phofpkorefc ence fi
forte dans lachair des poiffons morts, & peut-être
même dans,celle des autres animaux. II. s'agit de
l'exiftence du phofphore à l'état combuftible dans
la laite des poiffons. Ce corps qui; y fait un des
principes du compofé animal r & qui paroït effen-
tiel à fa compolition, doit s'échapper libre &
ifolé de fa combinaifon primitive lotfque les liens
qui l'y retenoient, font rompus. On fait que la pd-
tréfaéfion n'eft qu'une lente décompofition opérée
par le changement des attrapions entre les
élémens qui conftituent le compofé animal une
fois privé de la vie $ que cette décompofition
fpontanée confiée dans la féparation deux à deux
pu même un à un de ces principes qui étoient unis
au moins cinq à cinq. Rien n’eft donc alors plus
fi m pie à concevoir que la phofphorefeence, puif-
qu’elle ne femble plus confifter que dans la diifi-
oation du phofphore du fein de la compolition
multiple dont il faifoit partie. Les poiffons ne font
plus phofphorefcens que les autres animaux , que
parce qu’ ils contiennent une plus grande quantité
de phofphore, & vraifemblablement du phofphore
plus à nu que les mammifères & les oifeaux. Cependant
, avant d’adopter cette explication fi Ample
& fi naturelle, je penfe qu’il faut encore multiplier
les recherches chimiques fur lanature de la
chair des poiffons, comparée à celle des autres
ordres d’animaux > car nous n’avons enepre découvert
le phofphore que dans la laite des carpes
, & c’eft feulement par analogie que nous
l’admettons dans leurs mufcles & dans toutes leurs
parties organiques, Malgré la force de cette analogie,
il eft prudent de ne regarder la préfence du
phofphore comme prouvé dans la chair, dans les
membranes des poiffons, ainfi que dans les organes
des autres animaux, que lorfque des expériences
bien exactes & fembiables à .celles que
nous avons faites fur la laite des carpes, auront
mis ce point hors de doute. Voilà donc encore un
beau & utile fujet de recherches que je dois recommander
aux chimiftes, & qui peut l'es conduire
à des réfultats fort importais.
On ne peut pas rapporter à la même caufe la
phofphorefeence des bois pourris , quoique ce phénomène
très-fréquent & très-connu des natura-
liftes foit bien de nature à être rapporté au genre
que nous traitons ici. On a vu des arbres creux,
fort avancés dans leur décompofition, préfenter
une furface lumineufe dans tous les points dëcorn-
pofés : l’ànalyfe des bois n’y, a point fait voir juf-
qp'ici de phofphore combiné autrement qu’à l’état
d acide & de phofphates, de forte que, pour expliquer
leur phofphorefeence par là vola tili fanon du
phofphore, il faudroit admettre la décompofi-
tion des fels & de l’acide phofphorique, ainfi que
le dégagement de fon radical. Tout cela fuppofe
tant de cirçonftances réunies & montre tant de
difficultés, qu’on peut regarder le phénomène
comme encore inexpliqué, & qu’il doit être rangé
dans la claffe des faits inconnus dont il faut rechercher
la caufe par des expériences & des observations
très-différentes de celles dont on s'eft
JUlqu’à préfent occupé.
Je peux conclure de tout ce qui a été expofé ci-
deffus, i®. que la phofphorefeence eft un phénomène
naturel très-fréquent j 2°. qu’elle varie ,
loit dans fes apparences,: foit dans fa durée, foit
nan& fa caufe; 30, que cette dernière , la caufe,
ençore prefqu'emiérenaerit inconnue , & que ,
rapport, il n’y 4 pas une feule efpèce de
thojp ho refeence qui ne laiffe beaucoup à defirers
4°. énfin, qu'elle doit être confidérée comme
un fujet d’études & de recherches délicates qui
peuvent conduire à des réfuhats nouveaux &
même inattendus.
PHOSPHURES.. On nomme en chimie phof-
phares toutes les combinaifons ou le phofphore
entre comme combuftible, & fans union primitive
avec l’oxigène. C ’eft en raifon du fyftème général
de la nomenclature méthodique, que cette dénomination
eft adoptée à l’inftar de celles de carbures
8v de fulfures.
On ne connoît pas encore les propriétés de tous
les phofphures, quoiqu’on ait commencé , depuis,,
l’année 1790 furtout, à les étudier avec beaucoup
plus de foin qu'on ne l’a voit fait jufqn'à cette
époque. On fait cependant en général que le phofphore
perd la plus grande partie de fa qualité combuftible
dans les combinaifons pkofphurées, quoique
ceiles-ci en général aient lieu avec des corps
inflammables. Il parcît que fon affinité pour ces
corps diminue celle qu’il a pour l’oxigène ; c’eft
ainfi que les phofphures métalliques ne donnent
aucune lumière dans l’obfcurité, & que cette propriété
fi marquante du phofphore s’éteint dans
cette efpèce de combinaifons.
Il paroït encore que les? compofés phofphures
avec le carbone, l'hydrogène, le foufre & l’azote
font les bafes de la compolition animale, & compliquent
ainfi ce genre de mixte dont les réfultats
de l’analyfe préfentent tant de faits à décrire &
tant d’affinités à déterminer. On va connoître au
refte, dans les articles qui fui vent, ce qu’il y a de
connu fur ces combinaifons.
Phosphure p’ ammoniaque. Ce pkofpkure,
qui parcît fufceptible d’être formé, n’eft cependant
pas encore connu, & n’a pas été obtenu par
leschimiftes. Il doit avoir des propriétés analogues
à celles du fulfure ammoniacal. On peut croire
qu’il fe forme, dans la décompofition des matières
animales, par la putréfaction, & que c’eft à fon
dégagement qu'eft due l ’espèce d’odeur fétide
alliacée .& ammoniacale qui fe dégage à certaines
époques de la. décompofition feptique. C'eft un
dès objets qui méritent le plus d'occuper les chimiftes
qui étudient les compofés animaux & les
lois de la féparation de leurs principes.
Phosphure é>’antimo-ine. Pelletier a décrit,
avec affez de foin, ce compo/é. Il à uni le phofphore
>avec l’antimoine de trois manières ou inw
Riédiatement, en jetant du phofphcre fur le métal
fondu , & en agitant, foit en chauffant de Taride
pholph-orique vitreux avec de- l’antimoine & du
charbon, foit en fai faut fondre parties égales de
cet acide vitrifié & d’antimoine en poudre. Ce
püpfpkare a une couleur métallique brillante p une
caflure à peticeis facettas carrées. IL eft fragile. De
petits fragmens rais fur un charbon ardentfe fan*