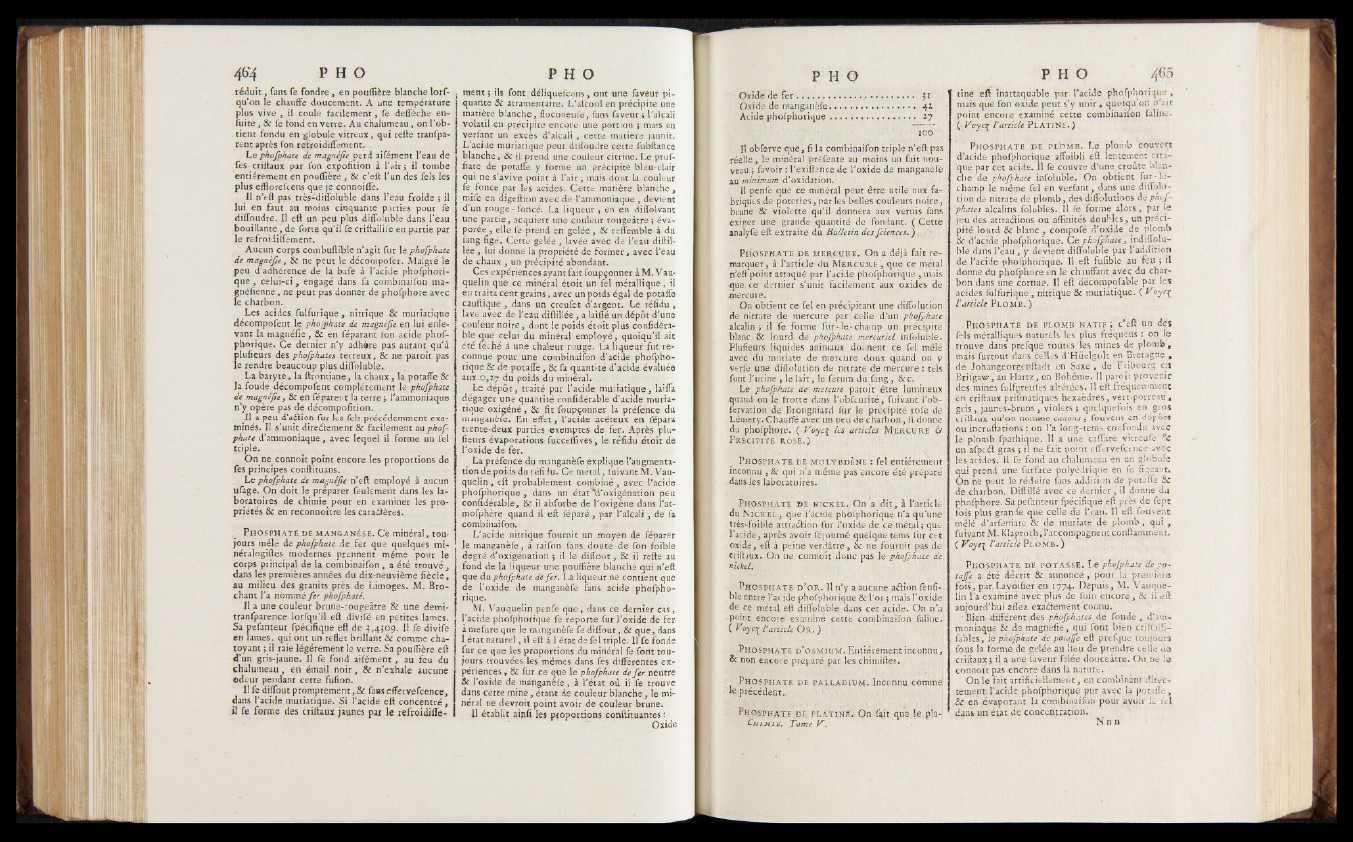
réduit, fans fe fondre, en pouflière blanche lorf-
qu’on le chauffe doucement. A une température
plus vive , il coule facilement, fe deffèche en-
fuite , & fe fond en verre. Au chalumeau, on l'obtient
fondu en globule vitreux, qui refte tranfpa-
rent après fon refroidiffement.
Le pkofphate de magnifie perd aiféjnent l'eau de
fes criftaux par fon expofition à l'air ; il tombe
entièrement en pouflière, & c'elt l'un des fels les
plus efflorefeens que je connoifle.
II n'eft pas très-diffoluble dans l'eau froide ; il
lui en faut au moins cinquante parties pour fe
difloudre. Il eft un peu plus difloiuble dans l'eau
bouillante, de forte qu'il fe criftallife en partie par
le refroidiflement.
Aucun corps combuftibîe n'agit fur le pkofphate
de magnifiey & ne peut le décompofer. Malgré le
peu d'adhérence de la bafe à l'acide phofphori-
que, celui-ci, engagé dans fa combinaifon ma-
gnéfienne, ne peut pas donner de phofphore avec
le charbon.
Les acides fulfurique, nitrique & muriatique
décompofent le pkofphate de magnifie en lui enlevant
la magnéfie, & en féparant fon acide phof-
phorique. Ce dernier n'y adhère pas autant qu'à
plufieurs des phofphates terreux, & ne paroît pas
le rendre beaucoup plus difloiuble.
La baryte, la ftrontiane, la chaux, la potafle &
la foude décompofent complètement le pkofphate
de magnéfie y & en féparent la terre 5 l'ammoniaque
n'y opère pas de décompofition.
Il a peu d’aélion fur les fels précédemment examinés.
Il s’unit directement & facilement au phof-
phate d'ammoniaque, avec lequel il forme un fel
triple.
On ne connoît point encore les proportions de
fes principes conftituans.
Le pkofphate de magnifie n’eft employé à aucun
ufage. On doit le préparer feulement dans les laboratoires
de chimie pour en examiner les propriétés
& en reconnoître les caractères.
Phosphate de manganèse. Ce minéral, toujours
mêlé de pkofphate de fer que quelques mi-
néralogiftes modernes prennent même pour le
corps principal de la combinaifon, a été trouvé,
dans les premières années du dix-neuvième fiècle,
au milieu des granits près de Limoges. M. Brochant
l'a nommé fer pkofphate.
Il a une couleur brune-rougeâtre & une demi-
tranfparence lorfqu’il eft divifé en petites lames.
Sa pefanteur fpécifique eft de 3,4305). Il fe divife
en lames, qui ont un reflet brillant & comme chatoyant
; il raie légèrement le verre. Sa pouflière eft
d’un gris-jaune. Il fe fond aifément, au feu du
chalumeau, en émail noir, & n'exhale aucune
odeur pendant cette fufion.
Il fe diflout promptement, & fans effervefcence,
dans l’acide muriatique. Si l'acide eft concentré ,
il fe forme des criftaux jaunes par le refroidifle-
. ment ; ils font déliquefcens, ont une faveur piquante
& atramentaire. L'alcool en précipite une
matière blanche, floconeufè, fans faveur i l ’alcali
volatil en précipice encore une portion ; mais en
verfant un excès d'alcali , cette matière jaunit.
L'acide muriatique peut difloudre cecte. fubftance
blanche, & il prend une couleur citrine. Le pruf-
lïate de potafle y forme un précipité bleu-clair
qui ne s'avive point à l’air ; mais dont la couleur
fe fonce par les acides. Cette matière blanche ,
mife en digeftion avec de l'ammoniaque , devient
d'un rouge-foncé. La liqueur, en en diflolvant
une partie, acquiert une couleur rougeâtre; évaporée
, elle fe prend en gelée , & reffemble à du
fang figé. Cette gelée, lavée avec de l’eau diftil-
lée, lui donne la propriété de former, avec l’eau
de chaux , un précipité abondant.
Ces expériences ayant fait foupçonner à M. Vau-
quelin que ce minéral étoit un fel métallique, il
en traita cent grains, avec un poids égal de potafle
cauftique, dans un, creufet d’argent. Le réfidu,
layé avec de l'eau diftillée, a laiffé un dépôt d'une
couleur noire, dont le poids étoit plus confidéra-
ble que celui du minéral employé, quoiqu’il ait
été fée hé à une chaleur rouge. La liqueur fut reconnue
pour'une combinaifon d’acide phofpho-
rique & de potafle , & fa quantité d’acide évaluée
aux-O, 27- du poids du minéral.
Le dépôt, traité par l’acide muriatique, laifla
dégager une quantité confidérable d’acide muriatique
oxigéné , & fit foupçonner la préfence du
manganèfe. En effet, l’acide acéteux en fépara
trente-deux parties exemptes de fer. Après plusieurs
évaporations fucceflfives, le réfidu étoit de
l’oxide de fer.
La préfence du manganèfe explique l’augmentation
de poids du réfidu. Ce métal, fuivant M. Vau-
quelin, eft probablement combiné, avec l’acide
phofohorique , dans un état%d’oxigénation peu
confidérable, & il abforbe de l'oxigène dans l'at-
mofphère quand il eft féparé, par l'alcali, de fa
combinaifon.
L'acide nitrique fournit un moyen de féparer
Je manganèfe, à raifon fans doute de fon foible
degré d'oxigénation ; il le diflout, & il refte au
fond de la liqueur une pouflière blanche qui n'eft
que du pkofphate de fer. La liqueur ne contient que
de l'oxide de manganèfe fans acide phofpho-
rique.
M. Vauquelin penfe que, dans ce dernier cas,
l’acide phofphorique fe reporte fur l'oxide de fer
à mefure que le manganèfe fe diflout, & que, dans 1 état naturel, il eft à l'état de fel triple. Il fe fonde
fur ce que les proportions du minéral fe font toujours
trouvées les mêmes dans fes différentes expériences
, & fur ce que le pkofphate de fer neutre
& l’oxide de manganèfe, à l’état où il fe trouve
dans celte mine, étant de couleur blanche, le minéral
ne devroit point avoir de couleur brune.
Il établit ainfi les proportions conflituantes :
Oxide
Oxide'de fèr .............................................. 31
Oxide de manganèfe................................ 41
Acide phofphorique................................. 27
100
Il obferve que, fi la combinaifon triple n’ eft pas
réelle, le minéral préfente au moins un fait nouveau
i favoir : l'exiftence de l’oxide de manganèfe
au minimum d’oxidation.
Il penfe que ce minéral peut être utile aux fabriques
de poteries, par les belles couleurs noire,
brune & violette qu’il donnera aux vernis fans
exiger une grande quantité de fondant. (Cette
analyfe eft extraite du, Bulletin desfiences.),,
Phosphate de mercure. On a déjà fait remarquer,
à l’article du: Mercure , que ce métal
n'eft point attaqué par l'acide phofphorique , mais
que ce dernier s'unit facilement aux oxides de
.mercure.
On obtient ce fel en précipitant une diffolution
de nitrate de mercure par celle d’un phofphate
alcalin ; il fe forme fur-le-champ un précipité
blanc & lourd de pkofphate mercuriel infoluble.
Plufieurs. liquides animaux donnent ce fel mêlé
avec du muriate de mercure doux quand on y
verfe une diffolution de nitrate de mercure : tels
font l'urine, le lait, le férum du fang, 8cc.
Le pkofphate def mercure paroît être lumineux
quand on le frotte dans l’obfcurité, fuivant l'ob-
fervation de'Brongniard fur le précipité rofe de
Lénvery.Chauffé avec un peu de charbon, il donne
du phofphore. ( Voyc\ les articles Mercure &
Précipite rose.)
Phosphate dé molybdène : fel entièrement
inconnu , 8c qui n’a même pas encore été préparé
dans les laboratoires.
Phosphate de nickel. On a dit, à l’article
du Nickel, que l’acide.phofphorique n’a qu’une
très-foible attra&ion fur l’oxide de ce métal; que;
l’acide, après avoir féjourné quelque tems fur cet
oxide, eft à peine verdâtre, & ne fournit pas de
criftaux. On ne connoît donc pas le phofphate de
nickel.
Phosphate d' or. Il n’y a aucune aédion fenfi-^
ble entre l’ac ide phofphorique & l’or ; mais l’oxide
de ce métal eft difloiuble dans cet acide. On n’a
point encore examiné cette combinaifon faline.
( Voye^ l'article Or . )
rH UM 'H A it d o sm iu m , en tiè rem en t inconnu
& non encore préparé par les chimifteï.
Phosphate de palladium. Inconnu comm
le précédent.
Phosphate.de, platine. On fait que.le pla
Cut m is . famé V~.
tine eft inattaquable par l'acide phofphorique ,
mais que fon oxide peut s’y unir, quoiqu’on n'ait
point encore examiné cette combinaifon fàline.
.(• Voye% U article PLATINE.)
Phosphate de pèomb. Le plomb couvert
d’acide phofphorique affbibli eft lentement attaqué
par cet acide. Il fe couvre d'une croûte blanche
de phofphate infoluble. On obtient fur-le-
champ le même fel en verfant , dans une diflblu-
tion de nitrate de plomb, des diffolutions de phofpkates
alcalins folubles. Il fe forme alors, par le
jeu des attrapions ou affinités doubles, un précipité
lourd & blanc, compofé d’oxide de plomb
&■ d'acide phofphorique. Ce pkofphate, indiffolu-
ble dans l’eau, y devient difloiuble par l’addition
de l’acide phofphorique. Il eft fufible au feu ; il
donne du phofphore en le chauffant avec du charbon
dans une cornue. Il eft décompofable par les
acides fulfurique, nitrique & muriatique. ( K oye[
rarticle PLOMB. )
Phosphate de plomb natif j c’ eft un des
fels métalliques naturels les plus fréquéris : on te
trouve dans prefque toutes les mines de plomb,
mais furtout dans celles d'Hüclgok en Bretagne ,
de Johangeorgenftadt en Saxe , de Fribourg en
Brifgaw, au Hartz, en Bohême. Il paroît provenir
des mines fulfureufes altérées. Tl eft fréquemment
en criftaux prilmatiques hexaèdres, vert-porreau *
gris, jaunes-bruns , violets ; quelquefois en gros
criftaux qu'on nomme canons i fouvent en dépôts
ou incruftations : on l'a Ion g-tems confondu avec
le plomb fpathique. Il a une caflure vitreufe &
un afpeél gras ; il ne fait point effervefcence avec
les acides. Il fe fond au chalun>eaii en un globule
qui prend une furface polyédrique en fe figeant,
On ne peut le réduire fans addition de potafle &
de charbon. Diftilté avec ce dernier, il donne du
phofphore. Sa pefanteur fpécifique eft près de fept
fois plus grande que celle de l'e.aui. Il eft fouvept
mêlé d’arfeniate & de muriate de plomb, qui ,
fi-uyant M. Kîaproth, l’accompagnent cônftammenc,
( Voye\ Varticle PLOMB. )
Phosphate de potasse. Le phofphate de po-
tajfe a été décrit & annoncé, pour là première
fois, par Lavoifier en 1774. Depuis, M. Vauque-
tin l’a examiné avec plus de foin encore, & il eft
aujourd’hui affez exa&ement connu.
Bien différent;des phofpkates.de foude, d’ammoniaque
& de magnéfie, qui font bien criltaüi-
fables, le phofphate de potajfe eft préfque toujours
fous la forme de gelée au lieu de prendre celle ùe
criftaux 3 il a une faveur falée douceâtre. On ne le
connoît pas encore dans la nature. j
On le fait artificiellement, en combinant directement
l’acide phofphorique pur avec la potafle,
& en .évaporant la combinaifon pour avoir le fel
dans un état de concentration.
N n n