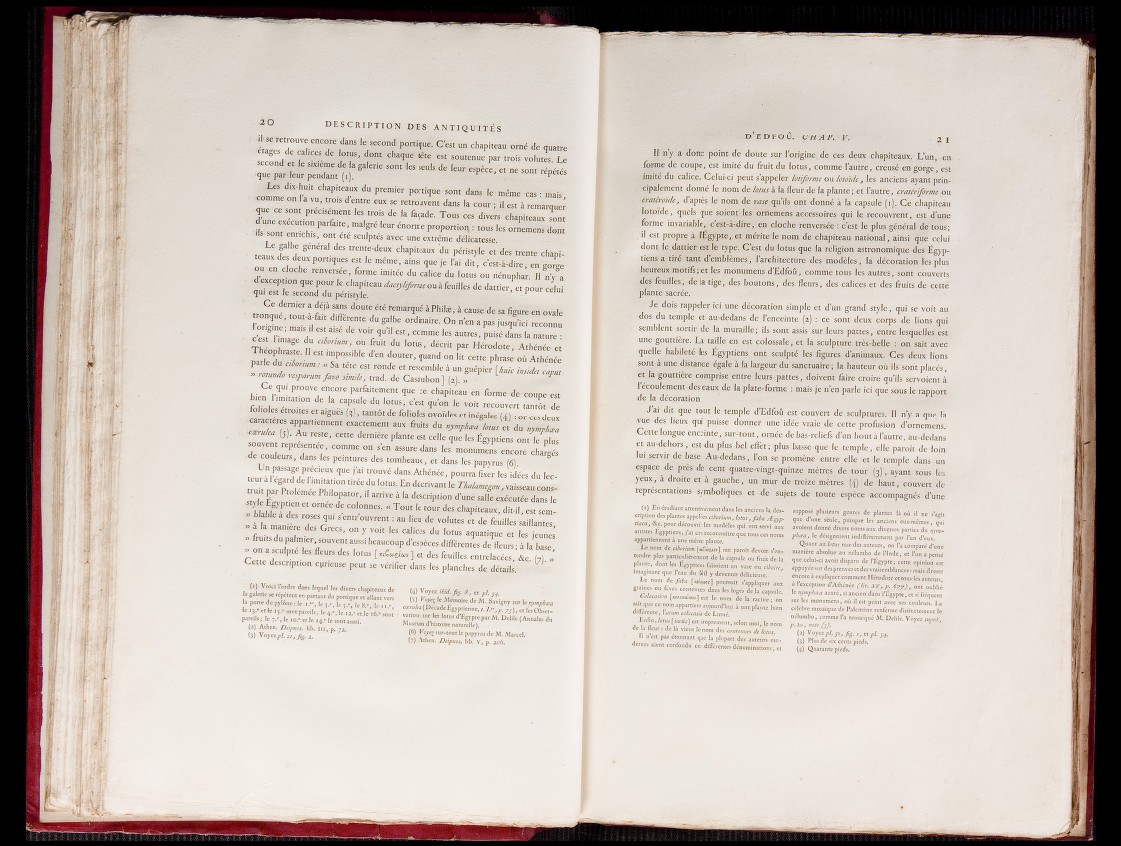
WÊ?ÊÈÈÊÊËÈÈ le SeCOnd p0rti,ï ue- Cestun chaPiteau ü de quatre
âges de calices de lotus, dont chaque téte est soutenue par trois volutes Le
somks scu,sde m t et ne
Les dix-huit chapiteaux du premier portique sont dans le même cas : mais
comme on 1 a vu, trois d entre eux se retrouvent dans la cour ; il est à remarqué
que ce sont précisément les trois de la façade. Tous ces divers chapiteaux sont
une exécution parfaite, malgré leur énorme proportion : tous les ornemens dont
f sont “ nchis, ont été sculptés avec une extrême délicatesse.
¡ S I 8 genera* deS trente"deUX chaPiteaux du péristyle et des trente chapiteaux
des deux portiques est le même, ainsi que je lai dit, c’est-à-dire, en gorge
c OC e renversee, forme imitée du calice du lotus ou nénuphar II n’y a
d exception que pour le chapiteau daaylïfirmi ou à feuilles de dattier, et pour cedui
qui est le second du péristyle. « pour celui
Ce dernier a déjà sans doute été remarqué à Philæ, à cause de sa figure en ovale
. que, tout-a-fa,t différente du galbe ordinaire. On n’en a pas jusqu’ici reconnu
igine, mais .1 est aise de voir qu’il est, comme les autres, puisé dans la nature I
cest nuage du aiomtm, ou fruit du lotus, décrit par Hérodote, Athénée et
Thepphraste. Il est impossible d’en douter, quand on lit cette phrase où Athénée
parle du abonum : g Sa tete est ronde et ressemble à un guêpier K l ¡„sida caput
»romndovesparumfivo simili, trad .d e Casaubon] (2) . » •
e qui prouve encore parfaitement que ce chapiteau en forme de coupe est
bien limitation de la capsule du lotus, c’est qu’on le voit recouvert tantôt-de
ides étroites et aiguës (3), tantôt de folioles ovoïdes et inégales M É or ces deux
caractères appartiennent exactement-aux fruits du |H MÊM nympZa
' P Au reste’ cette dernière Plante est celle que les Égyptiens ont le plus
souyimj représentée, comme on s’en assure dans lei monumJns encore chargés
-de couleurs, dans les peintures des tombeaux, et dans les papyrus (6)
1H ^ asadg7récieux que 1 H dans Athénée’ pourra fixer les idées du m a 1 egardde 1 ,In,tatIon tlree du lotus. En décrivant le Thalamegon, vaisseau cens-
M W È Ê S k f a i Ü « W M a «a m M d'une salfe exécutée danTL
' M M , ° rnee colonnes- 1 Tout le tour des chapiteaux, dit-il est sem-
- blable a des roses qu, s entrouvrent : au lieu de volutes et de feuilles saillantes
M la ~ e des Grecs, on y voit les calices du lotus aquatique et les jeunes'
» ruits du palmier souvent aussi beaucoup d’espèces différentes de fleurs ; à la base
- o n a sculpte les. fleurs des lotus [ * « „ ] et des feuilles entrelacées, &c h )
description cpneuse peut se vérifier dans les planches de détails.
- ( 0 Voici l’ordre dans lequel les divers chapiteaux de (4) Voyez MU M g , , i
la galerie se repetent en partant du portique et allant vers (t V I d - P H ‘
ia porte du pylône: le t.” , le 3.® le c c le 8 c le 1 1 ‘ , / / ¡ v !‘\ i' i em0,rede M - Savigoy sur le nymphoea
le 1 3 . ' e lle I y s sont pareils; le le et le^ô «sont w ‘ « I < W .
pareiis ; le 7-M e .0.« et le , 4 s le son, aussi vat'ons sor les lotus d Egypte par M. D elile (Annales du
(a) Athen. Deipnos. Iifa. 1 1 , , p. , 2 ' “ d hlst0,re "aturelle).
(3) Voyez pl. 2 , fie 2 ^ sur-tout le papyrus de M. Marcel.
(7) Athen. Deipnos, lib. v , p. 206.
Il ny a donc point de doute sur l’origine, de ces deux chapiteaux. L ’un, en
forme de coupe, est imite du fruit du lotus, comme l’autre, creusé en gorge, est
imité du calice. Celui-ci peut s appeler lotiforme ou loioide, les anciens ayant prin-
, cipalement donné ie nom de lotus à la fleur de la plante; et l’autre, cratériforme ou
•cratéroidi, d’après le nom de vase qu’ils ont donné à la capsule (i). Ce chapiteau
lotoide, quels que soient les ornemens accessoires qui le recouvrent, est d’une
forme invariable, cest-à-dire, en cloche renversée : c’est le plus général de tous;
il est propre à 1 Egypte, et mérite le nom de chapiteau national, ainsi que celui
dont le dattier est le type. G est du lotus que la religion astronomique des Égyptiens
a tiré tant d emblemes, 1 architecture des modèles, la décoration les plus
heureux motifs; et les monumens d’Edfoû, comme tous les autres, sont couve.rts
des feuilles, de la tige, des boutons, des fleurs, des calices et des fruits de cette
plante sacrée.
Je dois rappeler ici une décoration simple et d’un grand style, qui se voit au
dos du temple et au-dedans de l’enceinte (2) : ce sont deux corps de lions qui
semblent sortir de la muraille; ils sont assis sur leurs pattes, entre lesquelles est
une gouttière. La taille en est colossale, et la sculpture très-belle : on sait avec
quelle habileté les Égyptiens ont sculpté les figures d’animaux. Ces deux lions
sont à une distance égale a la largeur du sanctuaire ; la hauteur où ils sont placés,
et la gouttière comprise entre leurs pattes, doivent faire croire qu’ils servoient à
1 écoulement des eaux de la plate-forme : mais je n’en parle ici que sous le rapport
de la décoration.
Ja i dit que tout le temple d’Edfoû est couvert de sculptures. Il n’y a que la
vue des lieux qui puisse donner une idée vraie de cette profusion d’omemens.'
Cette longue enceinte, sur-tout, ornée de bas-reliefs d’un bout à l’autre, au-dedans
et au-dehors, est du plus bel effet; plus basse que le temple, elle paroît de loin
lui servir de base. Au-dedans, l’on se promène entre elle et le temple dans un
espace de près de cent quatre-vingt-quinze mètres de tour (3), ayant sous les
yeux, à droite et a gauche, un mur de treize mètres (4) de haut, couvert de
représentations symboliques et de sujets de toute espèce accompagnés d’une
(1) En étudiant attentivement dans les anciens fa description
des plantes appelées ciborium, lotus, faba Ægyp-
tiaca, & c. pour découvrir les modèles qui ont servi aux
artistes Egyptiens, j’ai cm reconnoître que tous ces noms
appartiennent à. une même plante.
L e nom de ciborium [xi&éetor] me paroît devoir, s’entendre
plus particulièrement de la capsule ou fruit de la
plante, dont les Egyptiens faisoient un vase ou ciboire
imaginant que l’eau du Nil y devenoit délicieuse.
L e nom de faba [wu/at] pourrait s’appliquer aux
graines ou fèves contenues dans les loges de.la capsule.
Colocation [mtouimt] est le nom de la racine • on
sait que ce-nom appartient aujourd’hui à une plante bien
différente, I arum colocasia de Linné.
Enfin, lotus [ » A ] est proprement, selon moi,, le nom
de la fleur : de là vient le nom des couronnes de lotus.
U n est pas étonnant que la plupart des auteurs modernes
aient confondu ces différentes dénominations, et
supposé plusieurs genres de plantes là où il ne s’agit
que d’une seule, puisque les anciens eux-mêmes, qui
avoient donné divers noms aux diverses parties du nym-
phoea, le désignoient indifféremment par l’un d’eux.
Quant au lotus rose des auteurs, on l’a comparé d’une
manière absolue au nélumbo de l’Inde, et l’on a pensé
que celui-ci avoit disparu de l’Égypte; cette opinion est
appuyée sur des preuves et des vraisemblances : mais il reste
encore à expliquer comment Hérodote et tous les auteurs,
a l’exception d’Athénée (liu. x v , p . 6 ? ? ) , ont oublié
le nymphoea azuré, si ancien dans l’Egypte, et si fréquent
sur les monumens, où il est peint avec ses couleurs. La
célèbre mosaïque de Palestrine renferme distinctement ie
nélumbo, comme l’a remarqué M. Delile. Voyez supra,
p .z o , note (j).
(2) Voyez p / .fo , fig. i , et pl. $4.
(3) Plus de six cents pieds.
(4) Quarante pieds.