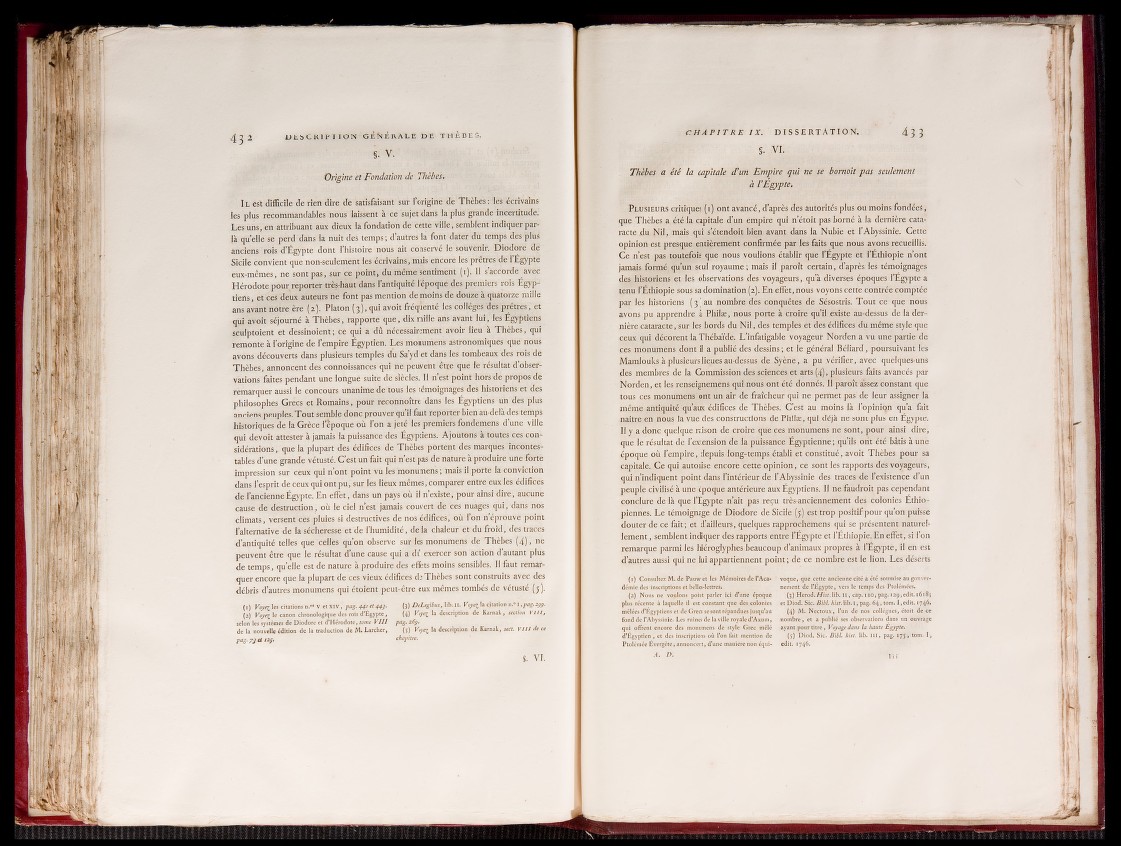
Origine et Fondation de Thèbes.
I l est difficile de rien dire de satisfaisant sur iorigine de Thèbes: les écrivains
les plus recommandables nous laissent à ce sujet dans la plus grande incertitude.
Les uns, en attribuant aux dieux la fondation de cette ville, semblent indiquer par-
là qu’elle se perd dans la nuit des temps ; d autres la font dater du temps des plus
anciens rois d*Égypte dont l’histoire nous ait conserve le souvenir. Diodore de
Sicile convient que non-seulement les écrivains, mais encore les pretres de 1 Égypte
eux-mêmes, ne sont pas, sur ce point, du meme sentiment (i). Il s accorde avec
Hérodote pour reporter très-haut dans l’antiquité 1epoque des premiers rois Egyptiens
et ces deux auteurs ne font pas mention de moins de douze à quatorze mille
ans avant notre ère (2). Platon (3), qui avoit fréquenté les collèges des prêtres, et
qui avoit séjourné à Thèbes, rapporte que, dix mille ans avant lui, les Égyptiens
sculptoient et dessmoient ; ce qui a dû nécessairement avoir lieu à Thèbes, qui
remonte à l’origine de l’empire Égyptien. Les monumens astronomiques que nous
avons découverts dans plusieurs temples du Sa’yd et dans les tombeaux des rois de
Thèbes, annoncent des connoissances qui ne peuvent être que le résultat d’observations
faites pendant une longue suite de siècles. Il n’est point hors de propos de
remarquer aussi le concours unanime de tous les témoignages des historiens et des
philosophes Grecs et Romains, pour reconnoître dans les Égyptiens un des plus
anciens peuples. Tout semble donc prouver qu il faut repoi ter bien au-dela des temps
historiques de la Grèce 1 époque ou 1 on a ¡etc les premiers fondemens d une ville
qui devoit attester à jamais la puissance des Égyptiens. Ajoutons a toutes ces considérations,
que la plupart des édifices de Thebes portent des marques incontestables
d’une grande vétusté. C ’est un fait qui n’est pas de nature à produire une forte
impression sur ceux qui n’ont point vu les monumens ; mais il porte la conviction
dans l’esprit de ceux qui ont pu, sur les lieux mêmes, comparer entre eux les édifices
de l’ancienne Égypte. En effet, dahs un pays où il n’existe, pour ainsi dire, aucune
cause de destruction, où le ciel n’est jamais couvert de ces nuages qui, dans nos
climats, versent ces pluies si destructives de nos édifices,' où l’on n’éprouve point
l’alternative de la sécheresse et de l’humidité, de la chaleur et du froid, des traces
d’antiquité telles que celles qu’on observe sur les monumens de Thèbes (4), ne
peuvent être que le résultat d’une cause qui a dû exercer son action d’autant plus
de temps, qu’elle est de nature à produire des effets moins sensibles. Il faut remarquer
encore que la plupart de ces vieux édifices de Thèbes sont construits avec des
débris d’autres monumens qui étoient peut-être eux mêmes tombés de vétusté (y).
( !) S lÉ É les citations n ." V et x i v , pag. 441 et 443. (3) DeLcgibus, Iib. 11. Voyez la cjtation n.° I .pag.lpp.
(a) Voyez le canon chronologique des rois d'Égypte, (4) Voye^ la description de Karnak, section v m ,
selon les systèmes de Diodore et d’Hérodote, tome V I I I pag. 26p.
de la nouvelle édition de la traduction de M. Larcher, (y) Koyrç la description de Karnak, sect. V l l l de ce
pag. 7y et 12p. chapitre.
S. VI .
s. VI.
Thèbes a été la capitale d ’un Em pire qui ne se bornait pas seulement
à l ’Egypte.
P l u s i e u r s critiques ( i ) ont avancé, d’après des autorites plus ou moins fondées,
que Thèbes a été la capitale d’un empire qui n’étoit pas borné à la dernière cataracte
du Nil, mais qui s’étendoit bien avant dans la Nubie et l’Abyssinie. Cette
opinion est presque entièrement confirmée par les faits que nous avons recueillis.
Ce n’est pas toutefois que nous voulions établir que l’Égypte et i’Éthiopie n’ont
jamais fonné qu’un seul royaume; mais il paroît certain, d’après les témoignages
des historiens et lei observations des voyageurs, qu’à diverses époques l’Égypte a
tenu l’Éthiopie sous sa domination (2). En effet, nous voyons cette contrée comptée
par les historiens (3) au nombre des conquêtes de Sésostris. Tout ce que nous
avons pu apprendre à Philæ, nous porte à croire qu’il existe au-dessus de la dernière
cataracte, sur les bords du Nil, des temples et des édifices du même style que
ceux qui décorent la Thébaïde. L ’infatigable voyageur Norden a vu une partie de
ces monumens dont il a publié des dessins ; et le général Béliard, poursuivant les
Mamlouks à plusieurs lieues au-dessus de Syène, a pu vérifier, avec quelques-uns
des membres de la Commission des sciences et arts (4), plusieurs faits avancés par
Norden, et les renseignemens qui nous ont été donnés. Il paroît assez constant que
tous ces monumens ont un air de fraîcheur qui ne permet pas de leur assigner la
même antiquité qu’aux édifices de Thèbes. C’est au moins là l’opinion qu’a fait
naître en nous la vue des constructions de Philæ, qui déjà ne sont plus en Egypte.
Il y a donc quelque raison de croire que ces monumens ne sont, pour ainsi dire,
que le résultat de l’extension de la puissance Égyptienne ; qu’ils orit été bâtis à une
époque où l’empire, depuis long-temps établi et constitué, avoit Thèbes pour sa
capitale. Ce qui autorise encore cette opinion, ce sont les rapports des voyageurs,
qùi n’indiquent point dans l’intérieur de l’Abyssinie des traces de l’existence d’un
peuple civilisé à une epoque antérieure aux Égyptiens. Il ne faudroit pas cependant
conclure delà que l’Égypte n’ait pas reçu très-anciennement des colonies Ethiopiennes.
Le témoignage de Diodore de Sicile (y) est trop positif pour qu’on puisse
douter de ce fait; et d’ailleurs, quelques rapprochemens qui se présentent naturellement
, semblent indiquer des rapports entre l’Égypte et l’Éthiopie. En effet, si l’on
remarque parmi les hiéroglyphes beaucoup d’animaux propres à l’Egypte, il en est
d’autres aussi qui ne lui appartiennent point ; de ce nombre est le lion. Les désèrts
(1) Consultez M. de Pauw et les Mémoires de I’Aca- 1 voque, que cette ancienne cité a été soumise au gouver-
démie des inscriptions et belles-Iettres» nement de l’Egypte, vers le temps des Ptolémées.
(2) Nous ne voulons point parler ici d’une époque (3) Herod.Hist. Iib. I l , cap. 1 10, pag. I29,edit. 1618;
plus récente à laquelle il est constant que des colonies et Diod. Sic. Bibl. hist. Iib. I , pag. 64, tom. I,ed it. 1746.
mêlées d’Égyptiens et de Grecs se sont répandîtes jusqu’au (4) M. Nectoüx, l’un de nos collègues, étoit de ce
fond de l’Abyssinie. Les ruines de la ville royale d’Axum, nombre, et a publié Ses observations dans un ouvrage
qui offrent encore des monumens de style Grec mêlé ayant pour titre, Voyage dans la haute Egypte.
¿ ’Égyptien , et des inscriptions où l’on fait mention de (5) Diod. Sic. Bibl. hist, lib. n i , pag. 175, tom. I ,
Ptolémée Évergète, annoncent, d’une manière non équi- edit. 1746.
A. D . l ü