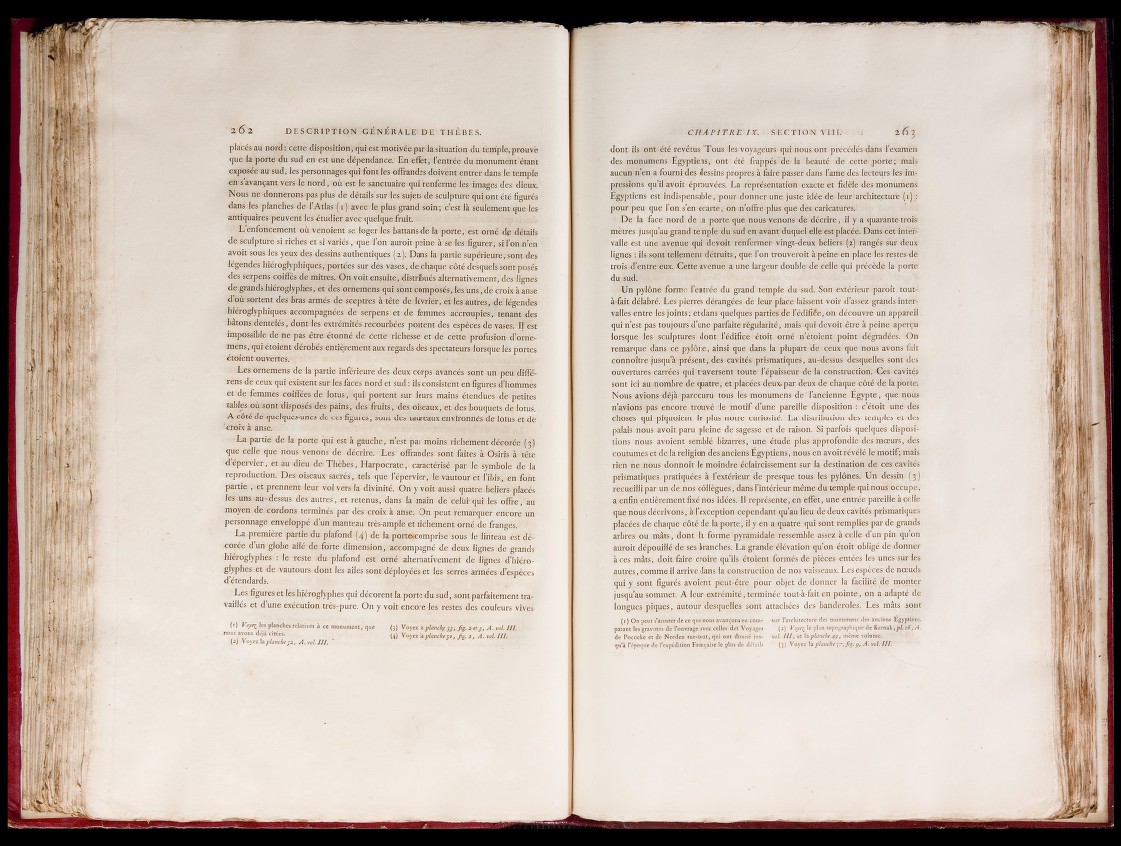
placés au nord : cette disposition, qui est motivée par la situation du temple, prouvé
que la porte du sud en est une dépendance. En effet, l’entrée du monument étant
exposée au sud, les personnages qui font les offrandes doivent entrer dans le temple
en s avançant vers le nord, où est le sanctuaire qui renferme les images des dieux.
Nous ne donnerons pas plus de détails sur les sujets de sculpture qui ont été figurés
dans les planches de l’Atlas ( i ) avec le plus grand soin; c’est là seulement que les
antiquaires peuvent les étudier avec quelque fruit.
L ’enfoncement où venoient se loger les battans de la porte, est orné de détails
de sculpture si riches et si variés, que l’on auroit peine à se les-figurer, si l’on n’en
avoit sous les yeux des dessins authentiques (2). Dans la partie supérieure, sont des
légendes hiéroglyphiques, portées sur des vases , de chaque côté desquels sont posés
des serpens coiffes de mitres. On voit ensuite, distribués alternativement, des lignes
de grands hiéroglyphes, et des omemens qui sont composés, les uns, de croix à anse
d où sortent des bras armés de sceptres à tête de lévrier, et les autres, de légendes
hiéroglyphiques accompagnées de serpens et de femmes accroupies,, tenant des
bâtons dentelés, dont les extrémités recourbées portent des espèces de vases. II est
impossible de ne pas être étonné de cette richesse et de cette profusion d’orner
mens, qui étoient dérobés entièrement aux regards des spectateurs lorsque les portes
étoient ouvertes.
Les omemens de la partie inférieure des deux corps avancés sont un peu diffé-
rens de ceux qui existent sur les faces nord et sud : ils consistent en figures d’hommes
et de femmes coiffées de lotus, qui portent sur leurs mains étendues de petites
tables où sont disposés des pains, des fruits, des oiseaux, et des bouquets de lotus.
A côté de quelques-unes de ces figures, sont des taureaux environnés de lotus et de
’ctoix à anse.
La partie de la porte qui est à gauche, n’est pas moins richement décorée (3)
que celle que nous venons de décrire. Les’ offrandes sont faites à Osiris à tête
dépervier, et au dieu de Thèbes, Harpocrate, caractérisé par le symbole de la
reproduction. Des oiseaux sacrés, tels que l’épervier, le vautour et l’ibis, en font
partie , et prennent leur vol vers la divinité. On y voit aussi quatre beliers placés
les uns au-dessus des autres, et retenus, dans la main de celui'qui les offre, au
moyen de cordons terminés par des croix à anse. On peut remarquer encore un
personnage enveloppé d’un manteau très-ample et richement orné de franges.
La première partie du plafond (4) de la porte«comprise sous le linteau ést décorée
dun globe ailé de forte dimension, accompagné de deux lignes de grands
hiéroglyphes : le reste du plafond est orné alternativement de lignes d’hiéroglyphes
et de vautours dont les ailes sont déployées et les serres armées d’espèces
d’étendards.
Les figures et les hiéroglyphes qui décorent la porte du sud, sont parfaitement travaillés
et d une exécution très-pure. On y voit encore les restes des couleurs vives
( 0 V y i le» planches relatives à ce monument, que (3) Voyez la planche ¡ j , fig. z c t j , A . vol. I I I .
nous’ avons déjà citées. (4) Voyez h planche co. Jig. z . A . vol. I I I .
(z) Voyez la planche g z , A . vol. I I I .
dont ils ont été revêtus. Tous les voyageurs qui nous ont précédés dans l’examen
des monumens Égyptiens, ont été frappés de la beauté de cette porte; mais
aucun n’en a fourni des dessins propres à faire passer dans l’ame des lecteurs les inn
pressions qu’il avoit éprouvées. La représentation exacte et fidèle des monumens
Egyptiens est indispensable, pour donner une juste idée de leur architecture ( il:
pour peu que l’on s’en écarte, on n’offre plus que des caricatures.
De la face nord de la porte que nous venons de décrire, il y a quarante-trois
mètres jusqu’au grand temple du sud en avant duquel elle est placée. Dans cet intervalle
est une avenue qui devoit renfermer vingt-deux beliers (2) rangés sur deux
lignes : ils sont tellement détruits, que l’on trouveroit à peine en place les restes de
trois d’entre eux. Cette avenue a une largeur double de celle qui précède la porte
du sud.
Un pylône forme l’entrée du grand temple du sud. Son extérieur paroît tout-
à-fait délabré. Les pierres dérangées de leur place laissent voir d’assez grands intervalles
entre les joints; et dans quelques parties de l’édifiÎe, on découvre un appareil
qui n’est pas toujours d’une parfaite régularité, mais qui devoit être à peine aperçu
lorsque les sculptures dont l’édifice étoit orné n’étoient point dégradées. On
remarque dans ce pylône, ainsi que dans la plupart de ceux que nous avons fait
connoître jusqu’à présent, des cavités prismatiques, au-dessus desquelles sont des
ouvertures carrées qui traversent toute l’épaisseur de la construction. Ces cavités
sont ici au nombre de quatre, et placées deux.par deux de chaque côté de la porte,
Nous avions déjà parcouru tous les monumens d e ' l’ancienne Egypte, que nous
n’avions pas encore trouvé le motif d’une pareille disposition : c’étoit une des
choses qui piquoient le plus notre curiosité. La distribution des tertiples et des
palais nous avoit paru pleine de sagesse et de raison. Si parfois quelques dispositions
nous avoient semblé bizarres, une étude plus approfondie des moeurs, des
coutumes et de la religion des anciens Égyptiens, nous en avoit révélé le motif; mais
rien ne nous donnoit le moindre éclaircissement sur la destination de ces cavités
prismatiques pratiquées à l’extérieur de presque tous les pylônes. Un dessin (3)
recueilli par un de nos collègues, dans l’intérieur même du temple, qui nous occupe,
a enfin entièrement fixé nos idées. Il représente, en effet, une entrée pareille à celle
que nous décrivons, à l’exception cependant qu’au lieu de deux cavités prismatiques
placées de chaque côté de la porte, il y en a quatre qui sont remplies par de grands
arbres ou mâts, dont la forme pyramidale ressemble assez à celle d’un pin qu’on
auroit dépouillé de ses branches. La grande élévation qu’on étoit obligé de donner
à ces mâts, doit faire croire qu’ils étoient formés de pièces entées les unes sur les
autres, comme il arrive dans la construction de nos vaisseaux. Les espèces de noeuds
qui y sont figurés avoient peut-être pour objet de donner la facilité de monter
jusqu’au sommet. A leur extrémité, tenninée tout-à-fait en pointe-, on a adapté de
longues piques, autour desquelles sont attachées des banderoles. Les mâts sont
(1 ) On peut s’assurer de ce que nous avançons en com- sur l’architecture des monumens des anciens Egyptiens,
parant les gravures de l’ouvrage avec celles des Voyages (2) Voye^ le plan topographique de Karnak ,p l. 16 , A .
de Pococke et de Norden sur-tout, qui ont d'on né jus- vol. I I I , et la planche 49, même volume,
qu’à l’époque de l’expédition Française le plus de détails (3) Voyez la planche y ? , fig. y , A . vol. I I I ,