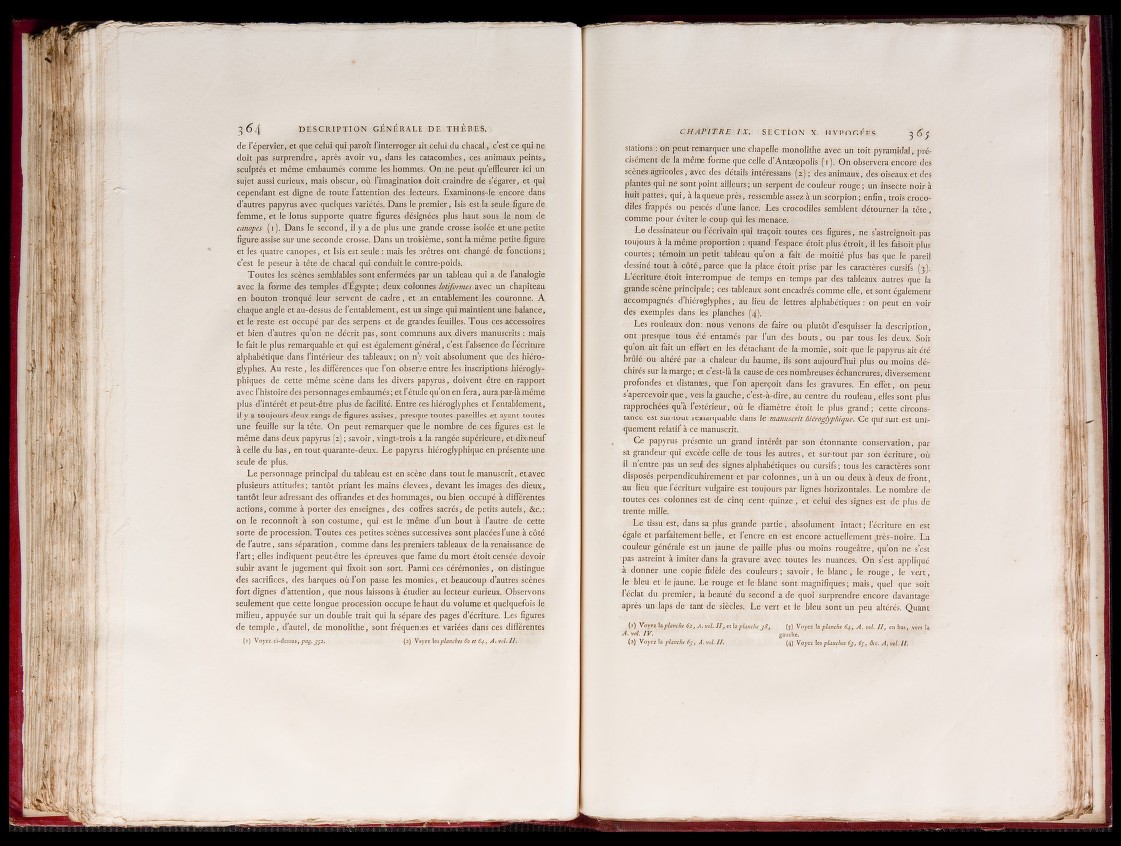
de l’épervier, et que celui qui paroît l’interroger ait celui du chacal, c’est ce qui ne
doit pas surprendre, après avoir vu, dans les catacombes, ces animaux peints,
sculptés et même embaumés comme les hommes. On ne peut qu’effleurer ici un
sujet aussi curieux, mais obscur, où l’imagination doit craindre de s'égarer, et qui
cependant est digne de toute l’attention des lecteurs. Examinons-le encore dans
d’autres papyrus avec quelques variétés. Dans le premier, Isis est la seule figure de
femme, et le lotus supporte quatre figures désignées plus haut sous le nom de
canopes ( 1 ). Dans le second, il y a de plus une grande crosse isolée et une petite
figure1 assise sur une seconde crosse. Dans un troisième, sont la même petite figure
et les quatre canopes, et Isis est seule : mais les prêtres ont changé de' fonctions ;
c’est le peseur à tête de chacal qui conduit le contre-poids.
Toutes les scènes semblables sont enfermées par un tableau qui a de l’analogie
avec la forme des temples d’Egypte ; deux colonnes lotiformes avec un chapiteau
en bouton tronqué leur servent de cadre, et un entablement les couronne; A
chaque angle et au-dessus de l’entablement, est un singe qui maintient une balance,
et le reste est occupé par des serpens et de grandes feuilles. Tous ces accessoires
et bien d’autres qu’on ne décrit pas, sont communs aux divers manuscrits : mais
le fait le plus remarquable et qui est également général, c’est l’absence de l’écriture
alphabétique dans l’intérieur des tableaux ; on n’y voit absolument que des hiéroglyphes.
Au reste, les différences que l’on observe entre les inscriptions hiéroglyphiques
de cette même scène dans les divers papyrus, doivent être en rapport
avec l’histoire des personnages embaumés; et l’étude qu’on en fera, aura par-là même
plus d’intérêt et peut-être plus de facilité. Entre ces hiéroglyphes et l’entablement,
il y a toujours deux rangs de figures assises, presque toutes pareilles et ayant toutes
une feuille sur la tête. On peut remarquer que le nombre de ces figures est le
même dans deux papÿrus (2) ; savoir, vingt-trois à la rangée supérieure, et dix-neuf
à celle du bas, en tout quarante-deux. Le papyrus hiéroglyphique en présente une
seule de plus.
Le personnage principal du tableau est en scène dans tout le manuscrit, etavec
plusieurs attitudes; tantôt priant les mains élevées, devant les images des dieux,
tantôt leur adressant des offrandes et des hommages, ou bien occupé à différentes
actions, comme à porter des enseignes, des coffres sacrés, de petits autels, &c.:
on le reconnoît à son costume, qui est le même d’un bout à l’autre de cette
sorte de procession. Toutes ces petites scènes successives sont placées l’une à côté
de l’autre, sans séparation, comme dans les premiers tableaux de la renaissance de
l’art ; elles indiquent peut-être les épreuves que l’ame du mort étoit censée devoir
subir avant le jugement qui fixoit son sort. Parmi ces cérémonies, on distingue
des sacrifices, des barques où l’on passe les momies, et beaucoup d’autres scènes
fort dignes d’attention, que nous laissons à étudier au lecteur curieux. Observons
seulement que cette longue procession occupe le haut du volume et quelquefois le
milieu, appuyée sur un double trait qui la sépare des pages d’écriture. Les figures
de temple, d’autel, de monolithe, sont fréquentes et variées dans ces différentes
(1) Voyez ci-dessus, pag, 352. (2) Voyez les planches Go et 64, A . vol. I I ,
stations : on peut remarquer une chapelle monolithe avec un toit pyramidal, précisément
de la meme forme que celle d Antæopolis ( 1 ). On observera encore des
scenés agricoles, avec des détails intéressans (2) ; des animaux, des oiseaux et des
plantes qui ne sont point ailleurs; un serpent de couleur rouge ; un insecte noir à
huit pattes, qui, a la queue près, ressemble assez à un scorpion ; enfin, trois crocodiles
frappés ou percés d’une lance. Les crocodiles semblent détourner la tcte,
comme pour éviter le coup qui les menace.
Le dessinateur ou 1 écrivain qui traçoit toutes ces figures, ne s’astreignoiupas
toujours à la même proportion ; quand l’espace étoit plus étroit, il les faisoit plus
courtes; témoin un petit tableau qu’on a fait de moitié plus bas que le pareil
dessiné tout à côté, parce que la place étoit prise par les caractères cursifs (3);
L écriture ctoit interrompue de temps en temps par des tableaux autres que la
grande scene principale ; ces tableaux sont encadrés comme elle, et sont également
accompagnes d hiéroglyphes, au lieu de lettres alphabétiques : on peut en voir
des exemples dans les planches (4).
Les rouleaux dont nous venons de faire ou plutôt d’esquisser la description,
ont presque tous été entamés par l’un des bouts, ou par tous les deux. Soit
quon ait fait un effort en les détachant de la momie, soit que le papyrus ait été
brûle ou altere par la chaleur du baume, ils sont aujourd’hui plus ou moins déchires
sur la marge; et c est-là la cause de ces nombreuses échancrures, diversement
profondes et distantes, que l’on aperçoit dans les gravures. En effet, on peut
s’apercevoir que, vers la gauche, c’est-à-dire, au centre du rouleau, elles sont plus
rapprochées qua l’extérieur, où le diamètre étoit le plus grand ; cette circonstance
est sur-tout remarquable dans Je manuscrit hiéroglyphique. Ce qui suit est uniquement
relatif à ce manuscrit.
Ce papyrus présente un grand intérêt par son étonnante conservation, paisa
grandeur qui excède celle de tous les autres, et sur-tout par son écriture, où
il n entre pas un seul des signes alphabétiques ou cursifs ; tous les caractères sont
disposés perpendiculairement et par colonnes, un à un ou deux à deux de front,
au lieu que l’écriture vulgaire est toujours par lignes horizontales. Le nombre de
toutes ces colonnes est de cinq cent quinze, et celui des signes est de plus de
trente mille.
Le tissu est, dans sa plus grande partie, absolument intact ; l’écriture en est
égale et parfaitement belle, et l’encre en est encore actuellement ^très-noire. La
couleur générale est un jaune de paille plus ou moins rougeâtre, qu’on ne s’est
pas astreint à imiter dans la gravure avec toutes les nuances. On s’est appliqué
à donner une copie fidèle des couleurs ; savoir, le blanc , le rouge, le vert,
le bleu et le jaune. Le rouge et le blanc sont magnifiques; mais, quel que soit
1 éclat du premier, la beauté du second a de quoi surprendre encore davantage
après un laps de tant de siècles. Le vert et le bleu sont un peu altérés. Quant
H Voyez la planche 62, A . vol. I I , et la planche 3 8 , (3) Voyez la planche 64, A . vol. I I , en bas, vers la
A . val. IV . gauche.
(2) Voyez la planche 63, A . vol. I I . (4) Voyez les planches 63, 6 j, ôcc. A . vol. I I ,