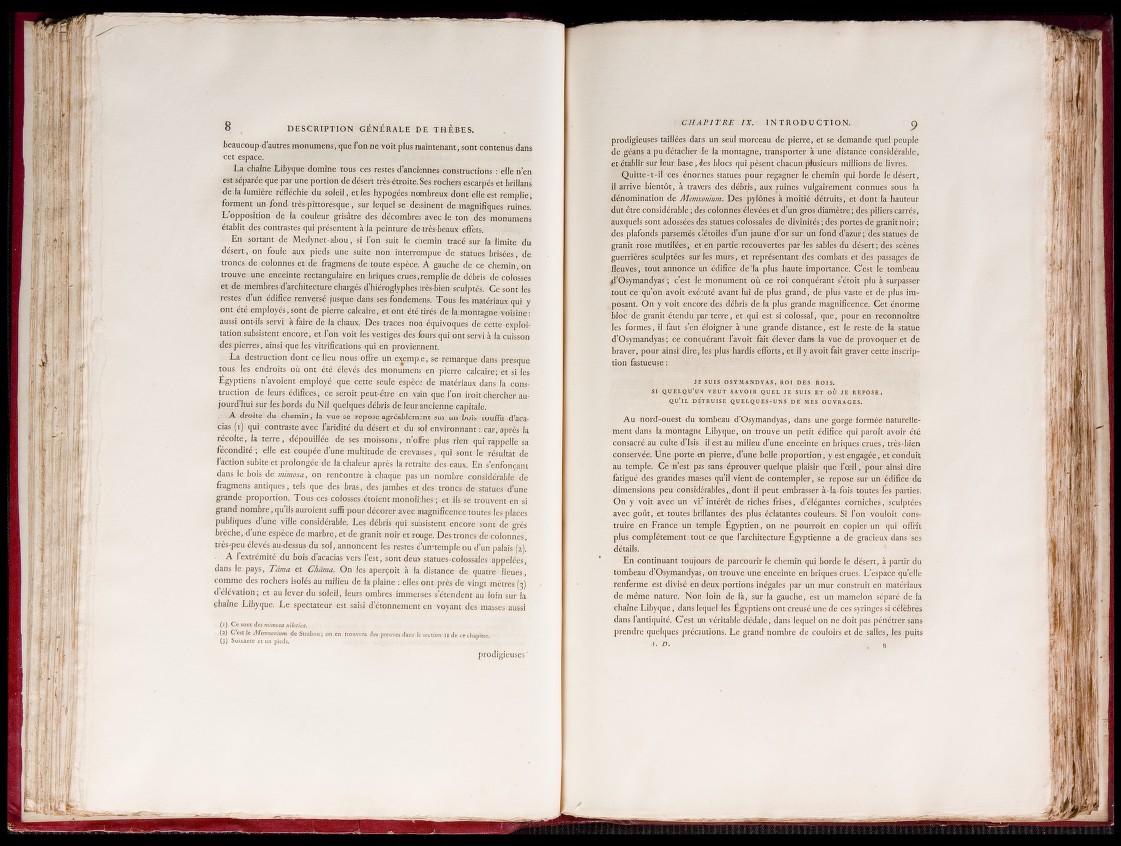
beaucoup d’autres monumens, que l’on ne voit plus maintenant, sont contenus dans
cet espace.
La chaîne Libyque domine tous ces restes d’anciennes constructions : elle n’en
est séparée que par une portion de désert très-étroite. Ses rochers escarpés et brillans
de la lumière réfléchie du soleil, et les hypogées nombreux dont elle est remplie,
forment un fond- très-pittoresque, sur lequel se dessinent de magnifiques ruines.
L ’opposition de la couleur grisâtre des décombres avec le ton des monumens
établit des contrastes qui présentent à la peinture de très-beaux effets.
En sortant de Medynet-abou, si l’on suit le chemin tracé sur la limite du
désert, on foule aux pieds une suite non interrompue de statues brisées, de
troncs de colonnes et de fragmens de toute espèce. A gauche de ce chemin, on
trouve une enceinte rectangulaire en briques crues, remplie de débris de colosses
et de membres d’architecture chargés d’hiéroglyphes très-bien sculptés. Ce sont les
restes d’un édifice renversé jusque dans ses fondemens. Tous les matériaux qui y
ont été employés, sont de pierre calcaire, et ont été tirés de la montagne voisine:
aussi ont-ils servi à faire de la chaux. Des traces non équivoques de cette exploitation
subsistent encore, et l’on voit les vestiges des fours qui ont servi à la cuisson
des pierres, ainsi que les vitrifications qui en proviennent.
La destruction dont ce lieu nous offre un exemple, se remarque dans presque
tous les endroits où ont été élevés des monumens en pierre calcaire; et si les
Egyptiens n’avoient employé que cette seule espèce de matériaux dans la construction
de leurs édifices, ce seroit peut-être en vain que l'on irait chercher au-
jourd hui sur les bords du Nil quelques débris de leur ancienne capitale,
A droite du chemin, la vue se repose agréablement sur un bois touffu d’acacias
(i) qui contraste avec l’aridité du désert et du sol environnant : car, après la
récolte, la terre, dépouillée de ses moissons, n’offre plus rien qui rappelle sa
fécondité ; elle est coupée d’une multitude de crevasses, qui sont le résultat de
l’action subite et prolongée de la chaleur après la retraite des eaux. En s’enfonçant
dans le bois de mimosa, on rencontre à chaque pas un nombre considérable de
fragmens antiques, tels que des bras, des jambes et des troncs de statues d’une
grande proportion. Tous ces colosses étoient monolithes ; et ils se trouvent en si
grand nombre, qu ils auroient suffi pour décorer avec magnificence toutes les places
publiques dune ville considérable. Les débris qui subsistent encore sont de grès
brèche, d’une espèce de marbre, et de granit noir et rouge. Des troncs de colonnes,
très-peu élevés au-dessus du sol, annoncent les restes d’un-temple ou d’un palais (2).
A 1 extrémité du bois dacacias vers l’est, sont deux statues-colossales appelées,
dans le pays, Tâma et Châma. On les aperçoit à la distance de quatre lieues,
comme des rochers isolés au milieu de la plaine : elles ont près de vingt mètres (3)
d élévation; et au lever du soleil, leurs ombres immenses s’étendent au loin sur la
çhaine Libyque. Le spectateur est saisi d’étonnement en voyant des masses aussi
: (?) Ce sont des mimosa nilotica.
.(?) C’est .le Alrmnoiùum de Strabon ; on en trouvera des preuves dans la section II de ce chapitre.
(3). Soixante et un pieds.
prodigieuses '
prodigieuses taillées dans un seul morceau de pierre, et se demande quel peuple
de géans a pu détacher de la montagne, transporter à une distance considérable,
et établir sur leur base, des blocs qui pèsent chacun plusieurs millions de livres.
Quitte-t-il ces énormes statues pour regagner le chemin qui borde le désert,
il arrive bientôt, à travers des débris, aux ruines vulgairement connues sous la
dénomination de Memnonium. Des pylônes à moitié détruits, et dont la hauteur
dut être considérable ; des colonnes élevées et d’un gros diamètre; des piliers carrés,
auxquels sont adossées des statues colossales de divinités ; des portes de granit noir ;
des plafonds parsemés diétoiles d’un jaune d’or sur un fond d’azur ; des statues de
granit rose mutilées, et en partie recouvertes par les sables du désert; des scènes
guerrières sculptées sur les murs, et représentant des combats et des passages de
fleuves, tout annonce un édifice de'la plus haute importance. C’est le tombeau
d ’Osymandyas ; c’est le monument où ce roi conquérant s’étoit plu à surpasser
tout ce qu’on avoit exécuté avant lui de plus grand, de plus vaste et de plus imposant.
On y voit encore des débris de la plus grande magnificence. Cet énorme
bloc de granit étendu par terre, et qui est si colossal, que, pour en reconnoître
les formes, il faut s’en éloigner à une grande distance, est le reste de la statue
d’Osymandyas ; ce conquérant l’avoit fait élever dans la vue de provoquer et de
braver, pour ainsi dire, les plus hardis efforts, et il y avoit fait graver cette inscription
fastueuse :
J E SU IS OSŸ M AND Y AS , ROI D E S RO IS .
S I q u e l q u ' u n v e u t s a v o i r q u e l j e s u i s e t o ù j e r e p o s e ,
q u ’ i l d é t r u i s e q u e l q u e s - u n s d e m e s o u v r a g e s .
Au nord-ouest du tombeau d’Osymandyas, dans une gorge formée naturellement
dans la montagne Libyque, on trouve un petit édifice qui paraît avoir été
consacré au culte d’Isis; il est au milieu d’une enceinte en briques crues, très-bien
conservée. Une porte en pierre, d’une belle proportion, y est engagée, et conduit
au temple. Ce n’est pas sans éprouver quelque plaisir que l’oeil, pour ainsi dire
fatigué des grandes masses qu’il vient de contempler, se repose sur un édifice de
dimensions peu considérables,.dont il peut embrasser à-la-fois toutes les parties.
On y voit avec un vif intérêt de riches frises, d’élégantes corniches/sculptées
avec goût, et toutes brillantes des plus éclatantes couleurs. Si l’on vouloit construire
en France un temple Egyptien, on ne pourrait en copier un qui offrit
plus complètement tout ce que l’architecture Egyptienne a de gracieux dans ses
détails.
En continuant toujours de parcourir le chemin qui borde le désert, à partir du
tombeau d’Osymandyas, on trouve une enceinte en briques crues. L ’espace qu’elle
renferme est divisé en deux portions inégales par un mur construit en matériaux
de même nature. Non loin de là, sur la gauche, est un mamelon séparé de la
chaîne Libyque, dans lequel les Égyptiens ont creusé une de ces syringes si célèbres
dans l’antiquité. C’est un véritable dédale, dans lequel on ne doit pas pénétrer sans
prendre quelques précautions. Le grand nombre de couloirs et de salles, les puits
A. D . i;