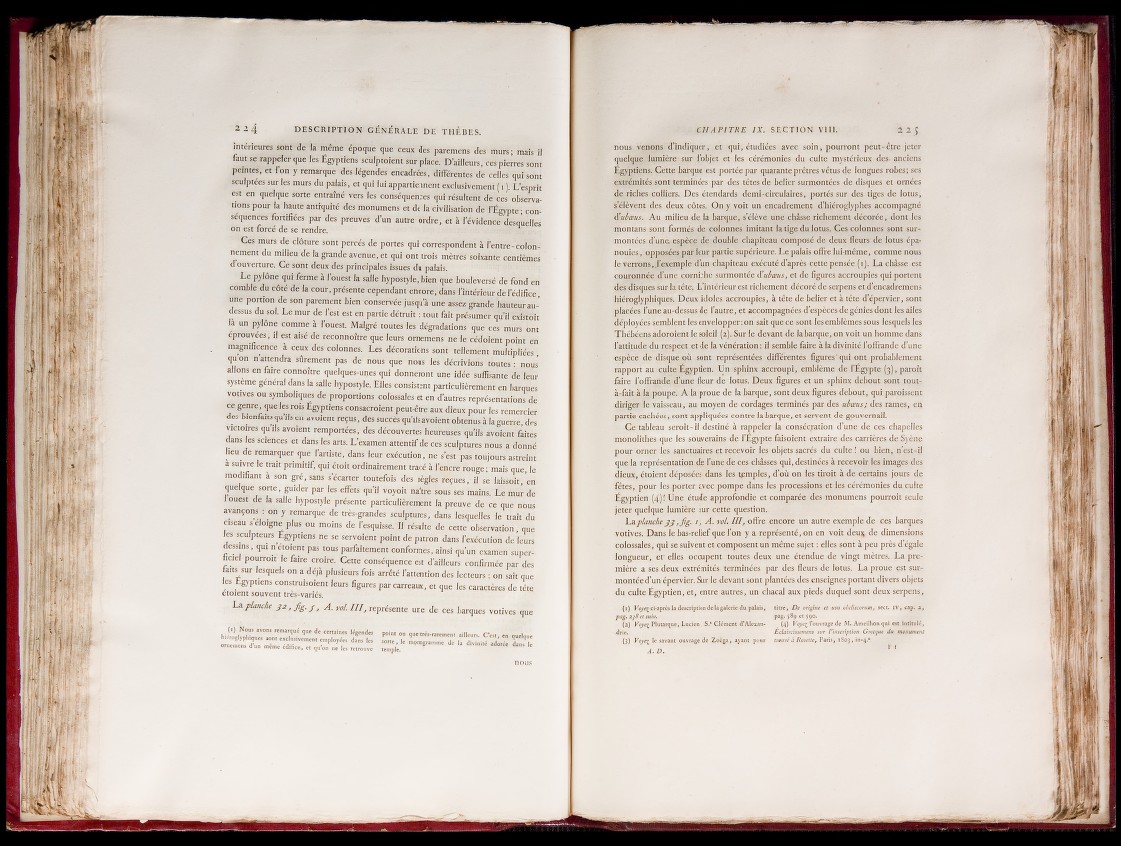
intérieures sont de la même époque que ceux des paremens des murs; mais il
faut se rappeler que les Egyptiens sculptoient sur place. D’ailleurs, ces pierres sont
peintes, et l’on y remarque des légendes encadrées, différentes de celles qui sont
sculptées sur les murs du palais, et qui lui appartiennent exclusivement ( i ). L ’esprit
est en quelque sorte entraîné vers les conséquences qui résultent de ces observations
pour la haute antiquité des monumens et de la civilisation de l’Égypte ; conséquences
fortifiées par des preuves d’un autre ordre, et à l’évidence desquelles
on est forcé de se rendre. .
Ces murs de clôture sont percés de portes qui correspondent à l’entre-colon-
nement du milieu de la grande avenue, et qui ont trois mètres soixante centièmes
d ouverture. Ce sont deux des principales issues du palais.
Le pylône qui ferme à 1 ouest la salle hypostyle, bien que bouleversé de fond en
comble du côte de la cour, présente cependant encore, dans l’intérieur dé l’édifice
une portion de son parement bien conservée jusqu’à une assez grande hauteur au-
dessus du sol. Le mur de l’est est en partie détruit : tout fait présumer qu’il existoit
la un pylône comme à l’ouest. Malgré toutes les dégradations que ces murs ont
éprouvées, il est aisé de reconnoître que leurs ornemens ne le cédoient point en
magnificence à ceux des colonnes. Les décorations sont tellement multipliées
quon n’attendra sûrement pas de nous que nous les décrivions toutes: nous’
allons en faire connoître quelques-unes qui donneront une idée suffisante de leur
système général dans la salle hypostyle. Elles consistent particulièrement en barques
votives ou symboliques de proportions colossales et en d’autres représentations de
ce genre que les rois Egyptiens consacroient peut-être aux dieux pour les remercier
des bienfaits qu ils en avoient reçus, des succès qu’ils avoient obtenus à la guerre, des
victoires quils avoient remportées, des découvertes heureuses qu’ils avoient ¿ites
dans les sciences et dans les arts. L ’examen attentif de ces sculptures nous a donné
heu de remarquer que l’artiste, dans leur exécution, ne s’est pas toujours astreint
a suivre le trait primitif, qui étoit ordinairement tracé à l’encre rouge; mais que, le
modifiant à son gré, sans s’écarter toutefois des règles reçues, il se Jaissoit,’en
quelque sorte, guider par les effets qu’il voyoit naître sous ses mains. Le mur de
ouest de la salle hypostyle présente particulièrement la preuve de ce que nous
avançons : on y remarque de très-grandes sculptures, dans lesquelles le trait du
ciseau s éloigné plus ou moins de l’esquisse. Il résulte de cette observation, que
les sculpteurs Egyptiens ne se servoient point de patron dans l’exécution de leurs
dessins, qui n étoient pas tous parfaitement conformes, ainsi qu’un examen superficiel
pourroit le faire croire. Cette conséquence est d’ailleurs confirmée par des
faits sur lesquels on a déjà plusieurs fois arrêté l’attention des lecteurs : on sait que
es Egyptiens construisoient leurs figures par carreaux, et que les caractères de tête
ctoient souvent très-variés.
La planche 3 2 , fig . 3 , A . vol. I I I , représente une de ces barques votives que
nous
nous venons d’indiquer, et qui, étudiées avec soin, pourront peut-être jeter
quelque lumière sur l’objet et les cérémonies du culte mystérieux des. anciens
Égyptiens. Cette barque est portée par quarante prêtres vêtus de longues robes; ses
extrémités sont terminées par des têtes de belier surmontées de disques et ornées
de riches colliers. Des étendards demi-circulaires, portés sur des tiges de lotus,
s’élèvent des deux côtés. On y voit un encadrement d’hiéroglyphes accompagné
d’ubæus. Au milieu de la barque, s’élève une châsse richement décorée, dont les
montans sont formés de colonnes imitant la tige du lotus. Ces colonnes sont surmontées
d’une, espèce de double chapiteau composé de deux fleurs de lotus épanouies
, opposées par leur partie supérieure. Le palais offre lui-même, comme nous
le verrons,.l’exemple d’un chapiteau exécuté d’après cette pensée (1). La châsse est
couronnée d’une corniche surmontée d’ubæus, et de figures accroupies qui portent
des disques sur la tête. L ’intérieur est richement décoré de serpens et d’encadremens
hiéroglyphiques. Deux idoles accroupies, à tête de belier et à tête d épervier, sont
placées l’une au-dessus de l’autre, et accompagnées d’espèces de génies dont les ailes
déployées semblent les envelopper: on sait que ce sont les emblèmes sous lesquels les
Thébéens adoroient le soleil (2). Sur le devant de la barque, on voit un homme dans
l’attitude du respect et de la vénération : il semble faire à la divinité l’offrande d’une
espèce de disque où sont représentées différentes figures ' qui ont probablement
rapport au culte Égyptien. Un sphinx accroupi, emblème de l’Égypte (3), paroît
faire l’offrande d’une fleur de lotus. Deux figures et un sphinx debout sont tout-
à-fait à la poupe. A la proue de la barque, sont deux figures debout, qui paroissent
diriger le vaisseau, au moyen de cordages terminés par des ubæus; des rames, en
partie cachées, sont appliquées contre la barque, et servent de gouvernail.
Ce tableau seroit-il destiné à rappeler la consécration d’une de ces chapelles
monolithes que les souverains de l’Egypte faisoient extraire des carrières de Syène
pour orner les sanctuaires et recevoir les objets sacrés du culte ! ou bien, n’est-il
que la représentation de l’une de ces châsses qui, destinées à recevoir les images des
dieux, étoient déposées dans les temples, d’où on les droit à de certains jours de
fêtes, pour les porter avec pompe dans les processions et les cérémonies du culte
Égyptien (4)! Une étude approfondie et comparée des monumens pourroit seule
jeter quelque lumière sur cette question.
La planche 3 3 ,fig . / , A . vol. III, offre encore un autre exemple de ces barques
votives. Dans le bas-relief que l’on y a représenté, on en voit deu* de dimensions
colossales, qui se suivent et composent un même sujet : elles sont à peu près d’égale
longueur, et' elles occupent toutes deux une étendue de vingt mètres. La première
a ses deux extrémités terminées par des fleurs de lotus. La proue est surmontée
d’un épervier. Sur le devant sont plantées des enseignes portant divers objets
du culte Égyptien, et, entre autres, un chacal aux pieds duquel sont deux serpens,
(1) Voyez ci-après la description de la galerie du palais, titre, De origine et usu obeliscorum, sect. I V , cap. 2 ,
pcig. 2 j8 et suiv. pag. 589 et 590.
(2) Voye% Plutarque, Lucien, S.* Clément d’AIexan- (4) Voyez l’ouvrage de M. Anieilhon qui est intitulé,
.drie. Eclaircissemens sur l'inscription Grecque du monument
(3) Voyez le savant ouvrage de Zo ëga, ayant pour trouvé à Rosette, Paris, 18 0 3, in-4.0
A . D . F 1