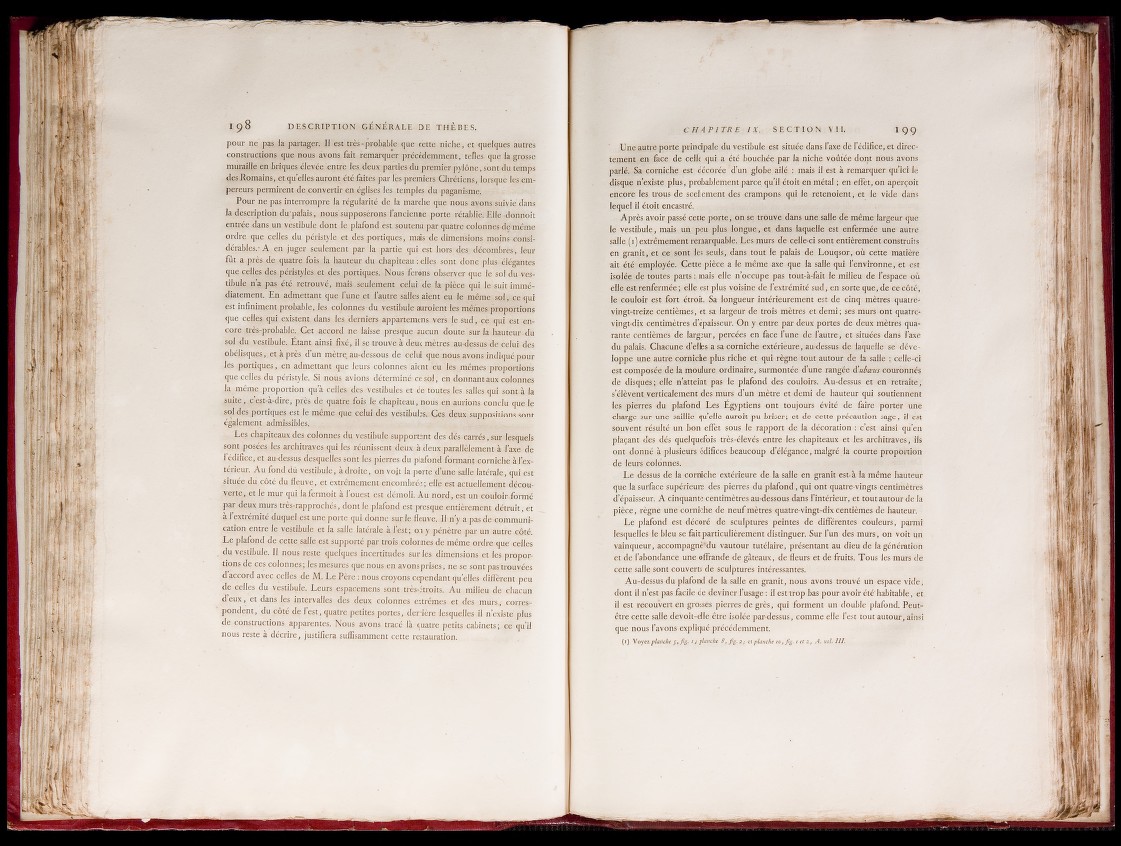
pour ne pas. la partager. Il est très-probable que cette niche, et quelques autres
constructions que nous àvons fait remarquer précédemment, telles que la grosse
muraille en briques élevée entre les deux parties du premier pylône, sont du temps
des Romains, et quelles auront été faites par les premiers Chrétiens, lorsque les empereurs
permirent de convertir en églises les temples du paganisme.
Pour ne pas interrompre la régularité de la marche que nous avons suivie dans
la description du'palais, nous'supposerons l’ancienne porte rétablie. Elle donnoit
ennée dans un vestibule dont le plafond est. soutenu par quatre colonnes de même
ordre que celles du péristyle et des portiques, mais de dimensions moins considérables.
A en juger seulement par la partie qui est hors des décombres, leur
fût a près de quatre fois la hauteur du chapiteau : elles sont donc plus élégantes
que celles des péristyles et des portiques. Nous ferons observer que le sol du vestibule
n’a pas été retrouvé, mais seulement celui de la pièce qui le-suit immédiatement.
En admettant que l’une et l’autre salles aient eu le même sol, ce qui
est infiniment probable, les colonnes du vestibule auroient les mêmes proportions
que celles qui existent dans les derniers appàrtemens vers le sud, ce qui est encore
très-probable. Cet accord ne laisse presque aucun doute sur la hauteur du
sol du vestibule. Etant ainsi fixé, il se trouve à deux mètres au-dessus de celui des
obélisques,.« après d’un mètre, au-dessous de celui que nous avons indiqué pour
les portiques, en admettant que leurs colonnes aient eu les mêmes proportions
que celles du péristyle. Si nous avions déterminé ce sol, en donnant aux colonnes
la même proportion qu’à celles des vestibules et de toutes les salles qui sont à la
suite, c est-à-dire, près de quatre fois le chapiteau, nous en aurions conclu que le
sol des portiques est le meme que celui des vestibules. Ces deux suppositions sont
également admissibles.
Les chapiteaux des colonnes du vestibule supportent des dés carrés, sur lesquels
sont posees les architraves qui les réunissent deux à deux parallèlement à l’axe de
1 édifice, et au-dessus desquelles sont les pierres du plafond formant corniche à l’extérieur.
Au fond dû vestibule, à droite, on vojt la porte d’une salle latérale, qui est
située du côté du fleuve, et extrêmement encombrée; elle est actuellement découverte,
et le mur qui lafermoit a 1 ouest est démoli. Au nord, est un couloir .formé
par deux murs tres-rapproches, dont le plafond est presque entièrement détruit, et
à 1 extrémité duquel est une porte qui donne sur le fleuve. Il n’y a pas de communication
entre le vestibule et la salle latérale a lest; on y pénètre par un autre .côté.
Le plafond de cette salle est supporté par trois colonnes de même ordre que celles
du vestibule. Il nous reste quelques incertitudes sur les dimensions et les proportions
de ces colonnes ; les mesures que nous en avons prises, ne se sont pas trouvées
d accord avec celles de M. Le Père : nous croyons cependant qu’elles diffèrent peu
de celles du vestibule. Leurs espacemens sont très-étroits. Au milieu de chacun
d eux, et dans les intervalles des deux colonnes extrêmes et des murs, correspondent,
du cote de 1 est, quatre petites portes, derrière lesquelles il n’existe plus
de constructions apparentes. Nous avons tracé là quatre petits cabinets; ce qu’il
nous reste à décrire, justifiera suffisamment cette restauration.
Une autre porte principale du vestibule est située dans l’axe de 1 édifice, et directement
en fàce de celle qui a été bouchée par la niche voûtée dont nous avons
parlé. Sa corniche est décorée d’un globe ailé : mais il est à remarquer qu’ici le
disque n’existe plus, probablement parce qu’il étoit en métal ; en effet, on aperçoit
encore les trous de scellement des crampons qui le retenoient, et le vide dans
lequel il étoit encastré.
Après avoir passé cette porte, on se trouve dans une salle de même largeur que
le vestibule, mais un peu plus longue, et dans laquelle est enfermée une autre
salle (1) extrêmement remarquable. Les murs de celle-ci sont entièrement construits
en granit, et ce sont les seuls, dans tout le palais de Louqsor, où cette matière
ait été employée. Cette pièce a le même axe que la salle qui l’environne, et est
isolée de toutes parts : mais elle n’occupe pas tout-à-fait le milieu de l’espace où
elle est renfermée; elle est plus voisine de l’extrémité sud, en sorte que, de ce côté,
le couloir est fort étroit. Sa longueur intérieurement est de cinq mètres quatre-
vingt-treize centièmes, et sa largeur de trois mètres et demi; ses murs ont quatre-
vingt-dix centimètres d’épaisseur. On y entre par deux portes de deux mètres quarante
centièmes de largeur, percées en face l’une de l’autre, et situées dans l’axe
du palais. Chacune d’elles a sa corniche extérieure, au-dessus de laquelle se développe
une autre corniche plus riche et qui règne tout autour de la salle : celle-ci
est composée de la moulure ordinaire, surmontée d’une rangée d’ubæus couronnés
de disques; elle n’atteint pas le plafond des couloirs. Au-dessus et en retraite,
s’élèvent verticalement des murs d’un mètre et demi de hauteur qui soutiennent
les pierres du plafond. Les Egyptiens ont toujours évité de faire porter une
charge sur une saillie qu’elle auroit pu briser; et de cette précaution sage, il est
souvent résulté un bon effet sous le rapport de la décoration : c’est ainsi qu’en
plaçant des dés quelquefois très-élevés entre les chapiteaux et les architraves, ils
ont donné à plusieurs édifices beaucoup d’élégance, malgré la courte proportion
de leurs colonnes.
L e dessus de la corniche extérieure de la salle en granit es t. à la même hauteur
que la surface supérieure des pierres du plafond, qui ont quau-e-vingts centimètres
d’épaisseur. A cinquante centimètres au-dessous dans l’intérieur, et tout autour de la
pièce, règne une corniche de neuf mètres quatre-vingt-dix centièmes de hauteur.
Le plafond est décoré de sculptures peintes de différentes couleurs, parmi
lesquelles le bleu se fait particulièrement distinguer. Sur l’un des murs, on voit un
vainqueur, accompagné’ du vautour tutélaire, présentant au dieu de la génération
et de l’abondance une offrande de gâteaux, de fleurs et de fruits. Tous les murs de
cette salle sont couverts de sculptures intéressantes.
Au-dessus du plafond de la salle en granit, nous avons trouvé un espace vide,
dont il n’est pas facile de deviner l’usage : il est trop bas pour avoir été' habitable, et
il est recouvert en grosses pierres de grès, qui forment un double plafond. Peut-
être cette salle devoit-elle être isolée par-dessus, comme elle l’est tout autour, ainsi
que nous l’avons expliqué précédemment.
(1) Voyez planche * i planche 8, fig. 2 ; et planche io ,fig . 1 et 2 , A . vol. I I I .