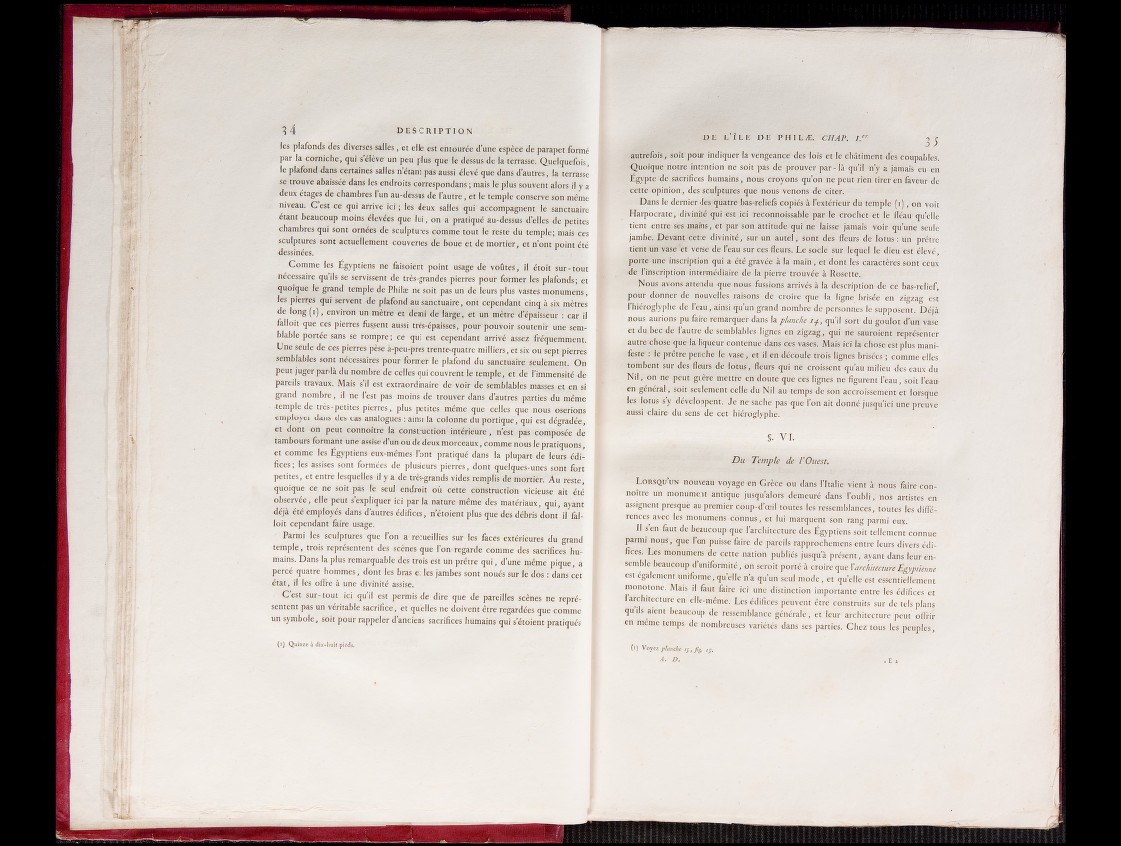
les plafonds des diverses salles, et elle est entourée d’une espèce de parapet formé
par la corniche, qui s éleve" un peu plus que le dessus de la terrasse. Quelquefois,
le plafond dans certaines salles n’étant pas aussi élevé que dans d’autres, la terrasse
se trouve abaissée dans les endroits correspondant ; mais le plus souvent alors il y a
deux etages de chambres 1 un au-dessus de l’autre, et le temple conserve son même
niveau. C est ce qui arrive ici ; les deux salles qui accompagnent le sanctuaire
étant beaucoup moins élevées que lui, on a pratiqué au-dessus d’elles de petites
chambres qui sont ornées de sculptures comme tout le reste du temple; mais ces
sculptures sont actuellement couvertes de boue et de mortier, et n’ont point été
dessinées.
Comme les Egyptiens ne fàisoient point usage de voûtes, il étoit sur-tout
nécessaire quils se servissent de très-grandes pierres pour former les plafonds; et
quoique le grand temple de Philæ ne soit pas un de leurs plus vastes monumens,
les pierres qui servent de plafond au sanctuaire, ont cependant cinq à six mètres
de long ( i) , environ un mètre et demi de large, et un mètre d’épaisseur : car il
falloit que ces pierres fùs.sent aussi très-épaisses, pour pouvoir soutenir une semblable
portée sans se rompre ; ce qui est cependant arrivé assez fréquemment.
Une seule de ces pierres pèse à-peu-près trente-quatre milliers, et six ou sept pierres
semblables sont nécessaires pour former le plafond du sanctuaire seulement. On
peut juger par-là du nombre de celles qui couvrent le temple, et de l’immensité de
pareils travaux. Mais s’il est extraordinaire de voir de semblables masses et en si
grand nombre, il ne l’est pas moins de trouver dans d’autres parties du même
-temple de très-petites pierres , plus petites même que celles que nous oserions
employer dans des cas analogues : ainsi la colonne du portique, qui est dégradée,
et dont on peut connoitre la construction intérieure , n’est pas composée de
tambours formant une assise d un ou de deux morceaux, comme nous le pratiquons,
et comme les Égyptiens eux-meroes 1 ont pratiqué dans la plupart de leurs édifices;
les assises sont formées de plusieurs pierres, dont quelques-unes sont fort
petites, et entre lesquelles il y a de très-grands vides remplis de mortier. Au reste,
quoique ce ne soit pas le seul endroit où cette construction vicieuse ait été
observée, elle peut s expliquer ici par la nature même des matériaux, qui, ayant
déjà été employés dans d’autres édifices, n’étoient plus que des débris dont il falloit
cependant faire usage.
Parmi les sculptures que l’on a recueillies sur les faces extérieures du grand
temple, trois représentent des scènes que l’on regarde comme des sacrifices humains.
Dans la plus remarquable des trois est un prêtre qui, d’une même pique, a
percé quatre hommes, dont les bras et les jambes sont noués sur le dos ; dans cet
état, il les offre à une divinité assise.
C ’est sur-tout ici qu’il est permis de dire que de pareilles scènes ne représentent
pas un véritable sacrifice, et qu’elles ne doivent être regardées que comme
un symbole, soit pour rappeler d’anciens sacrifices humains qui s’étoient pratiqués
(i) Quinze à dix-huit pieds.
d e l ’ î l e d e p h i l æ . c h a p . I e j )
autrefois, soit pour indiquer la vengeance des lois et le châtiment des coupables.
Quoique notre intention ne soit pas de prouver par - là qu’il n’y a jamais eu en
Egypte de sacrifices humains, nous croyons qu’on ne peut rien tirer en faveur de
cette opinion, des sculptures que nous venons de citer.
Dans le dernier des quatre bas-reliefs copiés à l’extérieur du temple ( i) , on voit
Harpocrate, divinité qui est ici reconnoissabie par le crochet et le fléau qu’elle
tient entre ses mains, et par son attitude qui ne laisse jamais voir qu’une seule
jambe. Devant cette divinité, sur un autel, sont des fleurs de lotus: un prêtre
tient un vase 'et verse de l’eau sur ces fleurs. Le socle sur lequel le dieu est élevé,
porte une inscription qui a été gravée à la main, et dont les caractères sont ceux
de l’inscription intermédiaire de la pierre trouvée à Rosette..
Nous avons attendu que nous fussions arrivés à la description de ce bas-relief,
pour donner de nouvelles raisons de croire que la ligne brisée en zigzag est
l’hiéroglyphe de l’eau, ainsi qu’un grand nombre de personnes le supposent. Déjà
nous aurions pu faire remarquer dans la planche 14 , qu’il sort du goulot d’un vase
et du bec de l’autre de semblables lignes en zigzag, qui fle sauroient représenter
autre chose que la liqueur contenue dans ces vases. Mais ici la chose est plus manifeste
: le prêtre penche le vase, et il en découle trbis lignes brisées ; comme elles
tombent sur des fleurs de lotus, fleurs qui ne croissent qu’au milieu des eaux du
N il, on ne peut guère mettre en doute que ces lignes né figurent l’eau, soit l’ean
en général, soit seulement celle du Nil au temps de son accroissement et lorsque
les lotus sy développent. Je ne sache pas que l’on ait donné jusqu’ici une preuve
aussi claire du sens de cet hiéroglyphe.
§. V I .
D u Temple de l ’Ouest.
L o r s q u ’u n nouveau voyage en Grèce ou dans l’Italie vient à nous faire con-
noitre un monument antique jusqu’alors demeuré dans l’oubli, nos artistes en
assignent presque au premier coup-d’oeil toutes les ressemblances, toutes les différences
avec les monumens connus, et lui marquent son rang parmi eu*.
Il s en faut de beaucoup que 1 architecture des Égyptiens soit tellement connue
parmi nous, que Ion puisse faire de pareils rapprochemens entre leurs divers édifices.
Les monumens de cette nation publiés jusqu’à présent, ayant dans leur ensemble
beaucoup d’uniformité, on seroit porté à croire que l’architecture Égyptienne
est également uniforme, qu’elle n’a qu’un seul mode, et qu’elle est essentiellement
monotone. Mais il faut faire ici une distinction importante entre les édifices et
1 architecture en elle-même. Les édifices peuvent être construits sur de tels plans
qu ils aient beaucoup de ressemblance générale, et leur architecture peut offrir
en même temps de nombreuses variétés dans ses parties. Chez tous les peuples,
0 ) Voyez planche i j , fîg. 7r.
A . D . . E a