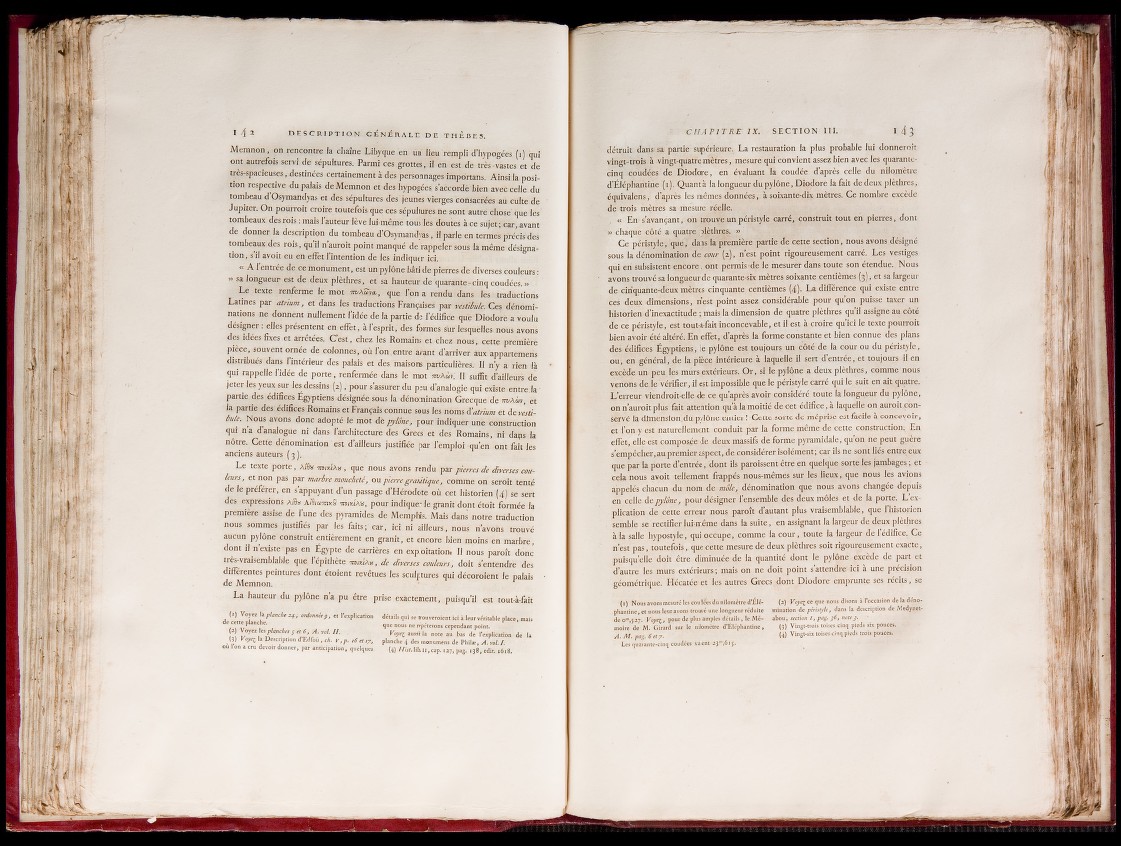
Memnon, on rencontre la chaîne Libyque en un lieu rempli d’hypogées (1) qui
ont autrefois servi de sépultures. Parmi ces grottes, il en est de très-vastes et de
très-spacieuses, destinées certainement à des personnages importans. Ainsi la position
respective du palais de Memnon et des hypogées s’accordè bien avec celle du
tombeau d Osymandyas et des sépultures des jeunes vierges consacrées au culte de
Jupiter. On pourroit croire toutefois que ces sépultures ne sont autre chose que les
tombeaux des rois : mais 1 auteur lève lui-même tous les doutes à ce sujet ; car, avant
de donner la description du tombeau d’Osymandyas, il parle en termes précis des
tombeaux des rois, quil nauroit point manqué de rappeler sous la même désignation,
s il avoit eu en effet l’intention de les indiquer ici.
« A 1 entrée de ce monument, est un pylône bâti de pierres de diverses couleurs :
» sa longueur est de deux plethres, et sa hauteur de quarante-cinq coudées. »
Le texte renferme le mot mAata., que l’on a rendu dans les traductions
Latines par atrium, et dans les traductions Françaises par vestibule. Ces dénominations
ne donnent nullement l’idée de la partie de l’édifice que Diodore a voulu
désipier : elles présentent en effet, à l’esprit, des formes sur lesquelles nous avons
des idées fixes et arrêtées. C’est, chez les Romains et chez nous, cette première
pièce, souvent ornée de colonnes, où l’on, entre avant d’arriver aux appartemens
distribués dans 1 intérieur des palais et des. maisons particulières. Il n’y a rien là
qui rappelle l’idée de porte, renfermée dans le mot |§ p j§ Il s u f f i t d’ailleurs de
jeter les yeux sur les dessins (2), pour s’assurer du peu d’analogie qui existe entre.la *
partie des édifices Égyptiens désignée sous la dénomination Grecque de roA«», et
la partie des édifices Romains et Français connue sous les noms S atrium et i e vestibule.
Nous avons donc adopté le mot dè pylône, pour indiquer une construction
qui na d analogue ni dans l’architecture des Grecs et des Romains, ni daps la
nôtre. Cette dénomination est d’ailleurs justifiée par l’emploi qu’en ont fait les
anciens auteurs ( 3 ).
Le texte porte, AÎfe ™ * î a « , que nous avons rendu par pierres de diverses couleurs,
et non pas par marbre moucheté, ou pierre granitique, comme on seroit tenté
de le préférer, en s appuyant d un passage d’Hérodote où cet historien (4) se sert
des expressions Ai'0a Ai'9iM7nx.S to iju a v , pour indiquer le granit dont étoit formée la
première assise de 1 une des pyramides de Memphis. Mais dans notre traduction
nous sommes justifiés par les faits; car, ici ni ailleurs, nous n’avons trouvé
aucun pylône construit entièrement en granit, et encore bien moins en marbre,
dont il n existe pas en Egypte de carrières en exploitation. Il nous paroît donc
très-vraisemblable que lépithète 1re/dAa, de diverses couleurs, doit s’entendre des
différentes peintures dont étoient revêtues les sculptures qui décoraient le palais
de Memnon.
La hauteur du pylône na pu être prise exactement, puisqu’il est tout-à-fait
(1) Voyez la planche 24., ordonnéey, et l’explication
de cette planche.
(2) Voyez les planches j et 6 , A . vol. I I .
(3) Voy^l ^ Description d’Edfoû, ch. y , p. ¡6 et 17,
où l’on a cru devoir donner, par anticipation, quelques
détails qui se trouveroient ici à leur véritable place, mais
que nous ne répéterons cependant point.
Voyei aussi la note au bas de l’explication de la
planche 4 des monumens de Philæ, A . vol. I.
(4) é/wr.Iib.n,cap. 127, pag. 13 8 , edit. 16 18 .
détruit dans sa partie supérieure. La restauration la plus probable lui donnerait
vingt-trois à vingt-quatre mètres, mesure qui convient assez bien avec les quarante-
cinq coudées de Diodore, en évaluant la coudée d’après celle du nilomètre
d’Éléphantine ( i ), Quant à la longueur du pylône, Diodore la fait de deux plethres,
équivalons, d’après les mêmes données, à soixante-dix mètres. Ce nombre excede
de trois mètres sa mesure réelle.
« En s'avançant, on trouve un péristyle carré, construit tout en pierres, dont
» chaque côté a quatre plèthres. »
Ce péristyle, que, dans la première partie de cette section, nous avons désigné
sous la dénomination de cour (2), n’est point rigoureusement carré. Les vestiges
qui en subsistent encore, ont permis de le mesurer dans toute son étendue. Nous
avons trouvé sa longueur de quarante-six mètres soixante centièmes (3), et sa largeur
de cinquante-deux mètres cinquante centièmes (4). La différence qui existe entre
ces deux dimensions, n’est point assez considérable pour qu’on puisse taxer un
historien d’inexactitude ; mais la dimension de quatre plèthres qu il assigne au coté
de ce péristyle, est tout-à-fait inconcevable, et il est a croire qu ici le texte pourroit
bien avoir été altéré. En effet, d’après la forme constante et bien connue des plans
des édifices Égyptiens, le pylône est toujours un cote de la cour ou du péristyle,
ou, en général, de la pièce intérieure a laquelle il sert dentree, et toujours il en
excède un peu les murs extérieurs. Or, si le pylône a deux plèthres, comme nous
venons de le vérifier, il est impossible que le péristyle carré qui le suit en ait quatre.
L ’erreur viendrait-elle de ce qu’après avoir considère toute la longueur du pylône,
on n’auroit plus fait attention qu’à la moitié de cet édifice, à laquelle on aurait .conservé
la dimension.dù pylône entier ¡ Cette sorte de méprisé est facile a concevoir,
et l’on y est naturellement conduit par la forme meme de cette construction. En
effet, elle est composée de deux massifs de forme pyramidale, qu on ne peut guère
s’empêcher, au premier aspect, de considérer isolément; car ils ne sont lies entre eux
que par la porte d’entrée, dont ils paraissent être en quelque sorte les jambages ; et
cela nous avoit tellement frappés nous-mêmes sur les lieux, que nous les avions
appelés chacun du nom de mole, dénomination que nous avons changée depuis
en celle de pylône, pour désigner l’ensemble des deux môles et de la porte. L explication
de cette erreur nous paroît d’autant plus vraisemblable, que 1 historien
semble se rectifier lui-même dans la suite, en assignant la largeur de deux plèthres
à la salle hypostyle, qui occupe, comme la cour, toute la largeur de 1 édifice. Ce
n’est pas, toutefois, que cette mesure de deux plèthres soit rigoureusement exacte,
puisqu’elle doit être diminuée de la quantité dont le pylône excède de part et
d’autre les murs extérieurs ; mais on ne doit point s attendre ici a une précision
■géométrique. Hécatée et les autres Grecs dont Diodore èmprunte ses récits, se
(1) Nous avons mesuré les coudées du nilomètre d’Elé- (2) Voye? ce que nous disons à l’occasion de la déno-
phantine, et nous leur avons trouvé une longueur réduite mination de péristyle, dans la description de Medynet-
d e om,527. Voyez, pour de plus amples détails, le Mé- abou, section I , pag. 3 6 , note j .
moire de M. Girard sur le nilomètre d’Éléphantine, (3) Vingt-trois toises cinq pieds six pouces.
A . M . pag. 6 et7 . (4) Vingt-six toises cinq pieds trois pouces.
Les quarante-cinq coudées valent 23m,6 i j .