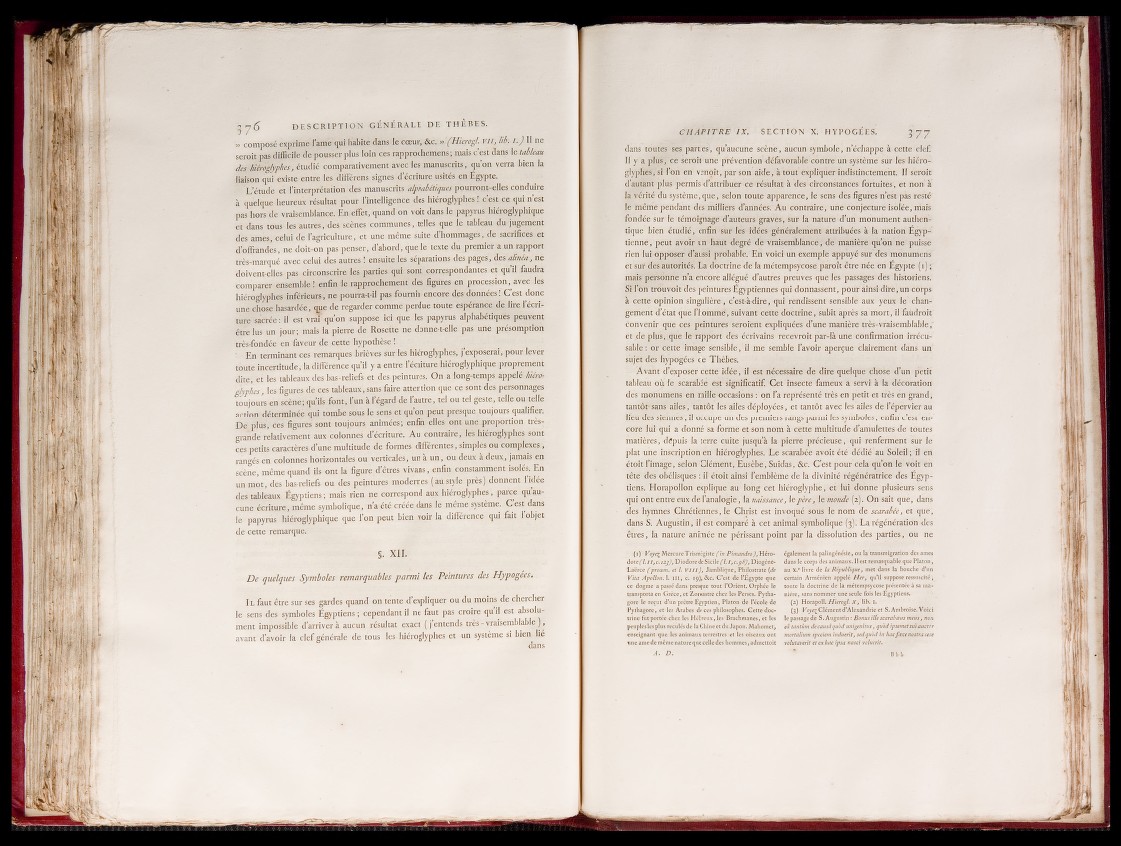
„ composé exprime J'ame qui habite dans le coeur, &c. W.(.Hierogl v il, lib. I .) Ii ne
serait pas difficile de pousser plus loin ces rapprochemens ; mais c’est dans le tableau
des hiéroglyphes, étudié comparativement avec les manuscrits, qu’on verra bien la
liaison qui existe entre les différens signes d’écriture usités en Égypte.
L ’étude et l’interprétation des manuscrits alphabétiques pourront-elles conduire
à quelque heureux résultat pour l’intelligence des hiéroglyphes ! c’est ce qui n’est
pas hors de vraisemblance. En. effet, quand on voit dans le papyrus hiéroglyphique
-et dans tous les autres, des scènes communes, telles que le tableau du jugement
des ames, celui de l’agriculture, et une même suite d’hommages, de sacrifices et
d’offrandes, ne doit-on pas penser, d’abord, que le texte du premier a un rapport
très-marqué avec celui des autres ! ensuite les séparations des pages, des alinéa, ne
doivent-elles pas circonscrire les parties qui sont correspondantes et qu’il faudra
comparer ensemble ! enfin le rapprochement des figures en procession, avec les
hiéroglyphes inférieurs, ne pourra-t-il pas fournir encore des données! C’est donc
une chose hasardée, que de regarder comme perdue toute espérance de lire l'écriture
sacrée : il est vrai qu’on suppose ici que les papyrus alphabétiques peuvent
être lus un jour; mais la pierre de Rosette ne donne-t-elle pas une présomption
très-fondée en faveur de cette hypothèse !
En terminant ces remarques brièves sur les hiéroglyphes, j exposerai, pour lever
toute incertitude, la différence qu’il y a entre l’écriture hiéroglyphique proprement
dite, et les tableaux des bas-reliefs et des peintures. On a long-temps appelé hiéroglyphes,
les figures de ces tableaux, sans faire attention que ce sont des personnages
toujours en scène; qu’ils font, l’un à l’égard de l’autre, tel ou tel geste, telle ou telle
action déterminée qui tombe sous le sens et qu’on peut presque toujours qualifier.
De plus, ces figures sont toujours animées; enfin elles ont une proportion très:
grande relativement aux colonnes d écriture. Au contraire, les hiéroglyphes sont
ces petits caractères d’une multitude de formes différentes, simples ou complexes ,
rangés en colonnes horizontales ou verticales, un a un, ou deux a deux, jamais en
scène, même quand ils ont la figure d’êtres vivans, enfin constamment isoles. En
un mot, des bas-reliefs ou des peintures modernes (austyle près) donnent l’idée
des tableaux Égyptiens; mais rien ne correspond aux hiéroglyphes, parce qu’aucune
écriture, même symbolique, n’a été créée dans le meme système. C est dans
le papyrus hiéroglyphique que l’on peut bien voir la différence qui fait 1 objet
de cette remarque.
§. X II.
De quelques Symboles remarquables parm i les Peintures des Hypogées.
I l faut être sur ses gardes quand on tente d’expliquer ou du moins de chercher
le sens des symboles Égyptiens ; cependant il ne faut pas croire qu il est absolument
impossible d’arriver à aucun résultat exact ( j’entends très - vraisemblable ),
avant d’avoir la clef générale de fous les hiéroglyphes et un système si bien lié
dans
dans toutes ses parties, qu’aucune scène, aucun symbole, n’échappe à cette clef.
Il y a plus, ce serait une prévention défavorable contre un système sur les hiéroglyphes,
si l’on en venoit, par son aide, à fout expliquer indistinctement. Il serait
d’autant plus permis d’attribuer ce résultat à des circonstances fortuites, et non à
la vérité du système, que, selon toute apparence, le sens des figures n’est pas resté'
le même pendant des milliers d’années. Au contraire, une conjecture isolée, mais
fondée sur le témoignage d’auteurs graves, sur la nature d’un monument authentique
bien étudié, enfin sur les idées généralement attribuées à la nation Égyptienne,
peut avoir un haut degré de vraisemblance , de manière qu’on ne puisse
rien lui opposer d’aussi probable. En voici un exemple appuyé sur des monumens
et sur des autorités. La doctrine de la métempsycose paraît être née en Égypte (i) ;'
mais personne n’a encore allégué d’autres preuves que les passages des historiens.
Si l’on trouvoit des peintures Égyptiennes qui donnassent, pour ainsi dire, un corps
à cette opinion singulière, c’est-à-dire, qui rendissent sensible aux yeux le changement
d’état que l’hommë, suivant cette doctrine, subit après sa mort, il faiidroit
convenir que ces peintures seraient expliquées d’une manière très-vraisemblable,'
et de plus, que le rapport des écrivains recevrait par-là une confirmation irrécusable
: or cette image sensible, il me semble l’avoir aperçue clairement dans un
sujet des hypogées de Thèbes.
Avant d’exposer cette idée, il est nécessaire de dire quelque chose d’un petit
tableau où le scarabée est significatif. Cet insecte fameux a servi à la décoration’
des monumens en mille occasions : on l’a représenté très en petit et très en grand,
tantôt-sans ailes, tantôt les ailes déployées, et tantôt avec les ailes de l’épervier au
lieu des siennes ; il occupe un des premiers rangs parmi les symboles ; enfin c’est encore
lui qui a donné sa forme et son nom à cette multitude d’amulettes de toutes
matières, depuis la terre cuite jusqu’à la pierre précieuse, qui renferment sur le
plat une inscription en hiéroglyphes. Le scarabée avoit été dédié au Soleil ; il en
étoit l’image, selon Clément, Eusèbe, Suidas, &c. C’est pour Cela qu’on le voit en
tête des obélisques : il étoit ainsi l’emblème de la divinité régénératrice des Égyptiens.
Horapollon explique au long cet hiéroglyphe, et lui donne plusieurs sens
qui ont entre eux de l’analogie, la naissance, le père, le monde (2). On sait que, dans
des hymnes Chrétiennes, le Christ est invoqué sous le nom de scarabée, et que,
dans S. Augustin, il est comparé à cet animal symbolique (3)! La régénération des
êtres, la nature animée ne périssant point par la dissolution des parties, ou ne
( i ) Voye^ Mercure Trismégiste ( in Pimandro) , Héro- également la palingénésie, ou la transmigration des ames
¿oxe ( l . i l , c . i 2 j ) , Diodore de Sicile (l.r,c.<f#J,Diogènt- dans le corps des animaux. II est remarquable que Platon,
Laërce (procem. et l. v m ) , Jàmblique, Philostrate [de au X .e livre de la République, met dans la bouche d’un
Vita Apollon. 1. n i , c. 19 ) , &c. C’est de l’Egypte que certain Arménien appelé H e r, qu’il suppose ressuscité,
ce dogme a passé dans presque tout l’Orient. Orphée le toute la doctrine de la métempsycose présentée à sa níatransporta
en Grèce, et Zoroastre chez les Perses. Pytha- nière, sans nommer une seule fois les Egyptiens,
gore le reçut d’un prêtre Egyptien, Platon de l’école de (2) Horapoll. Hierogl. X , lib. 1.
Pythagore, et les Arabes de ces philosophes. Cette doc- (3) Voye^ Clément d’Alexandrie et S. Ambroise. Voici
trine fut portée chez les Hébreux, les Brachmanes, et les le passage de S. Augustin : Bonus ille scarabceus meus, non
peuples les plus reculés de la Chine et du Japon. Mahomet, eâ tantùm de causa quod unigénitas, quod ipsemetsui aucter .
enseignant que les animaux terrestres et les oiseaux ont mortalium specieni induerit, sedquod in hacfoecenostra sese
une ame de même nature que celle des hommes, ad met toit vôlutayerit et ex bac ipsa nasci volucrit.
A. D,. % Bbb