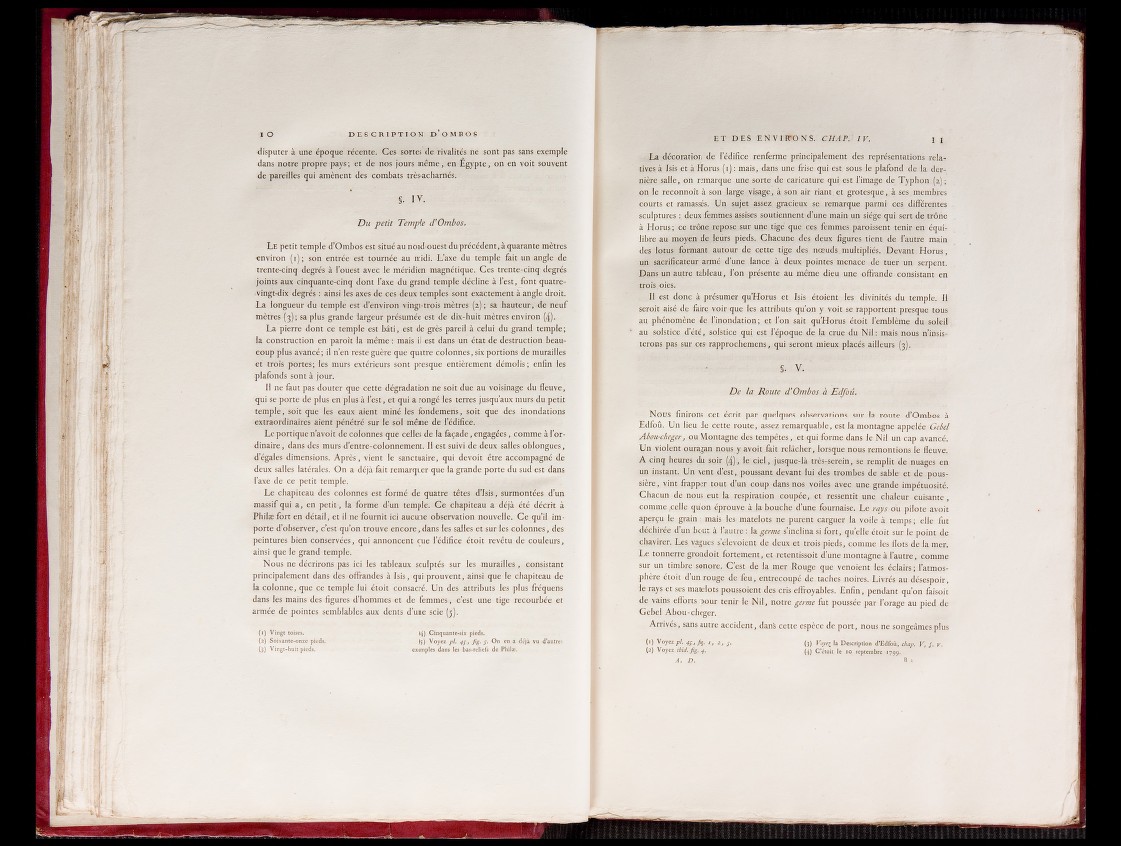
disputer à une époque récente. Ces sortes de rivalités ne sont pas sans exemple
dans notre propre pays ; et de nos jours même, en Egypte, on en voit souvent
de pareilles qui amènent des combats très-acharnés.
§. IV .
Du p etit Temple d ’Ombos.
Le petit temple d’Ombos est situé au nord-ouest du précédent, à quarante mètres
environ (i); son entrée est tournée au midi. L ’axe du temple fait un angle de
trente-cinq degrés à l’ouest avec le méridien magnétique. Ces trente-cinq degrés
joints aux cinquante-cinq dont l’axe du grand temple décline à l’est, font quatre-
vingt-dix degrés : ainsi les axes de ces deux temples sont exactement à angle droit.
La longueur du temple est d’environ vingt-trois mètres (2) ; sa hauteur, de neuf
mètres (3); sa plus grande largeur présumée est de dix-huit mètres environ (4).
La pierre dont ce temple est bâti, est de grès pareil à celui du grand temple;
la construction en paroît la même : mais il est dans un état de destruction beaucoup
plus avancé; il n’en reste guère que quatre colonnes, six portions de murailles
mg et trois portes; les murs extérieurs sont presque entièrement démolis ; enfin le.s
plafonds sont à jour.
Il ne faut pas douter que cette dégradation ne soit due au voisinage du fleuve,
qui se porte de plus en plus à l’est, et qui a rongé les terres jusqu’aux murs du petit
temple, soit que les eaux aient miné les fondemens, soit que des inondations
extraordinaires aient pénétré sur le sol même de l’édifice.
Le portique n’avoit de colonnes que celles de la façade, engagées, comme à l’ordinaire
, dans des murs d’entre-colonnement. Il est suivi de deux salles oblongues,
d’égales dimensions. Après, vient le sanctuaire, qui devoit être accompagné de
deux salles latérales. On a déjà fait remarquer que la grande porte du sud est dans
l’axe de ce petit temple.
:/î| Le chapiteau des colonnes est formé de quatre têtes d’Isis, surmontées d’un
massif qui a, en petit-, la forme d’un temple. Ce chapiteau a déjà été décrit à
Philæ fort en détail, et il ne fournit ici aucune observation nouvelle. Ce qu’il importe
d’observer, c’est qu’on trouve encore, dans les salles et sur les colonnes, des
peintures bien conservées, qui annoncent que l’édifice étoit revêtu de couleurs,
ainsi que le grand temple.
Nous ne décrirons pas ici les tableaux sculptés sur les murailles , consistant
principalement dans des offrandes à Isis, qui prouvent, ainsi que le chapiteau de
la colonne, que ce temple lui étoit consacré. Un des attributs les plus fréquens
dans les mains des figures d’hommes et de femmes, c’est une tige recourbée et
armée de pointes semblables aux dents d’une scie (5).
1 C1 ) Vingt toises. (4) Cinquante-six pieds. (2) Soixante-onze pieds. (5) Voyez p l. 4 $ , fig. j . On en a déjà vu d’autres
(3) Vingt-huit pieds. exemples dans les bas-reliefs de Philæ.
La décoration de l’édifice renferme principalement des représentations relatives
à Isis et à Horus (i) : mais, dans une frise qui est, sous le plafond de la dernière
salle, on remarque une sorte de caricature qui est l’image de Typhon (2);
on le reconnoît à son large visage, à son air riant et grotesque, à ses membres
courts et ramassés. Un sujet assez gracieux se remarque parmi ces différentes
sculptures : deux femmes assises soutiennent d’une main un siège qui sert de trône
à Horus; ce trône repose sur une tige que ces femmes paroissent tenir en équilibre
au moyen de leurs pieds. Chacune des deux figures tient de l’autre main
des lotus formant autour de cette tige des noeuds multipliés. Devant Horus,
un sacrificateur armé d’une lance à deux pointes menace de tuer un serpent.
Dans un autre tableau, l’on présente au même dieu une offrande consistant en
trois, oies.
Il est donc à présumer qu’Horus et Isis étoient les divinités du temple. Il
seroit aisé de faire voir que les attributs qu’on y voit se rapportent presque tous
au phénomène de l’inondation; et l’on sait qu’Horus étoit l’emblème du soleil
au solstice d’été, solstice qui est l’époque de la crue du Nil: mais nous n’insisterons
pas sur ces- rapprochemens, qui seront mieux placés ailleurs (3).
§• v.
De la Route d’Ombos à Edfoû.
Nous finirons cet écrit par quelques observations sur la route d’Ombos à
Edfoû. Un lieu de cette route, assez remarquable, est la montagne appelée Gebel
Abou-cheger, ou Montagne des tempêtes, et qui forme dans le Nil un cap avancé.
Un violent ouragan nous y avoit fait relâcher, lorsque nous remontions le fleuve.
A cinq heures du soir (4), le ciel, jusque-là très-serein, se remplit de nuages en
un instant. Un vent d’est, poussant devant lui des trombes de sable et de poussière
, vint frapper tout d’un coup dans nos voiles avec une grande impétuosité.
Chacun de nous eut la respiration coupée, et ressentit une chaleur cuisante ,
comme ,celle qu’on éprouve à la bouche d’une fournaise. Le ray s ou pilote avoit
aperçu le grain : mais les matelots ne purent carguer la voile à temps ; elle fut
déchirée d’un bout à l’autre : la germe s’inclina si fort, quelle étoit sur le point de
chavirer. Les vagues selevoient de deux et trois pieds, comme les flots de la mer.
Le tonnerre grondoit fortement, et retentissoit d’une montagne à l’autre, comme
sur un timbre sonore. C ’est de la mer Rouge que venoient les éclairs; l’atmosphère
étoit d’un rouge de feu, entrecoupé de taches noires. Livrés au désespoir,
le rays et ses matelots poussoient des cris effroyables. Enfin, pendant qu’on faisoit
de vains efforts pour tenir le Nil, notre germe fut poussée par l’orage au pied de
Gebel Abou-cheger.
Arrives, sans autre accident, dans cette espèce de port, nous ne songeâmes plus
(1) Voyez pl. 4 s . f g. 7, 2 j y. (3) Voyez *a Description d’Edfoû, chap. V. f . y.
(2) Voyez ibid. fig. 4, (4) C’écoit le 10 septembre 1799.
Il D . B»