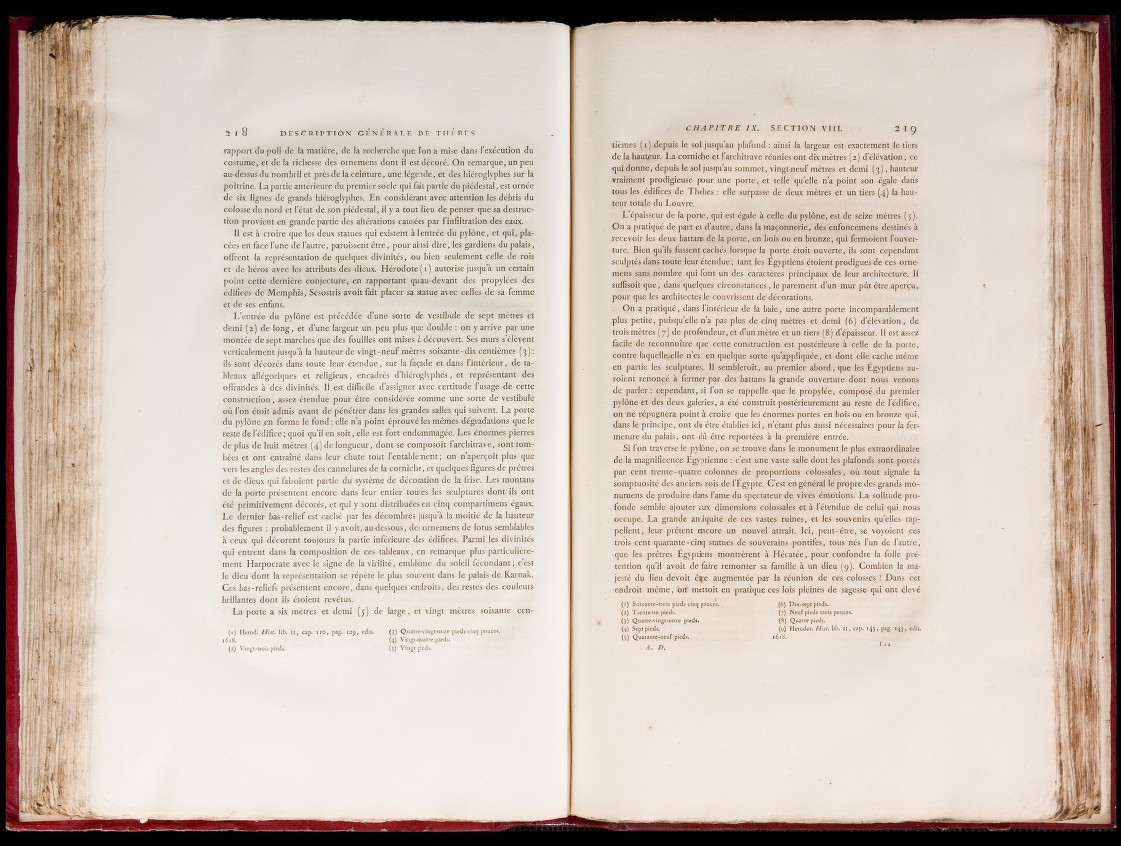
rapport.du poli de la matière, de la recherche que l’on a mise dans l’exécution du
costume, et de la richesse des ornemens dont il est décoré. On remarque, un peu
au-dessus du'nombril et près de la ceinture, une légende, et des hiéroglyphes sur la
poitrine. La partie antérieure du premier socle qui fait partie du piédestal, est ornée
de six lignes de grands hiéroglyphes. En considérant avec attention les débris du
colosse du nord et l’état de son piédestal, il y a tout lieu de penser que sa destruction
provient en grande partie des altérations causées par l’infiltration des eaux.
Il est à croire que les deux statues qui existent à l’entrée du pylône, et qui, placées
en face l’une de l’autre, paroissent être, pour ainsi dire, les gardiens du palais.;
offrent la représentation de quelques divinités, ou bien seulement celle de rois
et de héros avec les attributs des dieux. Hérodote ( i ) autorise jusqu’à un certain
point cette dernière conjecture, en rapportant qu’au-devant des propylées des
édifices de Memphis, Sésostris avoitfait placer sa statue avec celles de sa femme
et de ses enfkns.
L ’entrée du pylône est précédée d’une sorte de vestibule de sept mètres et
demi (2) de long, et d’une largeur un peu plus que double : 011 y arrive par une
montée de sept marches que des fouilles ont mises à découvert. Ses murs s’élèvent
verticalement jusqu’à la hauteur de vingt-neuf mètres soixante-dix centièmes (3) :
ils sont décorés dans toute leur étendue, sur la façade et dans l’intérieur, de tableaux
allégoriques et religieux, encadrés d’hiéroglyphes, et représentant des
offrandes à des divinités. Il est difficile d’assigner avec certitude l’usage de cette
construction, assez étendue pouf être considérée comme une sorte de vestibule
où l’on étoit admis avant de pénétrer dans les grandes salles qui suivent. La porte
du pylône .en forme le fond : elle n’a point éprouvé les mêmes dégradations que le
reste de l’édifice ; quoi qu’il en soit, elle est fort endommagée. Les énormes pierres
de plus de huit mètres (4) de longueur, dont se composoit l’architrave, sont tombées
et ont entraîné dans leur chute tout l’entablement ; on n’aperçoit plus que
vers les angles des restes des cannelures de la corniche, et quelques figures de prêtres
et de dieux qui faisoient partie du système de décoration de la frise. Les montans
de la porte présentent encore dans leur entier toutes les sculptures dont ils ont
été primitivement décorés, et qui y sont distribuées en cinq compartimens égaux.
Le dernier bas-relief est caché par les décombres jusqu’à la moitié de la hauteur
des figures : probablement il y avoit, au-dessous, des ornemens de lotus semblables
à ceux qui décorent toujours la partie inférieure des édifices. Parmi les divinités
qui entrent dans la composition de ces tableaux, on remarque plus particulièrement
Harpocrate avec le signe de la virilité, emblème du soleil fécondant; cest
le dieu dont la représentation se répète le plus souvent dans le palais de Karnak.
Ces bas-reliefs présentent encore, dans quelques endroits, des restes des couleurs
brillantes dont ils étoient revêtus.
La porte a six mètres et demi (y) de large, et vingt mètres soixante cen-
(1) Herod. Hist. lib. I I , cap. n o , pag. 12 9 , edit. (3) Quatre-vingt-onze pieds cinq pouces.
16 18 . (4) Vingt-quatre pieds.
(2) Vingt-trois pieds. (5) Vingt pieds.
tièmes ( i ) depuis le sol jusqu’au plafond : ainsi la largeur est exactement le tiers
de la haut.eur. La corniche et l’architrave réunies ont dix mètres ( 2 ) d’élévation ; ce
qui donne, depuis le sol jusqu’au sommet, vingt-neuf mètres et demi (3), hauteur
vraiment prodigieuse pour une porte, et telle qu’elle n’a point son égale dans
tous les édifices de Thèbes : elle surpasse de deux mètres ét un tiers (4) la hauteur
totale du Louvre.
L épaisseur de la porte, qui est égale à celle du pylône, est de seize mètres (y).
O11 a pratiqué de part et d’autre, dans la maçonnerie, des enfoncémens destinés à
recevoir les deux battans de la porte, en bois ou en bronze, qui fermoient l’ouverture.
Bien qu’ils fussent cachés lorsque la porte étoit ouverte, ils sont cependant
sculptés dans toute leur étendue ; tant les Égyptiens étoierit prodigués de ces ornemens
sans nombre qui font un des caractères principaux de leur architecture: Il
suffisoit que, dans quelques circonstances, le parement d’un mur pût être aperçu,
pour que les architectes le couvrissent de décorations.
On a pratiqué, dans l’intérieur de la baie, une autre porte incomparablement
plus petite, puisqu’elle n’a pas plus de cinq mètres et demi (6) d’élévation, de
trois mètres (7) de profondeur, et d’un mètre et un tiers (8) d’épaisseur. Il est assez
facile de reconnoître que cette construction est postérieure à celle de la porte,
contre laquelle.elle n’est en quelque sorte qu’appliquée, et dont elle cache même
en partie les sculptures. Il semblerait, au premier abord, que les Egyptiens auraient
renoncé à fermer par des battans la grande ouverture dont nous venons
de parler : cependant, si l’on se rappelle que le propylée, composé du premier
pylône et des deux galeries, a été construit postérieurement au reste de l’édifice,
on ne répugnera point à croire que les énormes portes en bois ou en bronze qui,
dans le principe, ont dû être établies ici, n’étant plus aussi nécessaires pour la fermeture
du palais, ont dû être reportées à la première entrée.
Si l’on traverse le pylône, on se trouve dans le monument le plus extraordinaire
de la magnificence Égyptienne : c’est une vaste salle dont les plafonds sont portés
par cent trente-quatre colonnes de proportions colossales, où tout signale la
somptuosité des anciens rois de l’Egypte. C’est en général le propre des grands mo-
numens de produire dans l’ame du spectateur de vives émotions. La solitude profonde
semble ajouter aux dimensions colossales et à l’étendue de celui qui nous
occupe. La grande antiquité de ces vastes ruines, et les souvenirs qu’elles rappellent,
leur prêtent encore un nouvel attrait. Ici, peut-être, se voyoient ces
trois cent quarante-cinq statues de souverains pontifes, tous nés l’un de l’autre,
que les prêtres Égyptiens montrèrent à Hécatée, pour confondre la folle prétention
qu’il avoit de faire remonter sa famille à un dieu (9). Combien la majesté
du lieu devoit êyre augmentée par la réunion de ces colosses ! Dans cet
endroit même, bit mettoit en pratique ces lois pleines de sagesse qui ont élevé
(1) Soixante-trois pieds cinq pouces. „
(2) Trente-un pieds.
(3) Quatre-vingt-onze pieds.
(4) Sept pieds.
(5) Quarante-neuf pieds.,
. A . D .
(6) Dix-sept pieds.
(7) Neuf pieds trois pouces.
(8) Quatre pieds.
(9) Herodot. Hist. lib. I l , cap. 14 3 , pag. 145> edit.
161S.
Ee 2