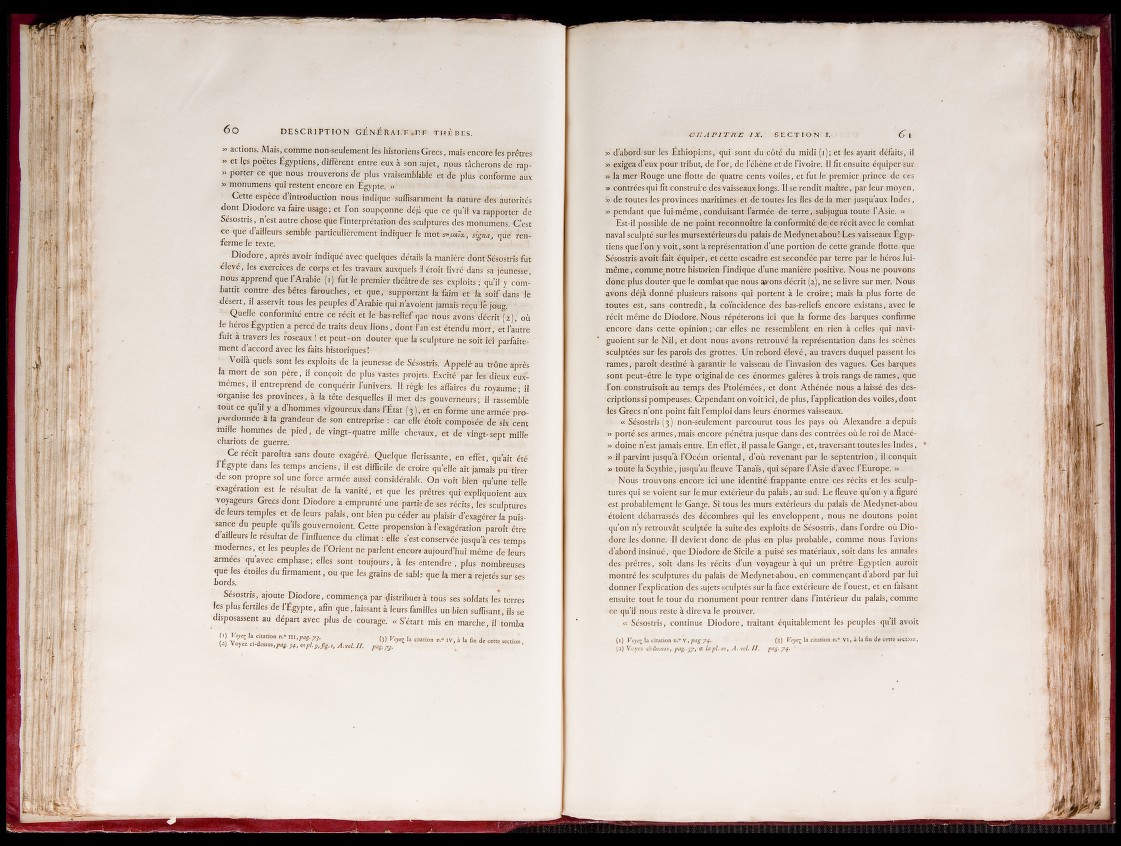
» actions. Mais, comme non-seulement les historiens Grecs, mais encore les prêtres
f et les poëtes Égyptiens, diffèrent entre eux à son sujet, nous tâcherons de rap-
» porter ce que nous trouverons de plus vraisemblable et de plus conforme aux
» monumens qui restent encore en Egypte. »
Cette espèce d introduction nous indique suffisamment la nature des autorités
dent Diodore va faire usage; et l’on soupçonne déjà que ce qu’il va rapporter de
Sésostris, n’est autre chose que l’interprétation des sculptures des monumens. Cest
ce que d’ailleurs semble particulièrement indiquer le mot ¡ntjutïa,-, signag que renferme
le texte.
Diodore, après avoir indiqué avec quelques détails la manière dont Sésostris fut
élevé, les exercices de corps et les travaux auxquels il étoit livré dans sa jèunesse,
nous apprend que l’Arabie (i) fut le premier théâtre de ses exploits ; qu’il y combattit
contre des bêtes farouches, et que, supportant la faim et la soif dans le
désert, il asservit tous les peuples d’Arabie qui n’avoient jamais reçu lé joug.
' Quelle conformité entre ce récit et le bas-relief que nous avons’décrit (2), où
le héros Egyptien a percé de traits deux lions, dont l’un est étendu mort , et l’autre
fuié à travers Jes roseaux ! et peut-.on douter que la sculpture ne soit ici parfaitement
d’accord avec les faits historiques !
Voilà quels sont les exploits de la jeunesse de Sésostris. Appelé-au trône après
la mort de son père, il conçoit de plus vastes projets. Excité par les dieux eux"
mêmes, il entreprend de conquérir l’univers. Il règle les affaires du royaume; il
organise les provinces, à la tête desquelles il met des gouverneurs; il rassemble
toùt ce qu’il y a d’hommes vigoureux dans l’État (3), et en forme une armée proportionnée
à la grandeur de son entreprise : car elle étoit composée de six cent
mille hommes de pied, de vingt-quatre mille chevaux, et de vingt-sept mille
chariots de guerre.
Ce récit paroîtra sans doute exagéré. Quelque florissante, en effet, qu’ait été
J ’Egypte dans les temps anciens, il est difficile de croire qu’elle ait jamais pu tirer
•de son propre sol une force armée aussi considérable. On voit bien qu’une telle
•exagération est le résultat de la vanité, et que les prêtres qui expliquoient aux
•voyageurs Grecs dont Diodore a emprunté une partie de ses récits, les sculptures
ffe leurs temples et de leurs palais, ont bien pu céder au plaisir d’exagérer la puissance
du peuple qu ils gouvernoient. Cette propension à l’exagération paroît être
d ailleurs le résultat de l’influence du climat : elle s’est conservée jusqua ces temps
modernes, et les peuples de l’Orient ne parlent encore aujourd’hui même de leurs
armées quavec emphase; elles sont toujours, à les entendre, plus nombreuses
que les étoiles du firmament, ou que les grains de sable que la mer a rejetés sur ses
Lords.
Sésostris, ajoute Diodore, commença par distribuer à tous ses soldats les terres
les plus fertiles de l’Égypte, afin que, laissant à leurs familles un bien suffisant, ils se
disposassent au départ avec plus de courage. « S’étant mis en marche, il tomba
(1) Voj/ri la citation n.” n i (3) Voyr^ la citation n.« i v , à la fin de cette section
(2) Voyez ci-dcS5U3,pag. t t p l.y .f ig .i, A . vol. I I , paS. 7 J . | '
d’abord sur les Éthiopiens, qui sont du côté du midi (i); et les ayant défaits, il
» exigea d’eux pour tribut, de l’or, de l’ébène et de l’ivoire. II fit ensuite équiper sur
» la mer Rouge une flotte de quatre cents voiles, et fût le premier prince de ces
» contrées qui fit construire des vaisseaux longs. II se rendit maître, par leur moyen,
i? de toutes les provinces maritimes et de toutes les îles de la mer jusqu’aux Indes,
» pendant que lui-même, conduisant l’armée de terre, subjugua toute l’Asie. »
Est-il possible de ne point reconnoître la conformité de ce récit avec le combat
naval sculpté sur les murs extérieurs du palais de Medynet-abou ! Les vaisseaux Égyptiens
que l’on y voit, sont la représentation d’une portion de cette grande flotte que
Sésostris avoit fait équiper, et cette escadre est secondée par terre par le héros lui-
même, comme notre historien l’indique d’une manière positive. Nous ne pouvons
donc plus douter que le combat que nous avons décrit (2), ne se livre sur mer. Nous
avons déjà donné plusieurs raisons qui portent à le croire ; mais la plus forte de
toutes est, sans contredit, la coïncidence des bas-reliefs encore existans, avec le
récit même de Diodore. Nous répéterons ici que la forme des barques confirme
encore dans cette opinion ; car elles ne ressemblent en rien à celles qui navi-
guoient sur le Nil, et dont nous avons retrouvé la représentation dans les scènes
sculptées sur les parois des grottes. Un rebord élevé, au travers duquel passent les
rames, paroît destiné à garantir le vaisseau de l’invasion des vagues. Ces barques
sont peut-être le type original de ces énormes galères à trois rangs de rames,.que
l’on construisoït au temps des Ptolémées, et dont Athénée nous a laissé des descriptions
si pompeuses. Cependant on voit ici, de plus, l’application des voiles, dont
les Grecs n’ont point fait l’emploi dans leurs énormes vaisseaux.
« Sésostris (3) non-seulement parcourut tous les pays où Alexandre a depuis
» poiré ses armes, mais encore pénétra jusque dans des contrées où le roi de Macé-
» doine n’est jamais entré. En effet, il passa le Gange, et, traversant toutes les Indes, *
» il parvint jusqu’à l’Océan oriental, d’où revenant par le septentrion, il conquit
» toute la Scythie, jusqu’au fleuve Tanaïs, qui sépare l’Asie d’avec l’Europe. »
Nous trouvons encore ici une identité frappante entre ces récits et les sculptures
qui se voient sur le mur extérieur du palais, au sud. Le fleuve qu’on y a figuré
est probablement le Gange. Si tous les murs extérieurs du palais de Medynet-abou
étoient débarrassés des décombres qui les enveloppent, nous ne doutons point
qu’on n’y retrouvât sculptée la suite des exploits de Sésostris, dans l’ordre où Diodore
les donne, Il devient donc de plus en plus probable, comme nous l’avions
d’abord insinué, que Diodore de Sicile a puisé ses matériaux, soit dans les annales
des prêtres, soit dans les récits d’un voyageur à qui un prêtre Egyptien auroit
montré les sculptures du palais de Medynet-abou, en commençant d’abord par lui
donner l’explication des sujets-sçulptés sur la face extérieure de l’ouest, et en faisant
ensuite tout le tour du monument pour rentrer dans l’intérieur du palais, comme
ce qu’il nous reste à dire va le prouver.
« Sésostris, continue Diodore, traitant équitablement les peuples qu’il avoit
(1) Voye^ la citation n.° y , pag. 74. (3) Voye^ la citation n.° V I, à la fin de cette section,
(2) Voyez ci-dessus, pag. $ 7 , et la pl. 10, A . vol. I I . pag. 7 4 . 1