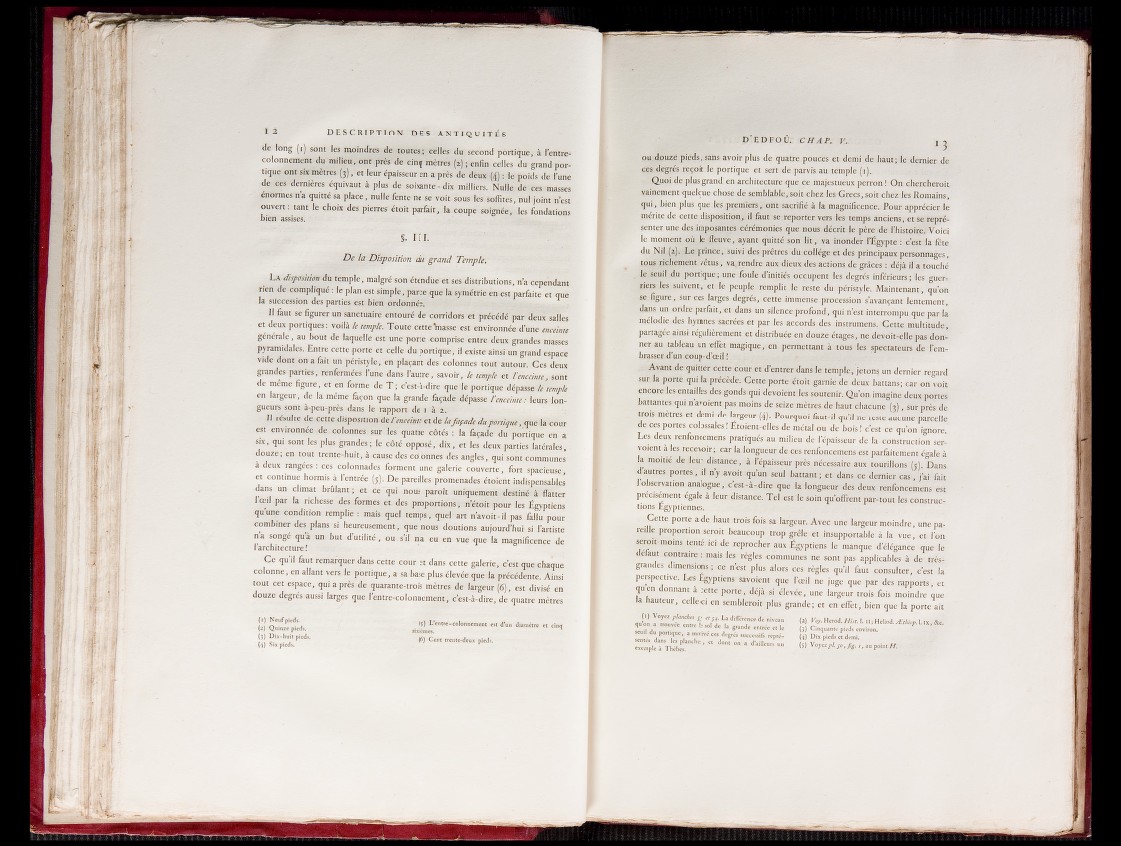
de long (i) sont les moindres de toutes r celles du second portique, à l’entre-
colonnement du milieu, ont près de cinq mètres (2) ; enfin celles du grand portique
ont six mètres (3), et leur épaisseur en a près de deux (4) : le poids de l’une
de ces dernières équivaut à plus de soixante-dix milliers. Nulle de ces masses
énormes n a quitté sa place, nulle fente ne se voit sous les soffites, nul joint n’est
ouvert: tant le choix des pierres étoit parfait, la coupe soignée, les fondations
bien assises.
§. I I I .
D e la Disposition du grand Temple.
L a disposition du temple, malgré son étendue et ses distributions, n’a cependant
rien de compliqué : le plan est simple, parce que la symétrie en est parfaite et que
la succession des parties est bien ordonnée.
Il faut se figurer un sanctuaire entouré de corridors et précédé par deux salles
et deux portiques: voilà le temple. Toute cette'masse est environnée d’une enceinte
générale, au bout de laquelle est une porte comprise entre deux grandes masses
pyramidales. Entre cette porte et celle du portique, il existe ainsi un grand espace
vide dont on a fait un péristyle, en plaçant des colonnes tout autour. Ces deux
grandes parties, renfermées l’une dans l’autre, savoir, le temple et l ’enceinte, sont
de meme figure, et en forme de T ; c’est-à-dire que le portique dépasse le temple
en largeur, de la même façon que la grande façade dépasse l ’enceinte: leurs longueurs
sont à-peu-près dans le rapport de 1 à 2.
Il resuite de cette disposition de l ’enceinte et de la façade du portique, que la cour
est environnée de colonnes sur les quatre côtés : la façade du portique en a
six, qui sont les plus grandes; le côté opposé, dix, et les deux parties latérales,
douze; en tout trente-huit, à cause des colonnes des angles, qui sont communes*
à deux rangées : ces colonnades forment une galerie couverte, fort spacieuse,
et continue hormis a l’entrée (y). Dépareilles promenades étoient indispensables
dans un climat brûlant ; et ce qui nous paroît uniquement destiné à flatter
1 osil par la richesse des formes et des proportions, n’étoit pour les Égyptiens
qu’une condition remplie : mais quel temps, quel art n’avoit-il pas fallu pour
combiner des plans si heureusement, que nous doutions aujourd’hui si l’artiste
na songé qu’à un but d’utilité, ou.s’il n’a eu en vue que la magnificence de
l’architecture !
Ce qu’il finit remarquer dans cette cour et dans cette galerie, c’est que chaque
colonne, en allant vers le portique, a sa base plus élevée que la précédente. Ainsi
tout cet espace, qui a près de quarante-trois mètres de largeur (6), est divisé en
douze degrés «aussi larges que l’entre-colonnement, c’est-à-dire, de quatre mètres
(i) Neuf pieds. (5) L ’entre-colonnement est d’un diamètre et cina
(a) Quinze pieds. sixièmes. 1
(3) Dix-huit pieds. (6) Ccnt Ireiue. deox ieds
(4 ) d ix p ie d s . *
ou douze pieds, sans avoir plus de quatre pouces et demi de haut; le dernier de
ces degrés reçoit le portique et sert de parvis au temple (i).
Quoi de plus grand en architecture que ce majestueux perron! On chercheroit
vainement quelque chose de semblable, soit chez les Grecs, soit chez les Romains,
qui, bien plus que les premiers | ont sacrifié à la magnificence. Pour apprécier le
mérite de cette disposition, il faut se reporter vers les temps anciens, et se représenter
une des imposantes cérémonies que nous décrit le père de l’histoire. Voici
le moment où le fleuve, ayant quitté son lit, va inonder l’Ëgypte : c’est la fête
du Nil (2). Le prince, suivi des prêtres du collège et des principaux personnages,
tous richement vêtus, va.rendre aux dieux des actions de grâces : déjà il a touché
le seuil du portique; une foule d’initiés occupent les degrés inférieurs; les guerriers
les suivent, et le peuple remplit le reste du péristyle. Maintenant, qu’on
se figure, sur ces larges degrés, cette immense procession s’avançant lentement,
dans un ordre parfait, et dans un silence profond, qui n’est interrompu que par la
mélodie des hymnes sacrées et par les accords des instrumens. Cette multitude,
partagée ainsi régulièrement et distribuée en douze étages, ne devoit-elle pas donner
au tableau un effet magique, en permettant à tous les spectateurs de l’embrasser
d’un coup-d’oeil !
Avant de quitter cette cour et d’entrer dans le temple, jetons un dernier regard
sur la porte qui la précède. Cette porte étoit garnie de deux battans; car on voit
encore les entailles des gonds qui devoient les soutenir. Qu’on imagine deux portes
battantes qui navoient pas moins de seize mètres de haut chacune (3), sur près de
trois métrés et demi de largeur (4). Pourquoi faut-il qu’il ne reste aucune parcelle
de ces portes colossales! Étoibnt-elles de métal ou de bois! c’est ce qu’on ignore '
Les deux renfoncemens pratiqués au milieu de l’épaisseur de la construction ser-
voient a les recevoir; car la longueur de ces renfoncemens est parfaitement égale à
la moitié de leur distance, à l’épaisseur près nécessaire aux tourillons (y). Dans
d autres portes, il n’y avoit qu’un seul battant ; et dans ce dernier cas, j’ai fait
1 observation analogue, c’est-à-dire que la longueur des deux renfoncemens est
précisément égalé à leur distance. Tel est le soin qu’offrent par-tout les constructions
Egyptiennes.
Cette porte a de haut trois fois sa largeur. Avec une largeur moindre, une pareille
proportion seroit beaucoup trop grêle et insupportable à la vue, et l’on
seroit moins tenté ici de reprocher aux Égyptiens le manque d’élégance que le
défaut contraire : mais les règles communes ne sont pas applicables à de très-
grandes dimensions ; ce n’est plus alors ces règles qu’il faut consulter, c’est la
perspective. Les Egyptiens savoient que l’oeil ne juge que par des rapports, et
quen donnant à cette porte, déjà si élevée, une largeur trois fois moindre que
la hauteur, celle-ci en sembleroit plus grande; et en effet, bien que la porte ait
(■) Voyez planche, | e, L a différence de niveau (a) Kç,. Herod. i f t r . |. , 1 ;H eIiod Æ,hiop I ,x &c “ Y B | C"trc ’* » d' «» S™»# entrée e, le Cinquante pieds environ. ? "
seu I du portique a motivé ces degrés successifs repré- (4) Dix pieds et demi.
exempie à" Thèbes.3 ^ ’ “ d° " ' ° " * | au point H .