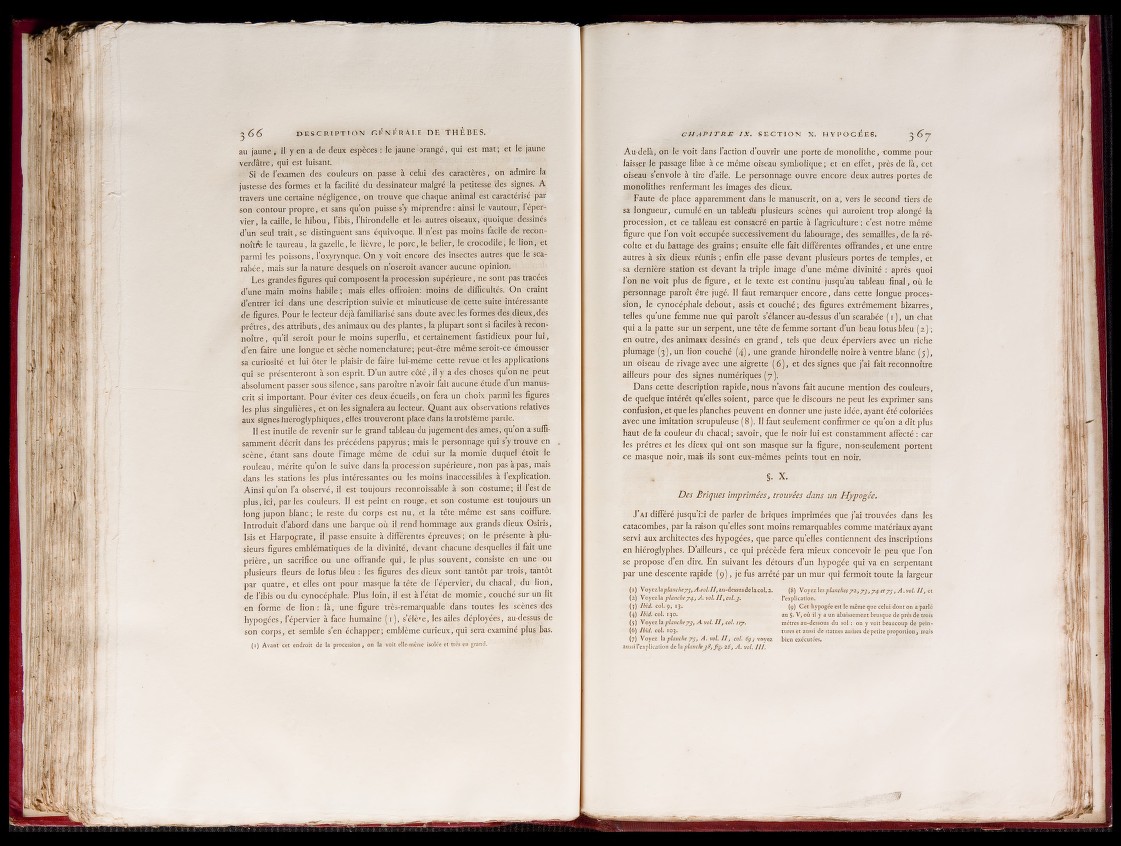
I I f É It
B
I }
ip p
1 I
m l
I
au jaune, il y en a de deux espèces : le jaune orangé, qui est mat; et le jaune
verdâtre, qui est luisant.
Si de l’examen des couleurs on passe à celui des caractères, on admire la
justesse des formes et la facilité du dessinateur malgré la petitesse des signes. A
travers une certaine négligence, on trouve que chaque animal est caractérisé par
son contour propre, et sans qu’on puisse s’y méprendre: ainsi le vautour, l’éper-
vier, la caille, le hibou, l’ibis, l’hirondelle et les autres oiseaux, quoique dessinés
d’un seul trait, se distinguent sans équivoque. Il n’est pas moins facile de recOn-
noîtlfe le taureau, la gazelle, le lièvre, le porc, le belier, le crocodile, le lion, et
parmi les poissons, l’oxyrynque. On y voit encore des insectes autres que le scarabée
, mais sur la nature desquels on n’oseroit avancer aucune opinion.
Les grandes figures qui composent la procession supérieure, ne sont pas tracées
d’une main moins habile ; mais elles offraient moins de difficultés. On craint
d’entrer ici dans une description suivie et minutieuse de cette suite intéressante
de figures. Pour le lecteur déjà familiarisé sans doute avec lés formes des dieux, des
prêtres, des attributs, des animaux ou des plantes, la plupart sont si faciles à recon-
noître, qu’il serait pour le moins superflu, et certainement fastidieux pour lui,
d’en faire une longue et sèche nomenclature; peut-être même seroit-ce émousser
sa curiosité et lui ôter le plaisir de faire lui-même cette revue et les applications
qui se présenteront à son esprit. D’un autre côté, il y a des choses qu on ne peut
absolument passer sous silence, sans paraître n’avoir fait aucune étude d un manuscrit
si important. Pour éviter ces deux écueils, on fera un choix parmi les figures
les plus singulières, et on les signalera au lecteur. Quant aux observations relatives
aux signes hiéroglyphiques, elles trouveront place dans la troisième partie.
Il est inutile de revenir sur le grand tableau du jugement des ames, qu’on a suffisamment
décrit dans les précédens papyrus ; mais le personnage qui s’y trouve en
scène, étant sans doute l’image même de celui sur la momie duquel étoit le
rouleau, mérite qu’on le suive dans la procession supérieure, non pas àpas, mais
dans les stations les plus intéressantes ou les moins inaccessibles à 1 explication.
Ainsi qu’on l’a observé, il est toujours reconnoissable à son costume; il l’est de
plus, ici, parles couleurs. Il est peint en rouge, et son costume est toujours un
long jupon blanc; le reste du corps est nu, et la tête même est sans coiffure.
Introduit d’abord dans une barque où il rend hommage aux grands dieux Osiris,
Isis et Harpoprate, il passe ensuite à différentes épreuves; on le présente à plusieurs
figures emblématiques de la divinité, devant chacune desquelles il fait une
prière, un sacrifice ou une offrande qui, le plus souvent, consiste en une ou
plusieurs fleurs de lofus bleu : les figures des dieux sont tantôt par trois, tantôt
par quatre, et elles ont pour masque la tête de l’épervier, du chacal, du lion,
de l’ibis ou du cynocéphale. Plus loin, il est à l’état de momie, couché sur un lit
en forme de lion: là, une-figure très-remarquable dans toutes les scènes des
hypogées, l’épervier à face humaine ( i ), s’élève, lés ailes déployées, au-dessus de
son corps, et semble s’en échapper; emblème curieux, qui sera examiné plus bas.
(i) Avant cet endroit de la procession, on la voit elle-même isolée et très en grand.
1
|
Au-delà, on le voit dans l’action d’ouvrir une porte de monolithe, nomme pour
laisser le passage libre à ce même oiseau symbolique; et en effet, près de là, cet
oiseau s’envole à tire d’aile. Le personnage ouvre encore deux autres portes de
monolithes renfermant les images des dieux.
Faute de place apparemment dans le manuscrit, on a, vers le second tiers de
sa longueur, cumulé en un tableaTu plusieurs scènes qui auraient trop alongé la
procession, et ce tableau est consacré en partie à l’agriculture; c’est notre même
figure que l’on voit occupée successivement du labourage, des semailles, de la récolte
et du battage des grains ; ensuite elle fait différentes offrandes, et une entre
autres à six dieux réunis ; enfin elle passe devant plusieurs portes de temples, et
sa dernière station est devant la triple image d’une même divinité : après quoi
l’on ne voit plus de figure, et le texte est continu jusqu’au tableau final, où le
personnage paraît être jugé. Il faut remarquer encore, dans cette longue procession,
le cynocéphale debout, assis et couché; des figures extrêmement bizarres,
telles qu’une femme nue qui paraît s’élancer au-dessus d’un scarabée ( 1 ), un chat
qui a la patte sur un serpent, une tête de femme sortant d’un beau lotus bleu (2) ;
en outre, des animaux dessinés en grand, tels que deux éperviers avec un riche
plumage (3), un lion couché (4), une grande hirondelle noire à ventre blanc (y),
un oiseau de rivage avec une aigrette (6), et des signes que j’ai fait reconnoîtrç
ailleurs pour des signes numériques (7).
Dans cette description rapide, nous n’avons fait aucune mention des couleurs,
de quelque intérêt qu’elles soient, parce que le discours ne peut les exprimer sans
confusion, et que les planches peuvent en donner une juste idée, ayant été coloriées
avec une imitation scrupuleuse (8). IJ faut seulement confirmer ce qu’on a dit plus
haut de la couleur du chacal; savoir, que le noir lui est constamment affecté : car
les prêtres et les dieux qui ont son masque sur la figure, non-seulement portent
ce masque noir, mais ils sont eux-mêmes peints tout en noir.
§. X.
Des Briques imprimées, trouvées dans un Hypogée.
J ’ai différé jusqu’ici de parler de briques imprimées que j’ai trouvées dans les
catacombes, par la raison qu’elles sont moins remarquables comme matériaux ayant
servi aux architectes des hypogées, que parce qu’elles contiennent des inscriptions
en hiéroglyphes. D’ailleurs, ce qui précède fera mieux concevoir le peu que l’on
se propose d’en dire. En suivant les détours d’un hypogée qui va en serpentant
par une descente rapide (9), je fus arrêté par un mur qui fermoit toute la largeur
(1) Voyez l a . A . vu/.//, au-dessus delà col. 2. (S) Voyez \es planches 7 3 , 7 4 a 7 5 , A .vo l. I I , ei
(2) Voyez la planche7 4 , A . vol. I I , col. 3 . } l’explication.
(5) ¡bid. col. 9, 13 . (9 ) Cet hypogée est le même que celui dont on a parlé
(4) Ibid. col. 130. au §. V , où il y a un abaissement brusque de près de trois
(5) Voyez la planche7 3 , A . vol. I I , col. 117 . mètres au-dessous du sol : on y voit beaucoup de pein-
(6) Ibid. col. 103. tures et aussi de statues assises de petite proportion, mais
(7) Voyez la planche 7 3 , A . vol, I I , col. 69 / voyez bien exécutées,
aussi l’explication de la planche38 , fig. 26, A . vol. I I I .