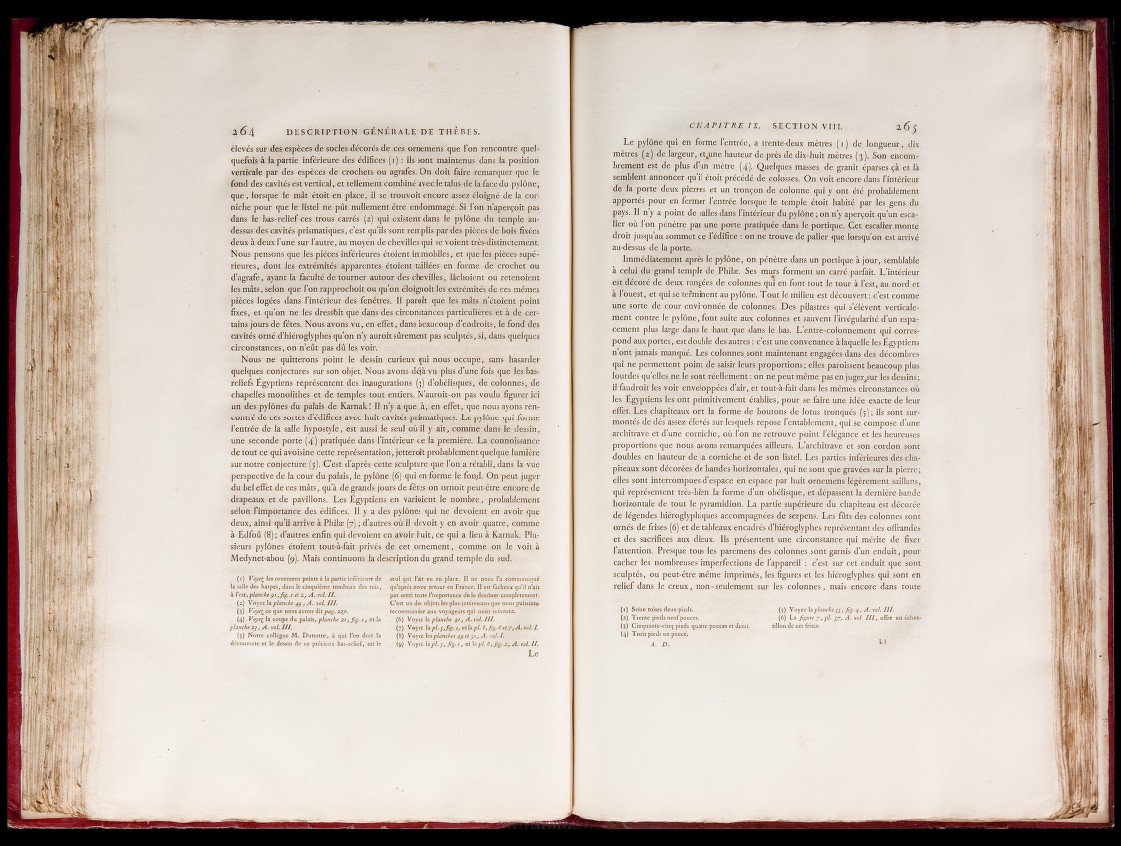
élevés sur des espèces de socles décorés de ces ornemens que l’on rencontre quelquefois
à la partie inférieure des édifices (i) : ils sont maintenus dans la position
verticale par des espèces de crochets ou agrafes. On doit faire remarquer que le
fond des cavités est vertical, et tellement combiné avec le talus de la face du pylône,
que, lorsque le mât étoit en place, il se trouvoit encore assez éloigné de la corniche
pour que le listel ne pût nullement être endommagé. Si l’on n’aperçoit pas
dans le bas-relief ces trous carrés (2) qui existent dans le pylône du temple au-
dessus des cavités prismatiques, c’est qu’ils sont remplis par des pièces de bois fixées
deux à deux l’une sur l’autre, au moyen de chevilles qui se voient très-distinctement.
Nous pensons que les pièces inférieures étoient immobiles, et que les pièces supérieures,
dont les extrémités apparentes étoient taillées en forme de crochet ou
d’agrafe, ayant la faculté de tourner autour des chevilles, lâchoient ou retenoient
les mâts, selon que l’on rapprochoit ou qu’on éloignoit les extrémités de ees mêmes
pièces logées dans l’intérieur des fenêtres. Il paroît que les mâts n’étoient point
fixes, et qu’on ne les dressait que dans des circonstances particulières et à de certains
jours de fêtes. Nous avons vu, en effet, dans beaucoup d’endroits, le fond des
cavités orné d’hiéroglyphes qu’on n’y auroit sûrement pas sculptés, si, dans quelques
circonstances, on n’eût pas dû les voir.
Nous ne quitterons point le dessin curieux qui nous occupe; sans hasarder
quelques conjectures sur son objet. Nous avons déjà vu plus d’une fois que les bas-
reliefs Egyptiens représentent des inaugurations (3) d’obélisques, de colonnes, de
chapelles monolithes et de temples tout entiers. N’auroit-on pas voulu figurer ici
un des pylônes du palais de Karnakî II n’y a que là, en effet, que nous ayons rencontré
de ces sortes d’édifices avec huit cavités prismatiques. Le pylône qui forme
l’entrée de la salle hypostyle., est aussi le seul où il y ait, comme dans le dessin,
une seconde porte (4 ) pratiquée dans l’intérieur de la première. La connoissance
de tout ce qui avoisine cette représentation, jetteroit probablement quelque lumière
sur notre conjecture (5). C’est d’après cette sculpture que l’on a rétabli, dans la'vue
perspective de la cour du palais, le pylône (6) qui en forme le fon.d. On peut juger
du bel effet de ces mâts, qu’à de grands jours de fêtes on ornoit peut-être encore de
drapeaux et de pavillons. Les Égyptiens en varioient le nombre, probablement
selon l’importance des édifices. Il y a des pylônes qui ne devoient en avoir que
deux, ainsi qu’il arrive à Philæ (7) ; d’autres où il devoit y en avoir quatre, comme
à Edfoû (8); d’autres enfin qui devoient en avoir huit, ce qui a lieu à Karnak. Plusieurs
pylônes étoient tout-à-fait privés de cet ornement, comme on le voit à
Medynet-abou (9). Mais continuons la description du grand temple du sud.
(1) Voye£ les ornemens peints à la partie inférieure de seul qui l’ait vu en place. II ne nous l’a communiqué
la salle des harpes, dans le cinquième tombeau des rois, qu’après notre retour en France. II est fâcheux qu’ il n’ait
à l’est, planche 9 1 , fig. i et 2 , A . vol. I I . pas senti toute l’importance de le dessiner complètement.
(2) Voyez la planche 4 9 , A . vol. I I I . C ’est un des objets les plus intéressans que nous puissions
(3) Voye^ ce que nous avons dit pag. 227. recommander aux voyageurs qui nous suivront.
(4) VyytZ la coupe du palais, planche 2 1 , fig. / , et la (6) Voyez la planche 4 1 , A . vol. I I I .
planche 23 j A . vol. I I I . (7) Voyez la pl. y , fig. t, et la pl. 6, fig. 6 et7 , A . vol. I ,
(5) Notre collègue M. Dutertre, à qui l’on doit la (8) Voyez les planches 49 et y , A , vol. I.
découverte et le dessin de ce précieux bas-relief,'est le (9) Voyez la pl. y , fig. / , et la pl. 6, fig. 2 , A . vol. I I .
Le pylône qui en forme l’entrée, a trente-deux mètres ( i) de longueur, dix
mètres (2) de largeur, et.une hauteur de près de dix-huit mètres (3). Son encombrement
est de plus d un mètre (4). Quelques masses de granit épaïses çà et là
semblent annoncer qu il étoit précédé de colosses. On Voit encore dans l’intérieur
de la porte deux pierres et un tronçon de colonne qui y ont été probablement
apportés pour en fermer 1 entrée lorsque le temple étoit habité par les gens du
pays. Il n y a point de salles dans 1 intérieur du pylône ; on n’y aperçoit qu’un escalier
où l’on pénètre par une porte pratiquée dans le portique. Cet escalier monte
droit jusqu’au sommet de l’édifice : on ne trouve de palier que lorsqu’on est arrivé
au-dessus de la porte.
Immédiatement après le pylône, on pénètre dans un portique à jour, semblable
à celui du grand temple de Philæ. Ses murs forment un carré parfait. L ’intérieur
est décoré de deux rangées de colonnes qui en font tout le tour à l’est, au nord et
a 1 ouest, et qui se terminent au pylône. Tout le milieu est découvert: c’est comme
une sorte de cour environnée de colonnes. Des pilastres qui s’élèvent verticalement
contre le pylône, font suite aux colonnes et sauvent l’irrégularité d’un espacement
plus large dans le haut que dans le bas. L ’entre-colonnement qui correspond
aux portes, est double des autres : c’est une convenance à laquelle les Égyptiens
n’ont jamais manqué. Les colonnes sont maintenant engagées dans des décombres
qui ne permettent point de saisir leurs proportions ; elles paroissent beaucoup plus
lourdes qu’elles ne le sont réellement : on ne peut même pas en juger#sur les dessins;
il faudroit les voir enveloppées d’air, et tout-à-fait dans les mêmes circonstances où
les Égyptiens les ont primitivement établies, pour se faire une idée exacte de leur
effet. Les chapiteaux ont la forme de boutons de lotus tronqués (y) ; ils sont surmontés
de dés assez élevés sur lesquels repose l’entablement, qui se compose d’une
architrave et d’une corniche, où l’on ne retrouve point l’élégance et les heureuses
proportions que nous avons remarquées ailleurs. L ’architrave et son cordon sont
doubles en hauteur de la corniche et de son listel. Les parties inférieures dès chapiteaux
sont décorées de bandes horizontales, qui ne sont que gravées sur la pierre;
elles sont interrompues d’espace en espace par huit ornemens légèrement saillans,
qui représentent très-bien la forme d’un obélisque, et dépassent la dernière bande
horizontale de tout le pyramidion. La partie supérieure du chapiteau est décorée
de légendes hiéroglyphiques accompagnées de serpens. Les fûts des colonnes sont
ornés de frises (6) et de tableaux encadrés d’hiéroglyphes représentant des offrandes
et des sacrifices aux dieux. Ils présentent une circonstance qui mérite de fixer
l’attention. Presque tous les paremens des colonnes sont garnis d’un enduit, pour
cacher les nombreuses imperfections de l’appareil : c’est sur cet enduit que sont
sculptés, ou peut-être même imprimés, les figures et les hiéroglyphes qui sont en
relief dans le creux, non-seulement sur les colonnes, mais encore dans toute
(1) Seize toises deux pieds. (5) Voyez la planche55, fig , 4 , A . vol. I I I .
(2) Trente pieds neuf pouces. (6) La figure 7 , pl. 5 7 , A . vol. I I I , offre unéchan-
(3) Cinquante-cinq pieds quatre pouces et demi. tillon de ces frises.
(4) Trois pieds un pouce,
A. D .