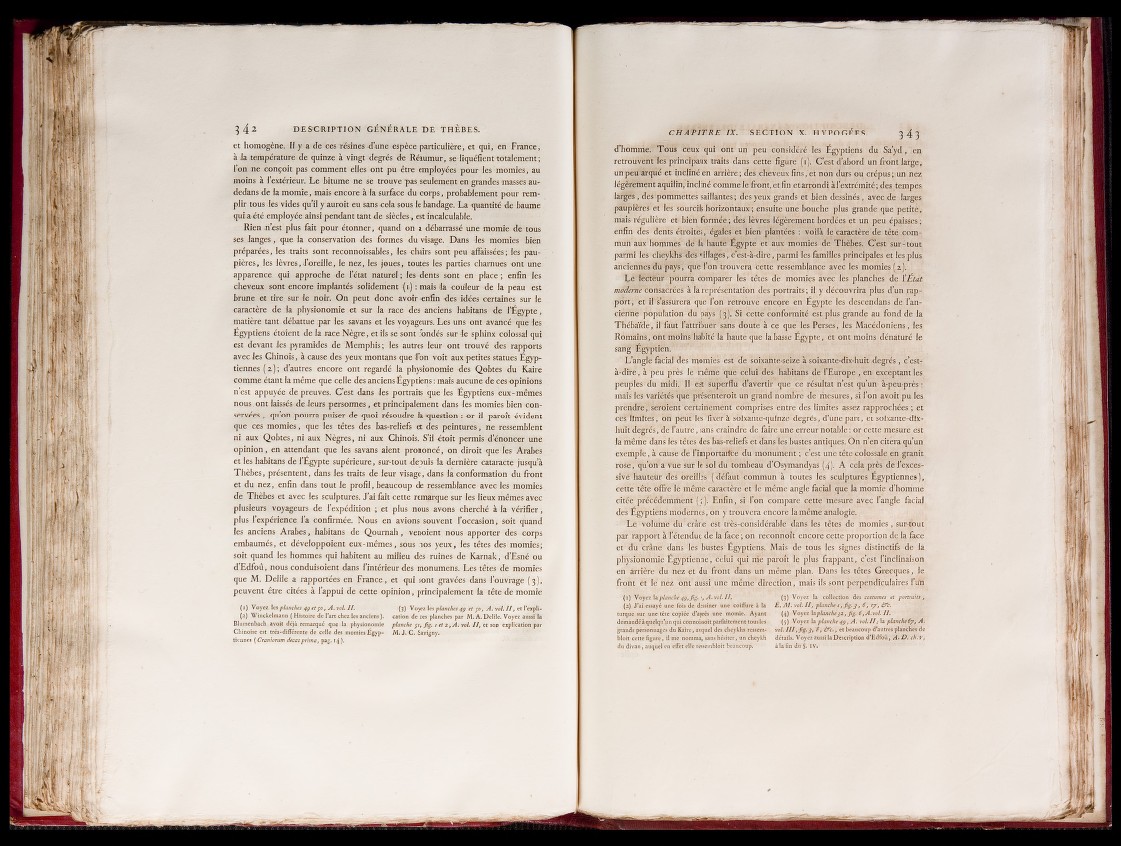
et homogène. H y a de ces résines Am e espèce particulière, et qui, en France,
à ia température de quinze à vingt degrés de Réaumur, se liquéfient totalement ;
l’on ne conçoit pas comment elles ont pu être employées pour les momies, au
moins à l’extérieur. Le bitume ne se trouve pas seulement en grandes masses au-
dedans de la momie, mais encore à la surface du corps, probablement pour remplir
tous les vides qu’il y aurait eu sans cela sous le bandage. La ■quantité de baume
qui.a-été employée ainsi pendant tant de siècles , est incalculable.
Rien m'est plus fait pour étonner, quand on a débarrassé une momie de tous
ses .langes, que la conservation des formes du visage. Dans -les momies bien
préparées, les traits sont reconnoissables, les chairs sont peu affaissées; les paupières,
lès lèvres, ¡l'oreille, le nez, les joues, toutes les parties charnues ont une
apparence qui approche de l’état naturel ; les dents sont en place ; enfin les
cheveux sont encore implantés solidement {i) : mais la couleur de la peau est
brune et tire sur le noir. On peut donc avoir enfin des idées certaines sur le
caractère de la physionomie et sur la race des anciens habitans de l’Égypte,
matière tant débattue par les savans et les voyageurs. Les uns ont avancé que les
Egyptiens étoient de la race Nègre, et ils se sont fondés sur le sphinx colossal qui
est devant les pyramides de Memphis; les autres leur ont trouvé des rapports
avec les Chinois, à cause des yeux montans que l ’on voit aux petites statues Égyptiennes
( 2 ) ; d’autres encore ont regardé la physionomie des Qobtes du Kaire
comme étant la même que celle des anciens Égyptiens : mais aucune de ces opinions
n’est appuyée de preuves. C’est dans les portraits que les Égyptiens eux-mêmes
nous g ont laissés de leurs .personnes, et principalement dans les momies bien conservées
, qu’on pourra puiser de quoi résoudre la ¡question : or il paroît évident
que ces momies, que les têtes des bas-reliefs et des peintures, ne ressemblent
ni aux Qobtes, ni aux Nègres, ni aux Chinois. S’il étoit permis d’énoncer une
opinion, en attendant que les savans aient prononcé, on diroit que les Arabes
et les habitans de l’Egypte supérieure, sur-tout depuis la dernière cataracte jusqu’à
Thèbes, présentent, dans les traits de leur visage, dans la conformation du front
et du nez, enfin dans tout le profil, beaucoup de ressemblance avec les momies
de Thèbes et avec les sculptures. J ’ai fait cette remarque sur les lieux mêmes avec
plusieurs voyageurs de l’expédition ; et plus nous avons cherché à la vérifier,
plus l’expérience l’a confirmée. Nous en avions souvent l’occasion, soit quand
les anciens Arabes, habitans de Qoumah, venoient nous apporter des corps
embaumés, et développoient eux-mêmes, sous nos yeux, les têtes des momies;
soit quand les hommes qui habitent au milieu des ruines de Karnak, d’Esné ou
d’Edfoû, nous conduisoient dans l’intérieur des monumens. Les têtes de momies
que M. Delile a rapportées en France, et qui sont gravées dans l’ouvrage (3),
peuvent être citées à l’appui de cette opinion, principalement la tête de momie
(1) Voyez les planches 49 e t $ ° , A . vol. I I . (3) Voyez les planches 49 et 90, A . vol. 11, et l’expli-
(2) Winckelmann ( Histoire de l’art chez les anciens), cation de ces planches par M. A. Delile. Voyez aussi la
Blumenbach avoit déjà remarque que la physionomie planche 9 1, fig. 1 et 2 , A . vol. I I , et son explication par
Chinoise est très-différente de celle des momies Égyp- M. J . C. Savigny.
tiennes ( Craniorum decasprima, pag. 14).
d’homme. Tous ceux qui ont un peu considéré les Égyptiens du Sa’yd , en
retrouvent les principaux traits dans cette figure (i). C’est d’abord un front large,
un peu arqué et incliné en arrière; des cheveux fins, et non durs ou crépus; un nez
légèrement aquilin, incliné comme le front, et fin etarrondi àl’extrcmité; des tempes
larges, des pommettes saillantes; des yeux grands et bien dessinés, avec de larges
paupières et les sourcils horizontaux; ensuite une bouche plus grande que petite,
mais régulière et bien formée ; des lèvres légèrement bordées et un peu épaisses ;
enfin des dents étroites, égales et bien plantées : voilà le caractère de têté commun
aux hommes de la haute Egypte et aux momies de Thèbes. C’est sur-tout
parmi les cheykhs clés villages, c’est-à-dire, parmi les familles principales et les plus
anciennes du pays, que l’on trouvera cette ressemblance avec les momies (2).
Lé lecteur pourra comparer les têtes de momies avec les planches de l’Etat
moderne Consacrées à la représentation des portraits; il y découvrira plus d’un rapport,
et il s’assurera que l’on retrouve encore en Egypte les descendans de l’ancienne
population du pays (3). Si cette conformité est plus grande au fond de la
Thébaïde, il faut l’attribuer sans doute à ce que les Perses, les Macédoniens, les
Romains, ont moins habité la haute que la basse Égypte, et ont moins dénaturé le
sang Égyptien.
L ’angle facial des momies est de soixante-seize à soixante-dix-huit degrés, c’est-
à-dire, à peu près le même que celui des habitans de l’Europe , en exceptant les
peuples du midi. Il est superflu d’avertir que ce résultat n’est qu’un à-peu-près;
mais les variétés que présenteroit un grand nombre de mesures, si l’on avoit pu les
prendre, seraient certainement comprises entre des limites assez rapprochées ; et
ces limites, on peut les fixer à soixante-quinze degrés, d’une part, et soixante-dix-
huit degrés, de l’autre, sans craindre de faire une erreur notable : or cette mesure est
la même dans les têtes des bas-reliefs et dans les bustes antiques. On n’en citera qu’un
exemple, à cause de l’importartce du monument ; c’est une tête colossale en granit
rose, qu’on a vue sur le sol du tombeau d’Osymandyas (4). A cela près de l’excessive
hauteur des oreilles (défaut commun à toutes les sculptures Egyptiennes),
cette tête offre le même caractère et le même angle facial que la momie d’homme
citée précédemment ( 5 ). Enfin, si l’on compare cette mesure avec l’angle facial
des Égyptiens modernes, on y trouvera encore la même analogie.
Le volume du crâne est très-considérable dans les têtes de momies , sur-tout
par rapport à l’étendue de la face ; on reconnoît encore cette proportion de la face
et du crâne dans lés bustes Égyptiens. Mais de tous les signes distinctifs de la
physionomie Égyptienne, celui qui nie paroît le plus frappant, c’est l’inclinaison
en arrière du nez et du front dans un même plan. Dans les têtes Grecques, le
front et le nez ont aussi une même direction, mais ils sont perpendiculaires l'un
(1) Voyez la planche 49, fig . 1, A . vol. I I . (3) Voyez la collection des costumes et portraits ,
(2) J ’ai essayé une fois de dessiner une coiffure à la E . M . vol. I I , planche s, fig. 3 , 6 , i y , B “c.
turque sur une tête copiée d’après une momie. Ayant (4) Voyez la planche3 2 , fig. 6, A . vol. I I .
demandé à quelqu’un qui connoissoit parfaitement tous les (5) Voyez la planche 49, A . vol. I I ; la plancheây, A .
grands personnages du Kaire, auquel des cheykhs ressent- vol. I I I , fig. 3 , 8 , i f c . , et beaucoup d’autres planches de
bloit cette figure, il me nomma, sans hésiter, un cheykh détails. Voyez aussi la Description d’Edfoû, A .D . ch.V,
du divan, auquel en effet elle ressembloit beaucoup. à la fin du §. IV.